COMPIÈGNE : 1939-1945
chapter[30pt]\contentslabel30pt\thecontentspage[]


Hitler à Compiègne
Occupation et Résistance
Rapatriement des Prisonniers de Guerre
Laval inaugure la Relève
Service du Travail Obligatoire
Le Camp de Concentration de Royallieu
Libération
Aux Otages,
Aux Déportés,
Aux Internés,
Aux Prisonniers de Guerre,
Aux Forçats du Service du Travail Obligatoire,
Aux Combattants, Hommes et Femmes,
avec ou sans Uniformes, qui luttaient
pour que la France vive.
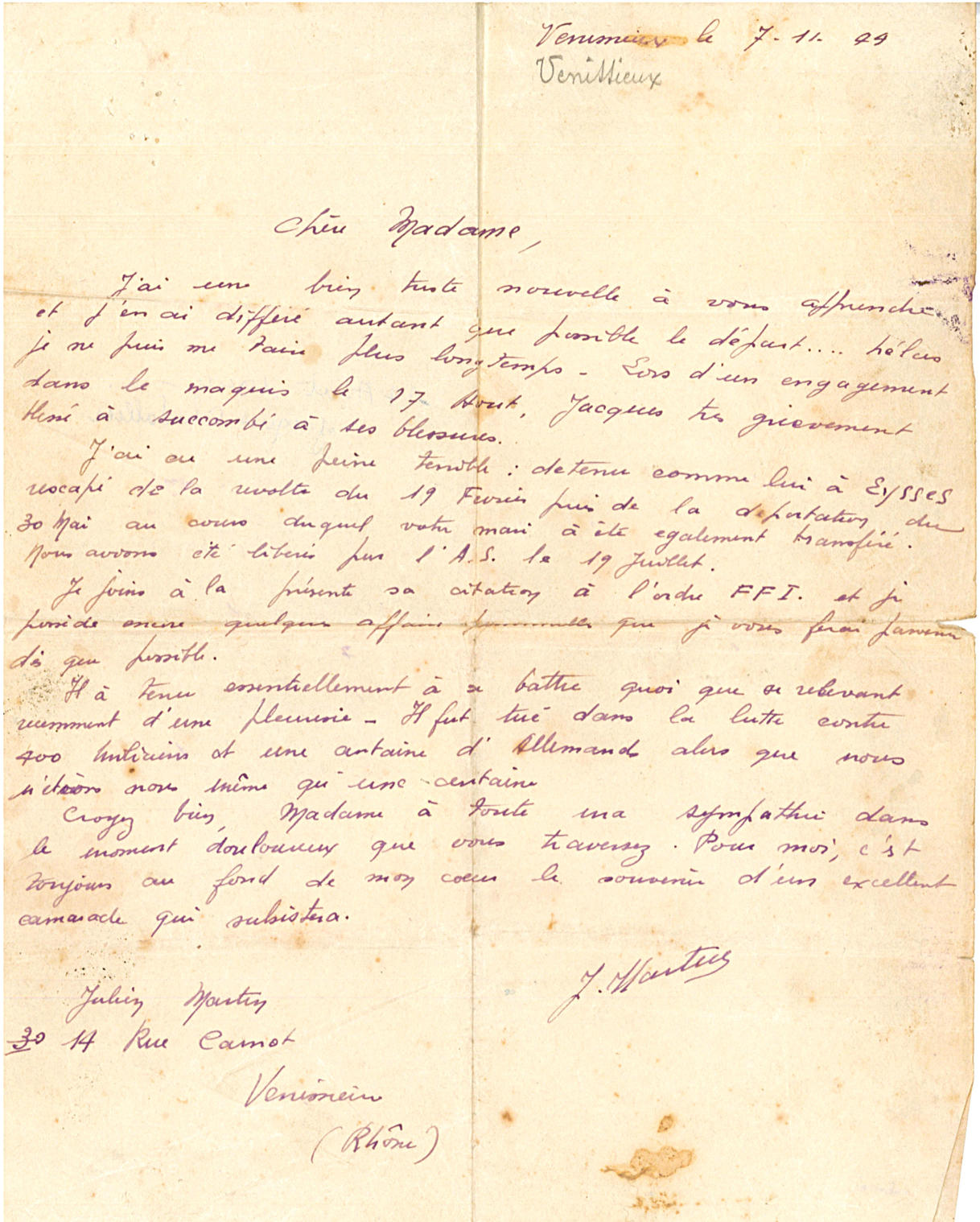
Table des matières
- Préface
- Avant-Propos
- Ville de souvenirs
- Hitler à Compiègne
-
Occupation et Résistance
- Les sinistrés abandonnés
- À l’ombre de la croix gammée
- Secteur Est numéro 3
- Baignade tragique et cheminots
- L’enseignement de l’instituteur
- Bataillon de France
- Feux de joie d’un premier Mai
- Comme Moïse, sauvé des eaux
- Vivre libres et combattre
- Bon sang ne peut mentir
- Il faisait le Jacques sur la moto
- Quand les armes tombent du ciel
- Trahison
- Martyre de BADUEL
- 14 Juillet tricolore
- Un fameux capitaine: André Dumontois
- La mort d’un héros
- Les plus jeunes résistants de France
- Jéricho
- Otto
- Étranges conversations
- Un ausweis insoupçonnable
- Arrestations parmi tant d’autres
- Entente Cordiale
- À la Gestapo
- Rafle des juifs
- La police avec nous
- La duperie de la Relève
-
Le camp de Concentration de Royallieu
- Royallieu
- Frontstalag 122
- 54.000 internés sous le ciel d’Île-de-France
- Courrier clandestin
- Terroristes ?
- Dignité
- Un sacré sacristain
- Premier convoi de la déportation
- Américains au Camp
- Femmes Françaises
- Les Marseillais
- Otages et martyrs
- Jaeger, l’homme aux chiens
- Évasions
- L’heure de la déportation
- Ceux du bataillon d’Eysses
- Convoi de la mort
- Ultimes convois de la déportation
- Libération
- Sources d’information
Liste des Documents
- 1 Avis de décès de Jacques.
- 2 Chanson de soldats par Muguette Chevallier.
- 3 Avis de décès, gazette de La Croix Saint-Ouen.
- 4 Coupure de presse
- 5 Carte de résistant.
- 6 Attestation de Médaille militaire.
- 7 Coupure de presse
- 8 Portrait de Jacques Chevallier
- 9 Monument aux morts.
- 10 Une ville de souvenirs
- 11 Les balcons du Führer.
- 12 La délégation au wagon de l’armistice.
- 13 La délégation au wagon de l’armistice.
- 14 La délégation au wagon de l’armistice.
- 15 Le glaive vainqueur.
- 16 La délégation au wagon de l’armistice.
- 17 La délégation au wagon de l’armistice.
- 18 La délégation au wagon de l’armistice.
- 19 La clairière de l’armistice vidée.
- 20 Le wagon à Berlin.
- 21 Compiègne en ruines.
- 22 L’allée des Beaux-Monts.
- 23 Wagons 40 hommes ou 8 chevaux.
- 24 Portrait de André Dumontois.
- 25 Un héros
- 26 Avis de démobilisation.
- 27 Transport de prisoniers.
- 28 Avis de condamnanation à mort.
- 29 officiers du C.R.T.P.G. et du Hilag
- 30 Les volontaires de la relève.
- 31 Laval inaugure la Relève.
- 32 La fanfare de la Relève.
- 33 Les prisonniers.
- 34 Cérémonie de la relève.
- 35 Prêts pour le S.T.O. ?
- 36 Le plan du 122
- 37 Le Frontstalag 122
- 38 Le détenu est apte au travail.
- 39 Le cachet du 122
- 40 La vue aérienne du 122
- 41 Les gardiens du 122
- 42 Les prisonniers du 122
- 43 Les prisonniers avec leurs matricules.
- 44 La statuette du déporté.
- 45 Poême de F. Quimerc’h
- 46 Les barbelés du Frontstalag 122.
- 47 Un mirador du 122.
- 48 Exemple de plaque de détenus.
- 49 Le trou de l’évasion.
- 50 Les évadés du Frontstalag 122.
- 51 Les déportés menottes aux mains.
- 52 Ordre d’inhumation.
- 53 Le quai de la déportation.
- 54 Un départ.
- 55 Un convoi de déportés devant la gare.
- 56 Pont de la ligne Compiègne-Soisson.
- 57 Quai improvisé de Bellicart.
- 58 Statistiques du camp de Royallieu.
- 59 Chronologie des convois partis de Compiègne.
- 60 Les Américains à Compiègne.
- 61 Une Jeep devant le pont détruit.
- 62 La Kommandantur destituée.
- 63 Une passerelle improvisée.
- 64 Les compiègnois retrouvent un pont.
- 65 Les allemands prisonniers.
- 66 L’heure des comptes.
- 67 Le retour de la dalle.
- 68 La dalle, fierté des anciens combattants.
- 69 Estimation des pertes humaines Françaises.
- 70 Lettre de retour du monument
- 71 Hommage aux morts.
- 72 Journées du souvenir, 15 au 18 août 1946.
Préface
La ré-édition de ce livre m’est venue à l’idée suite au décès de ma grand-mère Muguette François née Muguette Maria Lætitia Chevallier le 13/08/1925 pour que perdure sa mémoire et pour rendre hommage à tous les résistants d’hier et d’aujourd’hui.
Comme toutes les guerres, elle a suscité de nombreuses souffrances. La lettre envoyé à Maria Chevallier née Maria Lætitia Thieffin le 08/10/1904, épouse de Marcel et mère de Mirelle (1922), Jacques(1923) et de Muguette peut en témoigner:
«Chère madame, j’ai une bien triste nouvelle à vous apprendre et j’en ai différé autant que possible le départ…Hélas, je ne puis me taire plus longtemps. Lors d’un engagement dans le maquis le 17 Août, Jacques très grièvement blessé à succombé à ses blessures.
J’ai eu une peine terrible : détenu comme lui à Eysses, rescapé de la révolte du 19 février puis de la déportation du 30 mai au cours duquel votre mari a été également transféré. Nous avions été libéré par l’A.S. le 19 juillet
Je joins à la présente sa citation à l’ordre F.F.I. et je possède encore quelques affaires personnelles que je vous ferai parvenir dès que possible.
Il a tenu essentiellement à se battre quoi que se relevant récemment d’une pleurésie. Il fut tué dans la lutte contre 400 miliciens et une centaine d’Allemands alors que nous n’étions nous même qu’une centaine.
Croyez bien, madame à toute ma sympathie dans le moment douloureux que vous traversez. Pour moi, c’est toujours au fond de mon cœur le souvenir d’un excellent camarade qui subsistera.
Julien Martin, le 7/11/44 à Venisseux»
Maria ne fut pas au bout de ses peines, car non seulement son unique fils a rendu honneur à la patrie, mais son mari Marcel, également résistant, a été interné, Muguette a subit des gardes à vue, son gendre Lucien THAYE, époux de Mireille, également été incarcéré à cette époque fut un des ultimes témoins de la résistance compiégnoise (décédé le 27/08/2009).
Ensuite, son autre gendre Charles François et son mari ont du faire le S.T.O. dans les camps où Charles a attrapé la tuberculose qui a eu un impact sur sa santé tout le reste de sa trop courte vie.
Ça ira mieux demain
I
Quoi de plus gai qu’une chanson de route?
Rien, rien, rien.
Vous avez raison sergent.
quoi de meilleur que de casser la croûte?
Rien, rien, rien.
Surtout quand on a d’bonnes dents.
Refrain
Bonjour les petits oiseaux.
Bonjour les copains.
Si ça n’va pas tantôt. (bis)
Ça ira mieux demain. (bis)
II
Quoi de plus clair qu’un bon vin qui pétille?
Rien, rien, rien.
Vous avez raison sergent.
Quoi de frais qu’un joli brun de fille?
Rien , rien, rien.
Surtout quand on a vingt ans.
III
Quoi de plus doux qu’un sourire au passage?
Rien, rien, rien.
Vous avez raison sergent.
Quoi de plus mou qu’un vieux bout de fromage?
Rien, rien, rien.
Avec un verre de vin blanc
IV
Quoi de plus blanc qu’un mouton de la plaine?
Rien, rien, rien.
Vous avez raison sergent.
Quoi de plus cher qu’un mot de la marraine.
Rien, rien, rien.
Avec vingt-cinq balles dedans !
V
Quoi de plus vif que le pas des gazelles?
Rien, rien, rien.
Vous avez raison sergent.
Quoi de plus lourd que les choux de Bruxelles
Rien, rien, rien.
On s’en souvient en marchant.
VI
Quoi de plus noir qu’un nègre qui s’éveille?
Rien, rien, rien.
Vous avez raison sergent.
Quoi de plus bleu que le ciel de Marseille?
Rien, rien, rien.
On dirait qu’il a l’accent.
VII
Quoi de plus que d’revoir son village?
Rien, rien, rien.
Vous avez raison sergent.
Plus de soucis, au ciel pas un nuage.
Rien, rien, rien.
Nous rentreront en chantant!
Final
Bonjour les p’tis oiseaux.
Bonjour les copains.
Bonjour, c’est pas trop tôt.
On s’retrouve enfin!
Ce livre fut dédicacé à Marcel par l’auteur le 14/2/1969. Ce dernier, mort le 16/12/1971, l’a ensuite dédicacé à ces enfants et petits enfants comme témoignage de ces mauvaises années.
Né le 26/7/1895, la vie de Marcel Sévère Chevalier a été marquée par la guerre. Déjà en 1916, lors de la bataille de Verdun Marcel a reçu un éclat de grenade à la tête au chemin des dames est entré dans la mémoire collective pour avoir été le théâtre de plusieurs batailles meurtrières.
Ironie du sort, Camille François, né en 1891 , père de son futur gendre et gueule cassée à également reçu éclat de grenade à la tête à Verdun. Pour ce dernier, les séquelles ont été beaucoup plus lourdes. Sa convalescence lui a cependant permis d’être soigné par Henriette DEBEAUPUIS, né en 1895, infirmière qui s’occupait des gueules cassées en Île de France. Lorsque Camille entama son retour à Oulchy-le-Château (Aisne), il prît le train de Paris à Compiègne qui passait par Estrées-Saint-Denis et LaCroix-Saint-Ouen (encore orthographiée La Croix Saint Ouen). Il y rencontra alors Henriette qui rentrait chez elle à Estrées et ils décidèrent de garder le contact et eurent onze enfants dont Charles, le mari de Muguette.


Certaines des actions menées par ces différentes personnes sont relatées dans l’ouvrage de André Poirmeur
et peuvent également être trouvées dans d’autres témoignages.
Par exemple, voici un texte publié par Jean-Pierre Besse, historien,
pour le compte de l’A.N.A.C.R. (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance)
au cours du 4 trimestre 1989.
Commune de plus de 2000 habitants, La Croix St Ouen est parmi celles dont le conseil municipal en place est dissout par le gouvernement de Vichy qui, au début de 1941, élimine les hommes jugés peu sûrs et les remplace par des hommes "dignes de confiance".
En février 1941, Roger MUNIER, industriel, est nommé maire ; Raymond TONNELIER, directeur d’usine, 1 adjoint et Louis QUILLET, propriétaire, deuxième adjoint. Quatre artisans, quatre ouvriers, deux contremaîtres, deux agriculteurs, un commerçant, un industriel viennent compléter le conseil dans lequel siège pour la première fois une femme (une institutrice retraitée). Rien d’original dans ce conseil qui cherche à partir d’un savant dosage à refléter la composition socio-professionnelle de la commune en restreignant considérablement les responsabilités des ouvriers, et en les remplaçant par des personnes en grande majorité dociles et favorables aux thèses du gouvernement PETAIN.
Le changement touche aussi le poste de secrétaire de mairie. Victime sans doute de son engagement politique d’avant-guerre, H. BOISSEAU est révoqué très tôt. Il est remplacé par Jacqueline MIQUEL en septembre 1940, puis, en mars 1941 par M. S. CRAMMER. Ce dernier a aussi en charge le secrétariat de Saint-Sauveur et, nous le verrons plus loin, aidera discrètement mais activement la Résistance locale.
GENÈSE DE LA RÉSISTANCE
À l’origine, la résistance locale est un phénomène limité, et surtout inorganisé. La spontanéité et l’individualisme l’emportent. On écoute discrètement "Radio-Londres". On s’aventure, avec précaution, à critiquer les Allemands et le gouvernement de Vichy. En fait, de mai 1941 à mai 1942, la résistance se cherche.
Petit à petit, cependant, les premiers noyaux se forment dans la clandestinité comme l’exige l’époque. Arrivé à La Croix St Ouen peu de temps avant la déclaration de guerre, Marius DUTRIAUX entreprend de reconstituer le parti communiste dans la commune. Il avait, au moment du Front Populaire, organisé sur le plan syndical les ouvriers agricoles dans le canton de Maignelay, puis avait dû s’éloigner de cette région où il était trop connu.
Un peu plus tard, en mars 1941, Robert GEORGELIN, de Venette, contacte Lucien THAYE, André LANGELEZ et Jacques CHEVALLIER. Il leur propose d’entrer dans la résistance active et aux Jeunesses Communistes. Lucien THAYE pense aujourd’hui que ce recrutement s’est fait sur les conseil de Marcel CHEVALLIER (père de Jacques) de La Croix St Ouen et de Albert LEROY de Royallieu. Le premier est connu comme communiste.
Les organisations sportives et culturelles permettent de renouer les liens rompus au moment de la mobilisation ou de la débâcle. À la même époque R. GEORGELIN et L. CHATILLON recrutent Marcel LÉTORT à Compiègne. Avec ses camarades, Lucien THAYE est chargé de distribuer des tracts et des papillons dans les usines, et de coller des affiches. Les rapports de gendarmerie, conservés aux archives départementales, signalent d’ailleurs l’apparition d’affichettes et de tracts à La Croix St Ouen et Saint-Sauveur le 2 août 1941 et le 2 septembre 1941. Les affichettes du 2 août portent en titre "les chômeurs ont faim".
Le Front National (le Front National de Lutte pour l’Indépendance Nationale de la FRANCE a été constitué le 15 mai 1941 ; il va devenir une organisation très large groupant des résistants de toutes opinions et de toutes religions, des croyants et des non-croyants) recommande de fêter le 1 mai 1942 par des actions spectaculaires afin de marquer la fête du travail. Dans la nuit du 30 avril au 1 mai, à Mercières, à proximité du camp de Royallieu, une meule de foin requise par les Allemands, est incendiée par C. LEROY et J. BOURGEOIS, tandis que Lugien THAYE et André LANGELEE détruisent un grand hangar utilisé pour le ravitaillement de l’armée d’occupation. Le 2 mai, le local de la L.V.F., officine de la collaboration, à Compiègne, est pulvérisé par une bombe lancée par Lucien LESNE et Jacques CHEVALLIER.
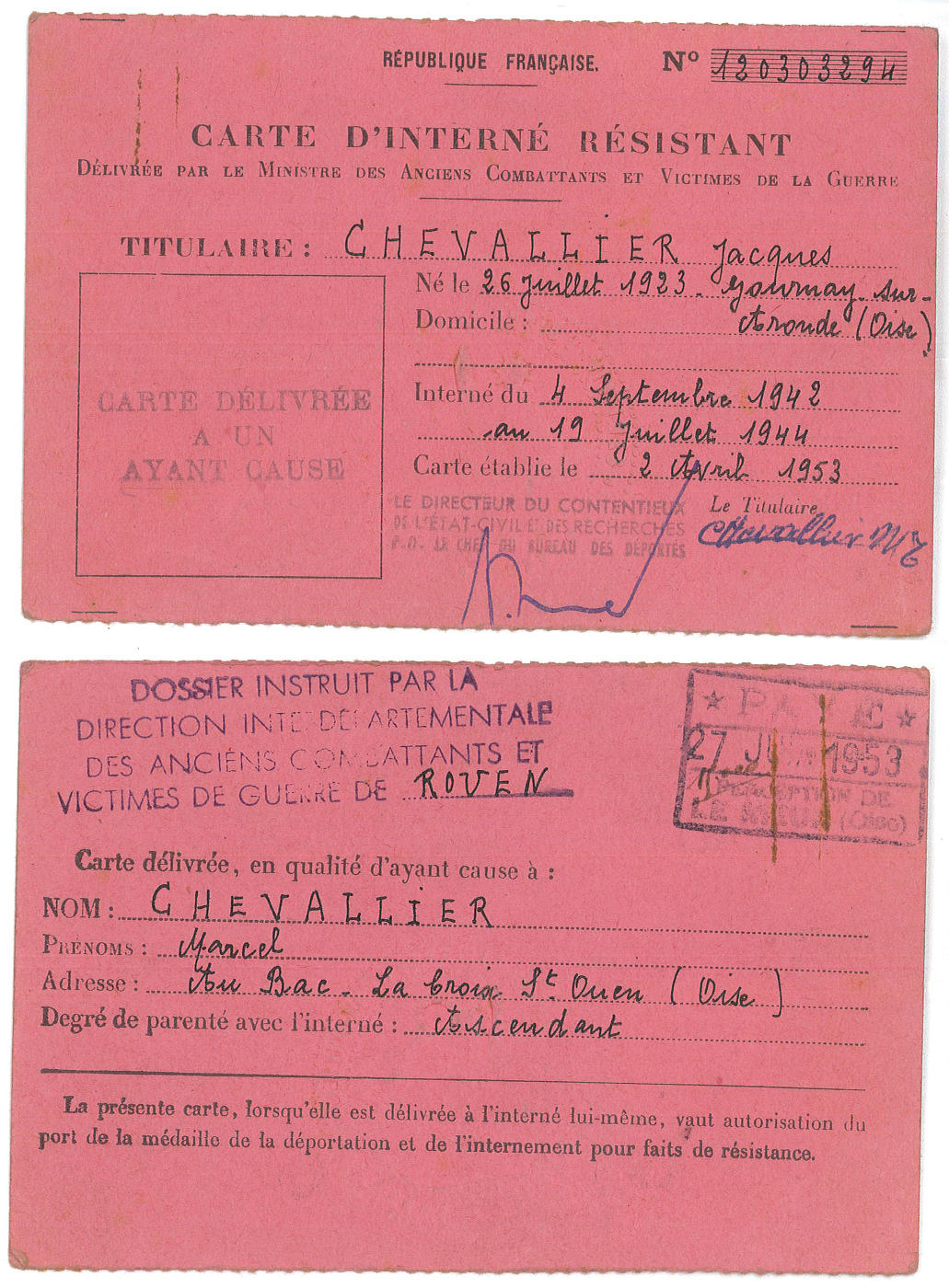
La police semble avoir rapidement repéré les auteurs de toutes ces actions. Le 4 septembre 1942, André LANGELEZ, Marcel, Jacques et Muguette CHEVALLIER, ainsi que Lucien THAYE sont arrêté. Le même jour, Maruis DUTRIAUX, dont L. THAYE affirme ignorer alors l’appartenance à la Résistance, est arrêté. Le groupe tombe après la défaillance d’un de ses camarades qui a craqué au cours de son interrogatoire, et qui mourra en déportation en Allemagne. Faute de preuves, Muguette CHEVALLIER est relâchée, mais ses camarades sont jugés en juillet 1943. Lucien THAYE et Jacques CHEVALLIER, internés à Compiègne, puis à Amiens, sont transférés à la Centrale d’Eysses ; ils participeront à la révolte qui secouera cette centrale les 19 et 20 février 1944.
Sur ordre de Vichy et des occupants, la Centrale d’Eysses est fermée, les prisonniers sont déportés en Allemagne. L. LESNE et L. THAYE, après un court passage au camp de Royallieu (dans lequel a d’ailleurs été interné l’abbé MASSE de La Croix St Ouen au début de l’occupation), sont déportés à Dachau le 18 juin. Le voyage se fera dans des conditions épouvantables ; il durera 2 jours. Dans des wagons à bestiaux, les hommes sont entassés par 100, sans eau, les vasistas fermés ; ils disposent d’une botte de paille et d’une grande tinette. Jacques CHEVALLIER, très faible, avait été admis à l’infirmerie ä Eysses avant l’évacuation du camp. Le 19 juillet les derniers patriotes détenus à la centrale sont libérés par la Résistance du Lot et Garonne. Jacques CHEVALLIER reprend sa place parmi eux, il tombe au combat le 17 août aux environs de Villeneuve-sur-Lot. Quant à Marius DUTRIAUX, la Résistance compiégnoise organise son évasion quelques jours avant le début du procès (juin 1943). Caché pendant quelques temps à La Croix St-Ouen dans le grenier d’une maison bombardée ; il poursuivra ensuite la lutte contre les nazis en Normandie où il sera abattu par les Allemands le 1 février 1944 à Rougemontier (Eure).
À l’automne 42, les premiers groupes locaux de Résistance sont
décimés mais l’accalmie est de courte durée.
Signalons néanmoins qu’en 1941 Eugène DOUGE avait une première fois
été contacté par un résistant de Royallieu qui lui avait demandé de constituer
un "triangle" (réalisé avec Jean GODARD et Alfred COTTARD) ; il
n’y eut aucune suite à ce premier contact. Une seconde fois, en début
1942, il entre en relation avec un résistant de Verberie, une équipe est
constituée pour coller des affiches et distribuer des tracts. En mars de
la même année E. DOUGE purgera 15 jours de prison à Compiègne pour avoir
chanté la "Marseillaise" au nez et à la barbe des Allemands à Royallieu.
À cette période - 1942 - THAYE, DUTR1AUX, DOUGE sont engagés dans
différentes actions de résistance. Ils n’ont aucun contact entre eux et
ne se connaissent pas à ce titre. La discrétion et le cloisonnage sont
déjà des réalités.
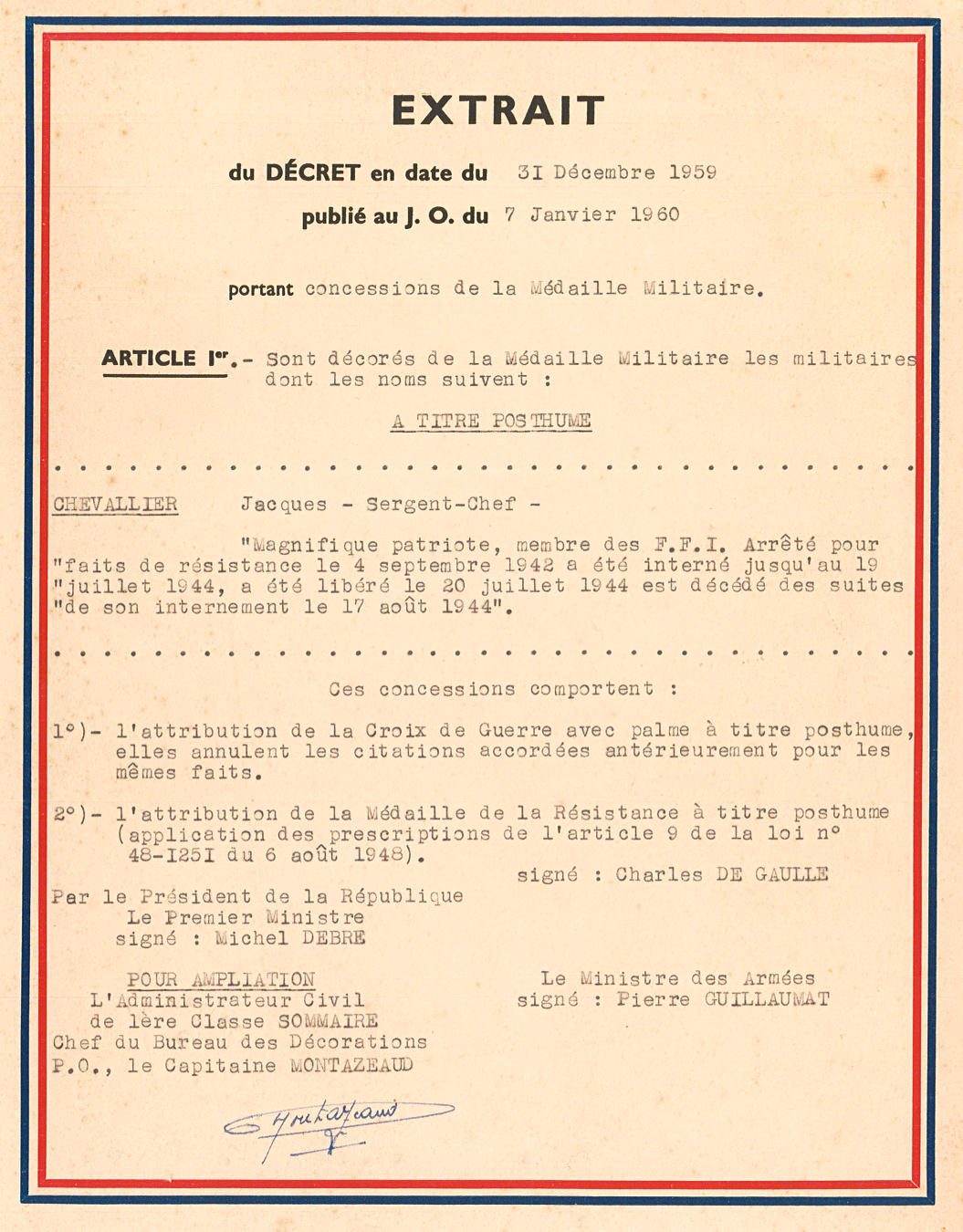
LE S.T.O. (Service du Travail Obligatoire)
La guerre dure, les Allemands ont un besoin de plus en plus pressant
de main-d’œuvre. Dès l’automne 40 les Nazis font une propagande
systématique appelant à aller travailler en Allemagne comme volontaire.
Le chômage qui se développe dans les premiers mois de l’occupation, la
promesse de hauts salaires et autres conditions avantageuses, facilitent
le recrutement.
À partir de 1942, l’appel au volontariat ne suffit plus. Avec l’appui du gouvernement Pétain11 1 Dès le mois de mai 1942, l’Allemagne exige un contingent d’ouvriers français de 250 OOO hommes. Pour tenter d’éviter de heurter de front les Français, le gouvernement de Vichy propose l’envoi de travailleurs contre le retour de prisonniers. Hitler s’en tint à l’échange d’un prisonnier contre 3 travailleurs. La "relève" est officiellement lancée le 22 juin., les occupants passent à un échelon supérieur. En mai 1942 la "Relève" se met en place, et le ll août le premier train de prisonniers rapatriés croise à Compiègne un convoi d’ouvriers en route pour l’Allemagne. Mais le pays ne suit pas.
Au 1 septembre 1942, 17 OOO spécialistes seulement se sont portés volontaires. SAUCKEL (responsable allemand de la main-d’œuvre dans les territoires occupés) obtient alors du gouvernement de Vichy la loi du 4 septembre 1942 sur "l’utilisation et l’orientation de la main-d’œuvre" qui instaure un régime de travail obligatoire.
En novembre, un groupe de jeunes employés dans différentes usines de La Croix est requis pour travailler au dépôt de fourrage allemand de la Nourylande. Parmi eux Raoul CARON, René DEMAZURES, Georges DOLLE, Emile HERISSON, Jean HOCQUART, Albert LEBLOND, Kléber MARQUOIN, Paul PONS et Maurice THAYE.
Bien vite des caches sont aménagées parmi les balles de paille pour permettre de se soustraire au travail. À cette mauvaise volonté évidente de travailler s’ajoute rapidement le sabotage. Le fourrage est arrosé dans les wagons avant son départ pour qu’il fermente pendant le voyage et soit inutilisable à l’arrivée. Des graviers glissés dans les boîtes à graisse des wagons provoquent le grippage des essieux.
Le 17 décembre, premier départ obligatoire pour l’Allemagne. Un groupe de travailleurs de chez HUYGENS comprenant Roger BOITEL, Emile BUCQUET, Raoul CARON, Jacques DOLLE, Marcel MASSON, Edouard PHLANTZER, Lucien SOIRON, Maurice THIERY, sera dirigé vers la base sous-marine de HAMBOURG. Roger BOITEL, Emile BUCQUET et Maurice THIERY tenteront vainement de s’évader en 1944 (cachés sous les wagons, ils seront repérés par les chiens policiers avant le départ du train). Ils rentreront en France avec leurs camarades en Mai 1945.
Au cours de cette année 1942, où l’incertitude et l’inquiétude grandissent, beaucoup de jeunes ne savent que faire. Roger HAINSELIN, lui réussira à s’engager après avoir passé la ligne de démarcation et 3 mois d’instruction à Castres. Il quittera la France pour le Maroc à la fin Août. Il réapparaîtra parmi les troupes de la 2e D.B. après la Libération.
Pour accélérer le rythme des départs en Allemagne, le gouvernement Pétain promulgue la loi du 16 février 1943 portant création du S.T.O. (Service du Travail Obligatoire) de deux ans pour tous les jeunes gens des classes 40,41 et 42 qui seront envoyés en Allemagne. Quelques temps après, la classe 43 est touchée. Face au S.T.O. les jeunes ont un choix très limité. Comment, en effet, s’y soustraire ? À cette période, il n’existe pas de maquis à l’horizon, la résistance organisée est inconnue de la majorité de la population. Il y aura donc ceux qui partent, ceux n’existe pas de maquis aux environs, la résistance organisée est inconnue qui partent mais qui profitent d’une permission pour ne pas repartir, enfin ceux qui refusent le départ et trouveront par la suite une aide précieuse auprès de la Résistance.
En février 1943, douze travailleurs sont requis chez HUYGENS. Lucien HERLIN, Gaston PETIT, René BRUYANT, Marcel BOITEL, Jacques DHOURY et d’autres, partent le 27 février 1943. Ils reviennent en permission le 28 août 1943. Jacques DHOURY et Marcel BOITEL ne repartiront pas. Ils iront travailler à la sucrerie de Francières sous le nom de Machefer et Leblond. À partir de février 1944 ils travaillent sous leur vrai nom aux Établissements Brissonneau à Creil.
Dénoncé, Jacques DHOURY, recherché par les Allemands, échappera de peu à l’arrestation.
En ce même mois de février, d’autres jeunes sont requis pour le travail en Allemagne : Marcel CARLIER, Achille DELALAIN, Henri et Charles FRANÇOIS. Arrivé en Allemagne, Marcel CARLIER entonne des chants patriotiques : il est séparé de ses camarades. On apprendra sa mort à Oranienburg en février 1944 à la suite d’actions de sabotage.
Roger LECOURT, appelé en mars 1943, évite le départ en se faisant porter malade. Appelé une seconde fois en septembre, il se cache et réussit à se faire embaucher comme bûcheron en forêt.
En mars 1943 le groupe de la Nourylande est convoqué à la visite médicale pour le S.T.O. Émile HÉRISSON ne s’y présente pas.

Réfractaire, clandestin, sans papiers, sans carte d’alimentation, sans foyer, il est hébergé quelques semaines dans sa famille dans la région parisienne, puis va travailler dans une ferme en Normandie où il échappe de peu à une arrestation. Il revient sous une fausse identité s’embaucher à la sucrerie de Coudun, et retrouve, grâce à Léonard OSSET, du travail chez Huygens en janvier 1944 (Application des accords BICHELONNE et création des usines S. BETRIEBE). Là il trouve une Résistance bien organisée et active, grâce justement aux efforts déployés par Léonard OSSET. Peu de temps après il reprendra la vie clandestine, devenant l’agent de liaison du Front National du Secteur de COMPIÈGNE.
René HÉRISSON était parti travailler dans les Vosges. En septembre 1944, devant la progression des troupes alliées et le bombardement de son usine, il est pris comme otage et transféré en Allemagne au camp de MANNOWITZ. Du fait de l’avance soviétique ce camp est évacué. Le transfert vers BUCHENWALD et MATHAUSEN se fera dans des conditions épouvantables. René est déclaré "DCD à MAUTHAUSEN (Autriche)" le 24 avril l945.
D’autres jeunes et moins jeunes ont été réquisitionnés par les services allemands. C’est ainsi que Alexandre MORCHAIN trouvera la mort le 7 mars 1944 au dépôt de St Léger aux Bois au cours du déchargement d’un train de munitions.

Le texte suivant a été rédigé par André Poirmeur, résistant et compagnon de Marcel et Jacques entre-autres.
Ses compétences dans les langues Allemande, Anglaise et Russes auront été de très grand importance pour la résistance.
Ce document n’est pas un roman, mais se veux être un témoignage très documenté à vocation historique. Veuillez par avance pardonner les passages parfois trop énumératifs. Il est principalement constitué en 3 parties. Après une présentation des actes fort de la résistance compiégnoise, l’auteur présente la vie dans le camp de détenus de Royallieu. La dernière partie, plus joyeuse, traite de la libération tant attendue.
À la mémoire de Jacques Chevallier
Muguette François née Chevallier,
Marcel Chevallier, leur père
Camille et Charles François.

Avant-Propos
La reconnaissance n’est pas ce qu’on cherche dans un historien;
au contraire, c’est ce qui le rend suspect. FENELON.
Compiègne a été meurtrie au cours de la guerre de 1939 à 1945 à un point tel, qu’il est surprenant qu’aucun témoin qualifié pour les relater, n’ait encore évoqué les événements importants qui s’y sont déroulés et qui se rapportent directement à la Grande Histoire de notre pays
Rien n’a été étranger à cette ville de l’Oise : elle a vu accourir les Français appelés par la mobilisation. recueilli les blessés des combats. les cohortes de réfugiés, Belges et Français, persuadés d’échapper aux bombardements meurtriers et se faisant tuer avec les compiégnois sous les bombes des Stukas.
Hitler, victorieux, a voulu l’humilier par son diktat du 22 juin 1940 et lui faire payer cher d’avoir été la Ville de l’Armistice du 11 novembre 1918. Tel Néron, il y a savouré son triomphe dans le spectacle d’une ville qui se consumait dans l’immense brasier qu’il avait projeté depuis longtemps.
Le Secteur Est n3, de Noyon à Compiègne, dont il sera fait état, a été le théâtre important de la lutte patriotique menée contre l’occupant. Il a eu ses martyrs, ses héros comme le grand résistant André Dumontois le méconnu et cependant emportant dans la mort tous ses secrets.
Compiègne a vu le spectacle des scènes dramatiques de ces troupeaux humains partant du camp d’internement de Royallieu pour la Déportation. scènes qui attisaient l’ardeur patriotique de ses habitants. Cependant certains, hélas! y sont restés insensibles.
Relater par des mots simples, sans prétention littéraire, les événements qui se sont déroulés dans cette partie du département de l’Oise, peut paraître une gageure, tant il est vrai qu’ils ont été si nombreux que s’il fallait les évoquer par le menu, un volume ne suffirait pas.
Aussi bien a-t’il été impossible de publier la liste monstrueuse des 53787 internés de Royallieu, les archives incomplètes du camp que je possède ne me le permettant pas.
Toutefois, il m’a paru nécessaire de citer les faits les plus saillants de ces années terribles qui m’ont été communiqués par leurs auteurs ou des témoins dignes de foi que je tiens à remercier ici, et ceux auxquels j’ai été mêlé de près ou de loin avec des dizaines d’autres combattants sans uniforme, en lutte. contre un ennemi impitoyable, dont, disait Mirabeau. la guerre est l’industrie nationale.
La résistance a été le fait de l’activité menée de 1940 à 1944 par des Françaises et des Français, isolément ou par équipes, et ne peut être revendiquée par un seul ou quelques-uns. Celui qui y a participé en a tout le mérite et c’est la somme de tous ces actes personnels et collectifs qui ont permis à ceux qui y ont contribue de se hausser à la Gloire et à l’Honneur à la fin de la tourmente.
Compiègne fut un havre d’espoir pour les centaines de milliers de Prisonniers de Guerre croupissant dans les Stalags et les Oflags. 200000 seulement passèrent en transit avant de rejoindre leurs foyers, prisonniers mystifiés par la duperie de la Relève de volontaires, conscients ou non. et des forçats du Service du Travail Obligatoire.
Rendons hommage aux compiégnois, à ceux dont les âmes ne furent pas de glace et qui ne purent assister sans s’émouvoir à ces scènes des misères de la Guerre, à ces cortèges de gueux héroïques, d’où jaillissaient les chants patriotiques et vengeurs de notre France, scènes que Callot lui-même n’avait pas imaginées!
Aujourd’hui, un monument d’une simplicité émouvante, en bordure de la route de Paris devenue l’avenue des Martyrs-de-la-Liberté rappelle aux passants le souvenir de ce vaste quadrilatère qui fut, de 1941 à 1944, le plus grand Camp de Concentration au cœur de la France.
Le 2 mai 1961, d’anciens nazis et S.S. ont cru de leur devoir de déposer sur la stèle, auprès de l’urne qui renferme de la terre des camps d’Allemagne, une palme de bronze portant l’inscription «Nous regrettons !» Impudence, regrets tardifs ? La palme a été subtilisée par des inconnus.
Enfin, c’est sans haine envers le peuple allemand qui en a souffert aussi, mais avec lui que nous devons sauver de l’oubli, pour ne plus les revivre. les événements qui ont marqué tragiquement la guerre faite à la civilisation de 1939 à 1945. C’est avec lui que nous devons honorer la mémoire de ceux qui furent les victimes de ces barbares nazis qui ne pouvaient être que des monstres issus d’une espèce sans parenté avec celle de l’Homme, espèce qui n’est pas encore éteinte.
A. P.
Ville de souvenirs
Située à 70 kilomètres au Nord de Paris entre la rivière d’Oise et sa belle forêt. Compiègne a participé à l’Histoire de la France avec laquelle sa propre histoire se confond souvent. Nombreuses sont ses heures glorieuses et douloureuses.
Ancienne station gallo-romaine. elle fut, dès l’époque mérovingienne, résidence royale. Charles le Chauve désirait en faire sa capitale et lui donna le nom de Carlopolis. Du château fort qu’il fit bâtir en 877, seule subsiste encore une partie importante de la Tour du Beauregard.
Elle reprit par la suite le nom de Compiègne et plusieurs rois y furent sacrés. inhumés. dans sa célèbre abbaye de Saint-Corneille, sœur de celle d’Aix-la-Chapelle, qui fut la plus riche et la plus puissante communauté religieuse de France, comblée de privilèges et d’offrandes.
Dès 1153, Compiègne obtint une charte communale et Jeanne d’Arc qui qualifiait ses habitants ’ses bons amys de Compiègne’ y fut faite prisonnière le 23 mai 1430, lors d’une sortie malheureuse à la tête d’une trop faible escorte, cependant que la ville était incendiée. Compiègne eut l’honneur de s’émanciper et d’avoir sa Maison commune en 1502. Résidence royale favorite. tous les rois l’habitèrent, le futur Louis XVI y reçut Marie-Antoinette en 1767. En 1793, Compiègne s’appela Marat-sur-Oise et le lieu- dit Royallieu, le Hameau de la Révolution. Napoléon 1, qui avait fait du Château une Maison impériale y reçut à son tour, en 1810, Marie-Louise, avec laquelle il était marié par procuration à titre civil et qui arrivait directement de Schönbrünn. Le bouillant Corse, toujours pressé. n’eut pas la patience d’attendre le mariage religieux et la nouvelle impératrice en fut, paraît-il, très satisfaite.
Quatre ans plus tard, en 1814, les Prussiens attaquèrent la ville sans succès et Louis XVIII, rentrant en France, y prenait un peu de repos avant de rentrer solennellement dans Paris. Le mariage de Louise, fille de Louis-Philippe, avec Léopold 1, roi des Belges, fut célébré au Château en 1832. Tout le monde pleurait. Napoléon III et Eugénie firent de Compiègne leur résidence favorite et les fameuses Séries s’y déroulèrent jusqu’à ce que la guerre de 1870 les interrompit. Les Prussiens s’installant au Château des le 20 septembre, occupèrent la ville qu’ils pillèrent huit jours durant.
En 1901, l’alliance franco-russe qui devait forcer l’Allemagne, en cas d’agression, de se défendre sur deux fronts: une belle et bonne alliance, comme dira le général de Gaulle le 13 décembre 1944 à Moscou, est saluée par tous comme un heureux événement susceptible d’assurer la Paix. La joie éclate en France et c’est à Compiègne que seront célébrées des fêtes grandioses en l’honneur des souverains russes.
1914! L’Allemagne viole la neutralité de la Belgique, le maréchal French et l’état-major britannique installés au Château cèdent bientôt la place aux Allemands qui occuperont la ville du 1 au 12 septembre 1914.
C’est à Compiègne, soumise pendant quatre ans aux bombardements de l’ennemi retranché à 10 kilomètres de là. que sera signé sur son territoire en forêt. la capitulation de l’empire allemand, le 11 novembre 1918. Pour effacer cet événement, -cette Schande (honte)-, dans ses discours, Hitler a promis de détruire la ville : die Vernichtung von Compiègne. Il la fera brûler en sa présence le 21 juin 1940.
Joies et tristesses ont ainsi marqué la destinée de cette ville de la vallée de l’Oise, chemin des grandes invasions qui semèrent la mort et le malheur.
Les rois, séduits par la beauté de sa forêt dans laquelle ils chassent le cerf et le sanglier, fondent un rendez-vous de chasse à la Neuville-au- Bols. petit hameau au sud de Compiègne, qui deviendra Royal Lieu, séparé de l’agglomération compiégnoise par des champs de culture, sur lesquels seront construits, des 1913. les baraquements des Nouvelles Casernes destinés à recevoir les recrues appelées par la nouvelle loi de trois ans de service. Bien qu’elles soient inachevées, les fantassins du 54 R.I. les occuperont jusqu’en août 1914, d’où ils partiront combattre, en pantalon rouge. les feldgrauen allemands qui mitrailleront à loisir ces cibles inespérées.
Les baraquements des Nouvelles Casernes, utilisés pendant la guerre de 1914-1918 comme Hôpital Complémentaire, furent occupés par les aérostiers jusqu’à la guerre de 1939-1945, et devinrent les prisons du camp des internés de Royallieu.
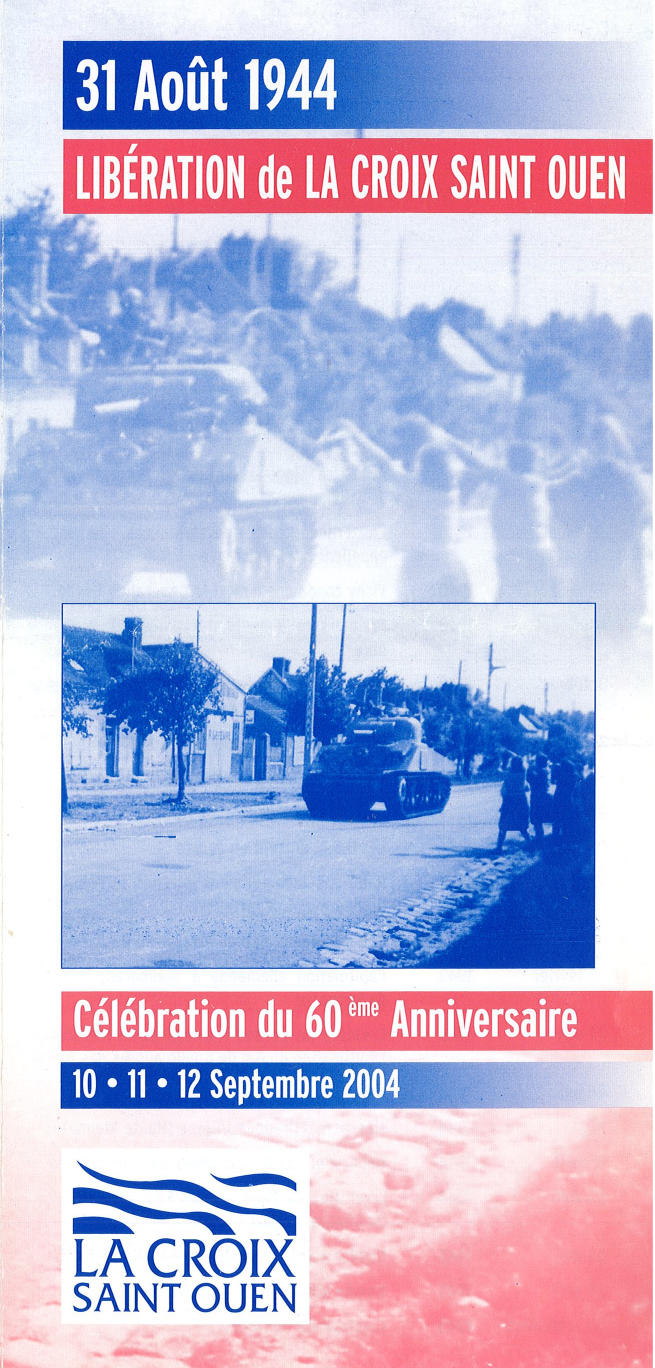
Les pages suivantes contiennent un extrait du document sorti à l’occasion de la commémoration du 60 anniversaire de la libération à Lacroix-Saint-Ouen.




Hitler à Compiègne
Diktat et incendie de la ville
À peine l’étrange paix qui sépare les deux guerres mondiales a-t-elle permis à Compiègne de se relever de ses ruines et de reprendre une vie normale, que l’invasion allemande de 1940 replonge là ville dans la tragédie. Une tragédie qui va durer plus de cinq ans. Après le morne hiver 1939-1940 que la France utilisa pour perdre ses forces et que l’Allemagne employa à affermir les siennes, le 10 mal 1940 la Wehrmacht déclenche son offensive, envahit la Belgique, les Pays-Bas et la France, contournant par le Nord «l’infranchissable» ligne Maginot. 140 divisions allemandes. 7000 chars des Panzerdivisionnen bousculent les 115 divisions alliées et leurs 2000 engins blindés.

Le 17 mai 1940, Compiègne subit son premier gros bombardement. Des maisons s’écroulent, ensevelissant nombre de malheureuses victimes sous les décombres que l’on ne retrouvera jamais. On en relève soixante-quatre parmi les réfugiés de passage pris au piège et qui sont inhumées au Cimetière du Sud. Le lendemain les compiégnois évacuaient la ville que les Allemands occuperont le 9 Juin. Cinq ou six habitants ne se résignent pas à abandonner leurs foyers. Les autres rejoignent les milliers de réfugiés qui fuient vers l’Ouest ou le Sud sur les routes de France. Des scènes d’épouvante les jalonnent : hommes, femmes, enfants. des bêtes aussi, agonisent et meurent. La guerre est une chose terrible et Hitler l’a voulue totale.
Le 24 mai, le général en chef Weygand22 2 Responsable dans le défaitisme. Le IIIe Reich, William Shirer, Tome II, page 782. Stock éditeur., recommande au président du Conseil, Paul Reynaud, de demander l’armistice pour garder une armée capable de maintenir l’ordre!

Du 10 mai au 10 juin. nos aviateurs ont abattu 980 avions ennemis au prix de 488 tués. Au moment de l’armistice, notre aviation dispose encore de 1075 appareils mais la trahison ou l’incapacité de certains états-majors empêche l’utilisation à plein des forces disponibles33 3 C’était ainsi, page 188. F. Grenier. Éditions sociales.,
Des régiments entiers se rendent à une poignée de soldats allemands. Un général français à la recherche de son armée se retrouve au milieu d’un bataillon ennemi. D’autres officiers supérieurs fuient tout à leur sort personnel. Cependant des unités résistent héroïquement pendant plusieurs semaines aux assauts de la Wehrmacht sur la ligne Maginot. prise à revers. Robert Rondet, Jeune marié à une de mes cousines. est tué face à l’ennemi.
Le gouvernement a quitté Paris et s’est installé au château de Cangé,
près de Tours. Le bombardement de l’aérodr0me voisin contraint le gouvernement
à fuir à Bordeaux où, le 16 juin, le ministère démissionne. Le président
Lebrun demande au maréchal Pétain s’il accepte de constituer le gouvernement.
Le vieux soldat sort une liste de son portefeuille, la tend au
président en lui disant: «Le voici» immédiatement, Pétain demandait aux
Allemands de faire connaître leurs conditions d’armistice par l’entremise
de M. de Lequérica, ambassadeur d’Espagne à Paris et faisait paraître son
premier communiqué :
«Français! Il nous faut abandonner la lutte. Je me suis adressé à notre
adversaire et je lui ai demandé s’il était prêt à traiter avec moi, soldat, et
sur une base honorable, des possibilités de mettre fin aux hostilités.»

On sait ce qu’il advint de la base honorable.
Le 21 juin 1940, une délégation d’une vingtaine de personnes, partie de Bordeaux, roulait vers Paris occupé depuis le 14 juin. Les délégués pensent que les négociations vont avoir lieu dans la capitale avec ceux du gouverne- ment allemand, après avoir été reçu à Vendôme. pendant la nuit. par le leutnantgeneral von Tippelskirch désigné pour les accompagner. Mais. à Paris, ce dernier fait descendre des voitures le général Parisot commandant un groupe d’armées, le directeur adjoint des Affaires politiques Rochat. le sous-directeur des Affaires étrangères Lagarde, le colonel Lacaille chef d’état- major d’Huntziger, des officiers des trois armées. l’interprète, les chauffeurs et dactylo, tous éliminés de la délégation qui ne se compose plus que de quatre plénipotentiaires44 4 Un témoignage. Le Diktat de Rethondes et l’Armistice franco-italien. Flammarion, édit. 1957 : le général Huntziger, Léon Noël ambassadeur de France à Varsovie, le général de l’armée de l’air Bergeret. le vice-amiral Leluc. Sans autres explications, le leutnantgeneral von Tippelskirch les conduit inopinément à Compiègne. Hitler a choisi cette ville pour y recevoir en par- sonne la défaite de la France sur les lieux mêmes où. vingt-deux ans auparavant, le 11 novembre 1918. L’empire allemand avait capitulé.

L’Oberstleutnantgeneral Buckler, commandant la place, a été plein d’attention pour le Führer qui doit jouir pleinement de sa victoire dans une ville détruite. En effet, des quartiers entiers du centre de Compiègne, épargnés par les bombardements aériens, ont été incendies à la main ou aux lance- flammes après pillage, mais les chaussées que doit emprunter le maître du Reich sont déblayées.
À l’arrivée d’Hitler, l’incendie fait rage dans la ville de l’Armistice et, de son avion personnel escorte d’une escadrille de chasseurs, le Führer dut contempler le spectacle avec satisfaction : Compiègne brûlait ! À 14 h 30. l’avion se posait sur l’aérodrome de Margny-lès-Compiègne. Prenant place dans sa grande Mercedes noire suivie d’une caravane motorisée bruyante, Hitler traverse Compiègne en ruines et en flammes, pour se rendre au Carrefour de l’Armistice où il arrive à 15 h 15.
Le glaive vainqueur planté sur l’aigle allemand agonisant, œuvre en bronze du ferronnier Brandt et qui orne le monument des Alsaciens- Lorrains, est masqué par un drapeau à croix gammée. Dans l’allée triomphale conduisant au carrefour, la troupe rangée des deux côtés de l’avenue attend. l’arme au pied, l’arrivée du Führer vainqueur. Depuis le 19 juin. la façade du bâtiment qui abrite le wagon historique a été démolie au marteau piqueur pneumatique par le génie allemand et le wagon sorti de son abri est garé au centre de la Clairière.

Rien ne manque pour donner le plus d’éclat à la célébration de l’événement : musique, cinéma, radio, déploiement de troupes impressionnant parmi lesquelles on remarque un bataillon du fameux régiment Hermann Goering. Près de la dalle centrale, l’important pavillon personnel d’Hitler a croix gammée frange d’or flotte au sommet d’un grand mât blanc. Les hauts dignitaires du Reich accompagnent Hitler. il y a la le feldmarschal de la Luftwaffe Goering. le grand amiral Raeder, l’Oberbefehlshaber de la Wehrmacht von Keitel, le ministre des Affaires étrangères von Ribbentrop, le conseiller du Führer Rudolf Hess, le chef des S.S. Himmier, le général de corps d’armée von Brauchitsch. Dietrich, les officiers de la maison d’Hitler et l’0berstleutnantgeneral Buckler Ortskommandant de Compiègne.
Suivi de son escorte, Hitler, très grave. passe en revue les troupes qu’ii salue le bras tendu, s’arrête devant le monument de la honte, comme il le nomme, qu’il regarde avec dédain et monte immédiatement dans le wagon où il prend place et invite ses officiers à s’asseoir auprès de lui. Au bout de la table placée au centre du wagon-restaurant. se trouve l’interprète officiel du Führer, Doktor Paul Schmidt.
Il est 15 h 30 lorsque la délégation française. après plus de vingt heures de voyage, sous la conduite du Leutnantgeneral von Tippels- kirch, arrive au monument des Alsaciens-Lorrains, passe devant les troupes rangées au garde-à-vous et se dirige vers le wagon tandis que l’escadrille d’escorte du Führer passe en trombe. L’Oberstleutnant von Thomas, commandant du Quartier Général d’Hitler qui se tient au pied du marchepied du wagon, presse le général Huntziger, chef de la délégation française. hésitant, de gravir les marches.
À son entrée, Hitler et sa suite se lèvent. De part et d’autre, les saluts s’échangent et le Führer invite chacun à s’asseoir à la place qui lui est réservée et indiquée par un petit carton timbré de l’aigle du Reich 55 5 Un témoignage. Le Diktat de Rethondes et l’Armistice franco-italien. Flammarion, édit. 1957. Lui-même occupe le siège d’Erzberger en 1918, Huntziger celui de Foch, Léon Noël celui de l’amiral anglais Wemyss.
Le Feldmarschall Keitel, debout, fait le salut hitlérien, puis lit le préambule en allemand suivi de sa traduction en langue française par l’interprète Schmidt.

Hitler se lève, claque les talons, salue à son tour et, accompagné de la plupart des membres de sa suite, sort du wagon. Cette confrontation a durée douze minutes.
Le feldmarschall Keitel et l’Interprète Schmidt donnent alors lecture des 24 articles de la convention d’armistice, traduits, simultanément en français. qui stipulent que la France sera occupée au nord d’une ligne partant des Pyrénées au Cher dont elle suit le cours jusqu’à Bourges, pour aboutir à la frontière suisse après avoir traversé l’Allier à Moulins.
La France est, en fait, amputée des départements de l’Alsace et de la Lorraine, quant à ceux du Nord arrachés du territoire national, ils seront rattachés sous l’autorité du gauleiter de Bruxelles et les frais d’occupation des troupes allemandes à la charge de la France. Ces frais sont de 400 mil- lions par jour (500 deux ans plus tard) et en 1943 ils seront grevés d’un milliard de francs par mois.

Keitel se rassied dans un silence glacial. Chaque plénipotentiaire français reçoit un spécimen des conditions d’armistice et, se levant à nouveau, le feldmarschall demande d’observer une minute de silence afin d’honorer, dit-il. tous ceux, soldats allemands et soldats français qui ont versé leur sang pour leur patrie et se sont sacrifiés pour elle. Chacun se lève pour ce recueillement. Keitel tend la main au général Huntzinger et va rejoindre Hitler qui. pendant la lecture fastidieuse des 24 articles, s’était détendu, exécutant quelques mouvements de relâchement et se montre réjoui. Goering qui ne veut pas être en reste, trépigne. sautille et fait le pitre sur la dalle centrale. Reprenant un air digne et suivi de ses dignitaires. Hitler se dirige vers sa voiture tandis que le commandant de la compagnie d’honneur l’acclame par ces mots : «Die Wehrmacht grüsst den Führer des grossen Deutschlands! La Wehrmacht salue le Führer de la grande Allemagne!» que ponctuent le «Deutschland über alles» et le «Horst Wessel Lied».
Avant de pénétrer dans sa voiture blindée, Hitler souriant félicite ses ministres et ses généraux, cependant que Goering déchaîné crie, secoue sa grosse bedaine. lance des bourrades à ses voisins et. levant son bâton de maréchal orné de pierres précieuses. crie par trois fois «Sieg Heil!» repris par l’assistance. Le Führer salue, puis prend place dans la Mercedes qui va le conduire à Compiègne.

La délégation française est enfin invitée à descendre du wagon et à se rendre, toujours accompagnée de von Tippelskirch. sous une tente voisine dressée à son intention, auprès de la statue du maréchal Foch. Après plu- sieurs heures d’attente. les délégués pourront utiliser, dans le wagon. un appareil téléphonique relié directement au camion de transmissions dissimulé sous bois et dans lequel l’interprète Schmidt intercepte toutes les communications. À 20 h 20, une conversation s’engage enfin. «Allô ! Bordeaux ? Allô ! le gouvernement français ? Ici. le central de l’armée allemande en campagne ». Le général Huntziger dit à Weygand : « Vous devinez où je suis ? Je suis dans le Wagon! - Mon pauvre ami! ».
Hitler rentre à Compiègne et tel un empereur romain veut jouir de son triomphe. Installé au balcon du pan coupé du quatrième étage d’un grand immeuble construit sur un des points les plus élevés de la ville. au 47 de la rue Saint-Lazare, le Néron moderne savoure avec joie l’incendie gigantesque qui réduit en cendres le centre commercial dans un immense brasier, après avoir été vidé de sa substance. Par contre, les beaux immeubles des quartiers résidentiels sont épargnés, les nazis les occuperont. Après quelques heures de repos et un lunch servi dans l’appartement, Hitler et les dignitaires nazis regagnent l’aérodrome d’où lis s’envoleront, cependant que l’agence D.N.B. faisait connaître. au monde entier stupéfait, les événements qui consacraient la défaite et l’humiliation de la France.

Le lendemain même, 22 juin. les délégués français qui avaient été reconduits à Paris où ils étaient arrivés à deux heures du matin à l’Hôtel Royal-Monceau, rejoignaient à 10 heures le Carrefour de l’Armistice. À 11 heures, ils transmettaient au général Keitel l’acceptation par le maréchal Pétain de toutes les conditions d’armistice.
À 18 h 36. Keitel apposait sa signature. suivie de celle de Huntziger au bas de cette convention que bien des Français, trompés. qualifiaient de définitive. Les hostilités devaient cesser le mardi 25 juin à 1 h 35, heure allemande. En attendant. le document est considéré par les Allemands comme un vulgaire chiffon de papier. ils poursuivent l’invasion du pays. dépassent largement la ligne de démarcation fixée, occupent Saint-Nazaire, la Roche-sur-Yon, Niort, Clermont-Ferrand le 22 juin, la Rochelle, Saintes, Poitiers le 23, Saint-Étienne et Angoulême le 24 juin tandis que les mêmes plénipotentiaires français signaient un armistice avec l’Italie et que les Allemands capturaient toujours les soldats français qu’ils rencontraient et emmenaient dans les camps de prisonniers. Près de deux millions vont y croupir pendant cinq ans.
Le 8 juillet. le fameux wagon historique arrivait à Berlin pour être exposé au Tiergarten où il sera détruit au cours des bombardements. Les dalles. expédiées en pièces détachées. furent déposées dans un chantier de la Mühlenstrasse et le monument d’Alsace-Lorraine démonté fut transporté à Spandau. Tous ces éléments étaient destinés à l’édification d’un mémorial triomphal à la gloire du IIIe Reich après le succès final. La maquette de cet édifice qui devait être « kolossal », le plus haut du monde, était déjà exposée en attendant la victoire. Mais la Victoire, pour le bonheur de l’humanité. changea de camp.

La rampe en cuivre qui entourait le wagon est sciée en petits morceaux offerts aux soldats à titre de souvenir. Le hangar et les dallages de béton signalant les emplacements respectifs des wagons des délégations de 1918 sont dynamites et les décombres jetés dans l’étang du Carandeau où ils sont encore et les bornes de granit enterrées. La Clairière, ses édifices déportés eux aussi, est labourée, ensemencée d’un blé symbolique que Foch, solitaire sur son piédestal au milieu des ronces, contemplera jusqu’à la Libération.
Occupation et Résistance
Les sinistrés abandonnés
L’armistice entrait en vigueur six heures après la signature et chacun commençait à en voir les conséquences. De tous les côtés les soldats nazis (on les appela rapidement les doryphores), pullulaient bottés. casques et armés sous la chaleur accablante de cet été de 1940.
Peu à peu, les réfugiés regagnent leurs domiciles et ils traversent une France
désolée, livrée à la folie collective du gangstérisme. Les routes sont défoncées.
les ponts détruits. les voies ferrées coupées. C’est une vision dantesque
dans une atmosphère de mort et de terre brûlée. Dans les champs, sur les
routes, les bêtes affamées, abandonnées, hurlent, bêlent, mugissent, meurent.
Des voitures de toutes sortes. des bicyclettes gisent çà et la sans propriétaires
et passent de mains en mains.
Rentrée pénible pour beaucoup devant leur maison détruite. On comptera en effet 1500000 immeubles détruits sur 9975000 soit un sixième anéanti. 250000 établissements agricoles, 150000 bâtiments industriels, 25000 hectares de terre dévastés. Les sinistrés devront attendre 1968 pour obtenir le règlement définitif de leurs dommages de. guerre.
À Compiègne où plus de 600 immeubles sont en ruines. nous sommes au nombre des millions de sinistrés, comme le furent. deux fois mes parents en 1914 et en 1918 et mes grands-parents maternels en 1870, toujours par le même envahisseur. Appartements. boutique et atelier incendiés forment un amas de cendres encore chaudes en cette fin août 1940. lis seront reconstruits en partie dix-sept ans plus tard.

Le désespoir assaille les sinistrés d’autant plus que le maréchal Pétain. Chef de l’État Français, les a prévenus dans son message radiodiffusé du 25 juin :
«Vous serez bientôt rendus à vos foyers. Certains auront à les reconstruire. Vous avez souffert. Vous souffrirez encore. Beaucoup d’entre vous ne retrouveront pas leur métier ou leur maison. Votre vie sera dure. Ce n’est pas moi qui vous bernerai par des paroles trompeuses. N’espérez pas trop de l’État… Comptez pour le moment sur vous-mêmes et. pour l’avenir. sur les enfants que vous aurez élevés dans le sentiment du devoir.» Ce spectacle hallucinant produit des chocs si douloureux. qu’un certain nombre d’infortunés en perdent la raison : une bijoutière, Mme Besnier, et la fille d’un commerçant en chaussures échappent à leur détresse par le suicide, se noyant dans l’Oise voisine qui emporte leurs pauvres corps.
Vêtu de mon uniforme, nanti d’un brassard blanc frappé de l’aigle nazi que les Allemands m’ont remis à Langon, sur la ligne de démarcation, en me rendant à Bordeaux, je restai figé devant les ruines de mon foyer incendié. J’interpellai un Allemand qui gardait des prisonniers français, lesquels relevaient les éboulis encombrant la chaussée, sur les raisons de cette destruction, il m’avoua ne pas être fier de l’œuvre, il était antinazi; je m’en fus errant par les rues de la ville transformée en labyrinthe par ses ruines uniformes, d’où émergeaient parfois des sinistrés troglodytes et des pillards.
Après avoir retrouvé ma femme réfugiée dans les environs, nous occupâmes un appartement abandonné rue des Domeliers et requis à notre intention, dépourvu de ses vitres, dans lequel nous passâmes, sans chauffage, le rude hiver qui nous glaçait même à l’intérieur.

Le thermomètre marquait moins 7 degrés dans la chambre et. pris de compassion par notre détresse, le peintre voisin. M. Barberie, remplaça un jour, gracieusement, les carreaux de ‘notre’ chambre. Nous lui vouons une grande reconnaissance, car la solidarité fut vraiment rare en ces jours sombres.
Confinés comme des reclus dans nos demeures, portes et fenêtres rigoureusement calfeutrées, nous entendions les bombardiers ennemis gronder au-dessus de nous, en route vers l’Angleterre, dans l’océan d’obscurité qui recouvrait l’Occident.
Dans les rues, des pauvres chiens faméliques abandonnés erraient par bandes de trente à quarante bêtes qui s’égorgeaient mutuellement pour la possession d’un os dépourvu de toute sa substance.
Deux ans plus tard, en vertu de la loi du 9 février 1943, les sinistrés, -le gouvernement de Laval ne tenant aucun compte de leur détresse-, comme les autres contribuables, furent tenus d’acquitter un impôt métal par la remise d’une quantité fixée d’objets renfermant des métaux non ferreux dont ie Reich d’Hitler, qui avait déjà volé nos statues de bronze, avait tant besoin. Pour une insuffisance de livraison, l’équivalence à verser en espèces au Trésor était de 12 à 18 francs par hectogramme manquant. En ce qui concernait les sinistrés et les contribuables qui ne pouvaient satisfaire pour la livrai- son, le montant de cette équivalence en espèces était doublé.
Le nouvel Ètat ne témoignait de grands égards qu’aux nazis.
À l’ombre de la croix gammée
Pendant que les troupes nazies s’installent en maîtres sur le sol national et que près de deux millions de soldats français s’entassent derrière les barbelés des stalags et des oflags, les patriotes’ se concertent et espèrent un réveil du peuple. À Londres, pendant les mois de juin et juillet, on colle une affiche sur les murs, dont le texte est considéré comme étant l’appel du 18 juin du général de Gaulle. Un journal clandestin circule, «l’Humanité» du 10 juillet 1940, qui lance aux Français un appel digne des ancêtres de 1792.
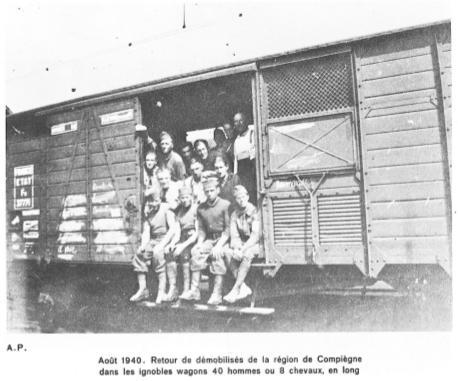
Des concitoyens jubilent ; Pétain, qu’il leur fallait, est au pouvoir. J’entends moi-même affirmer que «ça marche bien, Pétain est avec nous !». La propagande fasciste est telle qu’un grand nombre de commerçants, de bourgeois, de membres du clergé dociles aux directives des évêchés, -tel ce curé de Saint-Antoine qui entasse les objets d’art de cuivre et de bronze apportés par ses ouailles et qu’il destine à l’ennemi-, d’ouvriers trompés ou résignés, des militaires en congé, ne cachent pas leur sympathie au nouveau régime qui a enterré la République française pour céder la place à l’Etat Français. Le marché noir bat son plein à la grande satisfaction des trafiquants qui réalisent des fortunes scandaleuses. Beaucoup prospèrent comme des larves, d’autres s’épuisent.
Les postes clés sont pris d’assaut par les tenants du régime, et à Compiègne l’un d’eux tire un bénéfice considérable du bétail qu’il récupère dans le Parc du Château national, où sont rassemblés chevaux, bœufs, porcs et moutons’ abandonnés par leurs propriétaires, évacués ou victimes des bombardements.
Le 7 octobre 1940, la population s’inquiète du recensement, opéré par la Kommandantur, des Français démobilisés et prisonniers de guerre libérés, tandis que les sujets britanniques habitant la ville sont incarcérés. Parmi eux, lady Ashbourne et son mari, un lord septuagénaire que sa philanthropie et son kilt traditionnel avaient rendu populaire. Nationaliste irlandais, admirateur de notre grande Révolution et de l’abbé Grégoire, il avait refusé l’honneur d’être le premier président de la République d’Irlande en raison de son grand âge. Sa sœur avait en son temps défrayé la chronique des journaux par son attentat contre Mussolini à Rome. L’ambassade irlandaise. alertée, intervint et les fit bientôt libérer. Relâchées également, les Françaises mariées à des Anglais sont tenues de signer tous les jours un registre à la Ortskommandantur pour attester de leur présence.
Après les fonctionnaires communistes et les francs-maçons, ce sont les démocrates, les républicains qui sont destitués de leur emploi. Le maire de la ville, le baron James de Rothschild, qui est juif, a rejoint les F.F.L. 66 6 Forces Françaises Libres en Angleterre, après avoir traversé les Pyrénées en compagnie de contrebandiers et, ironie, gagné le Portugal à bord d’un avion allemand Condor assurant le service régulier de Berlin à Lisbonne par Madrid. il est remplacé par un adjoint qui, le 7 janvier 1941, adresse à Pétain «tous ses vœux de réussite dans l’œuvre de rénovation entreprise» et l’assure que Compiègne est prête à le seconder de tous ses efforts dans un élan général de solidarité. Adresse qui fut votée à l’unanimité par le conseil municipal. Quatre mois plus tard, le conseil municipal est dissous et reconstitué en partie par des anciens membres, en partie par des nouveaux, tous choisis par Pétain. Les conseillers municipaux se réunissent pour la première fois le 22 mai 1941 sous la présidence du doyen d’âge «qui demande à l’assemblée de suivre l’exemple de notre bien-aimé Chef, le Maréchal Pétain», tandis que le maire, reconduit à son poste, propose une nouvelle adresse l’assurant à l’unanimité «de leur respectueux attachement» et «de le suivre toujours et partout. certains de bien servir ainsi la cité et la Patrie». Les jours suivants, le maire et un adjoint remettaient des souvenirs de la ville au Chef, il n’y a ni Président ni République et en échange, Pétain accorde les nouvelles distinctions sollicitées et créées : médailles de la Francisque gallique de Pétain, d’argent pour le maire qui la portera jusqu’à juillet 1944, de bronze pour les autres personnages de moindre importance.
Une des premières horribles affiches rouges, fait connaître que le Compiégnois Eugène Cauchois a été fusillé le 4 décembre 1941 pour détention d’armes. En réalité, Cauchois, qui avait 27 ans. habitait dans la région de Creil, il fut exécuté à la citadelle d’Amiens et sa femme avait été tuée pendant l’exode. Ils laissaient un enfant âgé de 7 ans, Jackie.
Des entrepreneurs reçoivent des ordres exprès, accompagnés de menaces de dénonciations à la Kommandantur, de se mettre à la disposition des autorités d’occupation. La Kommandantur est installée dans la propriété d’un médecin au carrefour des rues des Domeliers, Biscuit, Pasteur et de la rue Carnot à laquelle elle fait face. Au-dessus de la porte d’entrée, un grand panneau blanc porte en lettres noires : Ortskommandantur. En face, un Bunker -un fortin- émerge à peine du sol, d’où les défenseurs pourraient repousser tout assaillant éventuel faisant irruption par l’une ou l’autre des cinq artères convergentes.
Devant l’immeuble, le drapeau rouge nazi frappé d’une croix gammée -le Svastika- au centre d’un disque blanc, flotte au sommet de son mât de couleur blanche au pied duquel une sentinelle monte la garde. Deux fois par jour, une escouade, bottée et casquée, défile au pas de l’oie pour l’envoi des couleurs qu’accompagnent les sonneries d’usage. C’est là qu’on sollicite les laissez-passer, les ’Auswaise’, et qu’ont lieu certains interrogatoires par le chef de la Gestapo Greif, le sous-chef Hermann et leurs agents et les gendarmes allemands, lesquels arborent sur la poitrine un croissant métallique distinctif. Le bon peuple, qui ne manque pas d’esprit, les appelle les enfants de chœur et les arrogantes Allemandes en uniforme et qui ricanent, les souris grises. Des Russes émigrées et complaisantes servent d’interprètes.
Les colonels Buckler, Lohse, Thurn und Taxis, les kommandants Dornte, Müller, Solf, les capitaines et lieutenants Faehler, Faudell. Grossloos, Grote. Hoffmann, Kehrenberg, Kroll, Pribouche, et les sous-officiers Doll, Dombrowski, Lendt y recevront des visiteurs de marque tels que Von Stulpnagel, Rommel, Kesselring, Karl Oberg, chef des S.S., les agents d’Eichmann, Brünner et Dannecker et ceux du Sicherheitsdienst de l’avenue Foch à Paris, dont le Hollandais Seelen qui habite le Francport.
La Feldgendarmerie occupe un grand chalet au 73, rue de Paris. Son parc communique avec la propriété voisine, dont le bel immeuble sert de mess aux officiers. Le maçon Vidal ayant été requis, exécute des travaux à la Feldgendarmerie et fait évader des prisonniers de guerre, il est arrêté, menacé mais relâché puisqu’il persiste à nier. Deux jeunes gens, Jacques Bourgeois - mort en déportation - et Claude Leroy, ayant badigeonné en lettres énormes sur le mur extérieur «Mort à Hitler !», il fut désormais interdit. pour éviter le retour de pareilles injures, d’utiliser le trottoir qui longeait les deux immeubles et une barrière blanche d’une centaine de mètres fut solidement fixée au sol par des ferrures scellées dans le trottoir.
Face au Palais National, le foyer des soldats s’est installé au Palace Hôtel. Un grand panneau, fixé au-dessus du porche, porte: «Soldatenheim Feldkommandantur 638 Beauvais». Mais un soir, le grand pavillon qui flotte au haut du mât sera décroché après plusieurs tentatives par un jeune électricien de 17 ans, Jacques Bentz, et ce trophée obtiendra un grand succès a Londres où il sera exposé avec cette légende: «Avril 1943. Drapeau du Soldatenheim de Compiègne détaché par un jeune patriote».
Des personnages plus réalistes achètent à vil prix les biens des Juifs spoliés ou des sinistrés. Au marché noir, il faut payer au décuple les produits alimentaires ou autres, car les attributions des cartes d’alimentation sont notoirement insuffisantes. Pas de vêtements. peu de chaussures -à semelle de bois-, pas de friandises pour les enfants, puisque tout est destiné aux troupes d’occupation ou aux personnages haut placés ou nantis d’un solide compte en banque.
L’élevage du lapin est considérable à tel point que l’herbe recherchée se fait rare, cependant que les paysans assurent avec malice que, vu la situation politique, les poules ne pondent plus.
Une nouvelle profession est née : celle des conducteurs de vélos-taxis qui trainent avec plus ou moins d’aisance leurs clients installés dans la remorque.
Les Allemands, gros malins, activent avec succès un feu de bois qu’ils ont allumé dans la fausse cheminée monumentale du grand salon du cercle mondain qu’ils occupent avenue Thiers. Il y fait si chaud qu’il ne reste plus que les murs calcinés. Au reste, nos pompiers doivent combattre les fréquents incendies dans la ville et dans la région, et même à Soissons. La compagnie de sapeurs pompiers, commandée par le capitaine Fournaise, déployé une grande activité au cours des 387 alertes aériennes de 1939 à 1944 dont 54 particulièrement vives et inquiétantes.
Mandé en toute hâte le 1er juin 1944, un détachement, sous les ordres du lieutenant Saingéry, part pour Rouen pour combattre le gigantesque incendie qui ravage la ville pendant quatre jours. Des centaines de pompiers luttent sans relâche contre le feu attisé par le nouveau bombardement de la R.A.F. sous lequel quatre pompiers parisiens trouvent la mort 77 7 À peine rentrés à Compiègne, le 8 juin, la ville de Rouen décernait à nos pompiersun diplôme de reconnaissance pour leur rapide et courageuse intervention à 130 kilomètres deleur caserne et le 1er août 1947 le gouvernement citera la compagnie à l’ordre des BellesActions pour son dévouement au cours de la guerre..
Les jeunesses de Pétain, provocantes, défilent dans les rues en chantant «Maréchal, nous voilà !» devenu hymne national et qui plonge les opposants au régime dans une douce hilarité.
On ne peut, pour compléter ce tableau d’une ville occupée, passer sous silence la délation. Elle est inimaginable et de nombreux patriotes en sont les victimes. Le contrôleur principal Pollet est dénoncé par un de ses collègues a la Gestapo pour détention d’armes, ce qui est faux, il sera relâché après une perquisition et un sévère interrogatoire. Un cafetier de la rue de Paris fait arrêter seize patriotes. il fera deux ans de prison après la Libération.
En 1940, Emile Herve, prisonnier de guerre évadé d’un camp en France, originaire de Jersey, est arrêté à l’orée de la forêt par des agents auxquels il expose sa situation et son intention de se rendre chez son oncle Talhouët qui habite à Royallieu. À travers la ville, il est conduit à la Kommandantur qui lui fait naturellement prendre le chemin de l’Allemagne. Hervé s’évade une deuxième fois et parvient enfin à rejoindre les maquisards yougoslaves avec lesquels il reprend le combat. il est aujourd’hui à Saint-Servan 88 8 Récit de son oncle Jean Talhouët..
À Crespin, dans le Nord, où il est conseiller municipal, le Compiégnois Léon Strady, est arrêté en 1941 pour avoir hébergé des parachutistes alliés et aidé des Français et des Belges à gagner l’Angleterre. Bien qu’informe, il s’appuie sur deux béquilles, il est condamné une première fois à un mois de prison, une deuxième fois à six mois qu’il effectue à la citadelle de Huy, en Belgique, en compagnie d’une soixantaine de compatriotes jusqu’au jour où les nazis leur annoncent leur retour à Lille et leur prochaine libération. Ils reviennent effectivement à Lille, mais des leur arrivée à la citadelle, les Allemands les fusillent à l’endroit même où 28 ans plus tôt, en 1914, un autre Compiégnois, Eugène Jacquet, avait subi le même sort.
La destruction de la ville incite de nombreux habitants à s’installer dans les environs. Un sujet hollandais, Henri Seelen, qui avant la guerre était employé dans une boucherie chevaline, s’est réfugié dans un maisonnette appartenant à son employeur sise au Francport, charmant hameau situé sur la rive droite de l’0ise. Durant l’hiver de 1940, il y installe un bar moderne fréquenté essentiellement par les Allemands qui viennent y méditer face à une tête d’homme réduite et momifiée, selon des procédés dont les indiens Jivaros ont le secret et qui est exposée sous un globe très Louis-Philippard. Seelen est tout dévoué aux Allemands, il est un agent secret et il deviendra l’un des tortionnaires les plus odieux de la Gestapo de l’avenue Foch à Paris: ses crimes lui vaudront, ainsi qu’à sept autres complices, la peine de mort après la Libération.
Un cafetier de ses amis invite souvent Seelen, ainsi que les officiers de la Kommandantur, à chasser avec lui. À ma sortie de prison de Saint-Quentin. le débitant me fera demander de l’aller voir et voudra savoir si vraiment, «entre nous», j’étais dans la Résistance. J’affirmais évidemment être étranger à ce mouvement et je crois avoir bien fait.
Dans le tiroir de sa table de nuit, Seelen serre un revolver en permanence ce que Maurice Bredin, le fils de ses employeurs, n’ignore pas. Or en février 1942, Chassant en forêt, ce garçon voit un écureuil, prend l’arme et tire sur l’animal. Une sentinelle l’arrête et on l’interroge sur la provenance de l’arme. Seelen, interrogé à son tour, se défend de posséder un revolver et ne fait rien alors qu’il est bien en cour auprès des nazis pour sauver le jeune homme. L’enquête révèle que le jeune Bredin et ses amis Jacques Lamotte et Guy Quintel, tous âgés de 17 ans, ont constitué un stock d’armes dérobées dans un dépôt d’une cristallerie de la ville. Arrêtés et déportés, Bredin et Lamotte mourront à Buchenwald et Quintel apprendra à son retour que son frère a été pendu et son père abattu par les Allemands, en déportation. Lui-même, condamné à 30 ans de travaux forcés, a dû revêtir un costume spécial marqué d’une cible rouge le désignant à la vigilance des S.S. Evadé, repris, libéré par les Russes, il reprend le combat, est blessé, évacué sur Odessa et enfin rapatrié.
Le commissaire-priseur, Maître Giojuzza, revendait en cachette des vêtements aux maquisards, parmi lesquels Dumontois et ses hommes. L’officier ministériel est bientôt menacé de dénonciation s’il ne cesse ce genre de commerce.
La chaisière d’une église surprend un lycéen, Pierre Lesueur - aujourd’hui professeur détaché à l’U.N.E.S.C.O. - décorant de graffiti antinazis l’escalier du clocher, et s’empresse de le dénoncer. Les parents tenus responsables sont sévèrement réprimandés et menacés de sanctions par le commissaire de police.
Le 3 août 1943, Rolande Cottard-Strippe est arrêtée et le 9 août, Marguerite Blanc-Lemonnier l’est également, pour avoir fait passer le courrier des internes du camp. Toutes deux victimes de dénonciations seront détenues à Amiens, à Royallieu et déportées à Ravensbrück.
Au cours d’une perquisition opérée dans la maison de l’entrepreneur de peinture Millar, les Allemands trouvent un fusil et arrêtent le patron. lequel simulant la folie est dirigé sur l’asile de Clermont. Mais la, il apprend qu’il va perdre ses droits, li se ravise alors et redevient normal. Les psychiatres en conviennent et l’autorisent à partir. La Gestapo l’attendait à la porte de l’asile et Millar ira mourir à Buchenwald.
Le 7 novembre 1943. un boucher bien connu. Georges Gouigoux, qui fut conseiller municipal, est arrêté. Les services secrets allemands ont découvert son réseau composé de négociants en alimentation générale, dont l’objectif consiste à organiser des centres de ravitaillement clandestins destinés aux maquisards et mis en place pour le jour du débarquement. Déporté lui aussi à Buchenwald, on ne devait plus le revoir.
Au Château de Compiègne, la plupart des membres du personnel, y compris le conservateur, M. Vergnet-Ruis, sont arrêtés à la suite d’une dénonciation à la Gestapo, laquelle découvre la carabine de Napoléon III rouillée et une centaine de cartouches abandonnées en 1918. Après un dur interrogatoire. les prévenus sont remis en liberté, mais le dénonciateur, un gardien auxiliaire. n’y perdit que sa place.
Le 23 décembre, Pignard, qui distribue des tracts. victime lui aussi d’une dénonciation, est incarcéré, puis conduit à Royallieu en compagnie du jeune réfractaire Georges Tassart. Les deux frères Varé et Corroyer partent avec eux pour Buchenwald pour avoir, dans un café le soir du 24 décembre 1943, émis le désir de voir partir les Allemands. Un des frères Varé mourra en déportation, de même que les frères Raymond et Robert Leclèrc qui avaient constitué un stock d’armes clandestin. Dénoncés, ils étaient arrêtés le 3 mars 1944 sur les lieux de leur travail et déportés à Buchenwald le 4 juin, l’avant-veille du débarquement. Dans le même temps, l’aviation alliée qui largue d’innombrables rubans d’aluminium, des ’windows’, qui brouillent les écrans des radars ennemis, bombarde les objectifs stratégiques. Cependant une forteresse volante est abattue le 8 février 1944 vers 9 h 30 au cours d’un combat aérien et son équipage qui avait sauté en parachutes est fait prisonnier, sauf deux ou trois navigants qui trouvent refuge chez l’habitant. L’avion de bombardement s’écrase sur une maisonnette près de l’église de Chevincourt tuant trois personnes. Dans la rue, une jeune femme est décapitée, une cinquième victime, Mme Richez, horriblement brûlée, meurt à Compiègne après cinq semaines d’atroces souffrances.
Un mois plus tard, le 7 mars 1944, une escadrille alliée bombardait le grand dépôt de munitions de Saint-Léger-aux-Bois. De nombreux prisonniers soviétiques et indigènes coloniaux qui y travaillent sous la contrainte au mépris des conventions internationales et des civils français sont massacrés.
Le 17 juin 1944, le résistant Butin est abordé sur le Cours Guynemer par un jeune aviateur canadien, Edwin Campton, dont l’avion avait été abattu près de Condé-sur-Escaut et qui se rendait à pied à Paris où il savait trouver une organisation de rapatriement. Butin qui ne parle pas l’anglais pas plus que le Canadien n’entend le français, comprend immédiatement mais craignant les bavardages de ses huit enfants, emmène Campton chez le chauffeur de taxi Tridon qui s’empresse de l’héberger. Trois jours plus tard, l’aviateur, qui ne peut rester dans le voisinage des Allemands, est conduit par Butin chez Mme Vandevyer qui lui donne l’hospitalité trois semaines durant. Mme Louis, du réseau Résistance, dépêche l’hôtelier Morlière qui sert d’interprète et fait partir le Canadien à bicyclette, accompagne du jeune Marc boulanger, pour Gondreville où un avion doit le remmener en Angleterre. Mais la route est jonchée de clous semés par les résistants et lorsque les deux cyclistes arrivent au rendez-vous fixé, épuisés, les pneus crevés, l’avion est reparti. Après avoir été hébergé par les résistants, le Canadien est arrête, quelques jours plus tard, dans le métro à Paris au cours d’une rafle. Il est «interrogé» et expédié dans un camp de concentration en Allemagne où il sera libéré par les Russes, il était temps! Edwin Campton est heureusement rentré dans son Canada, à Winnipeg.
Quant à la délation, dont il faut bien reconnaître qu’elle a puissamment aidé les services secrets ennemis, et quant à la ’Propagandastaffel’ allemande ou vichyste, les tracts de la résistance, la presse clandestine, les envois de petits cercueils suggestifs et les émissions de la radio anglaise, brouillées par les crécelles nazies, les combattent de leur mieux. Des collaborateurs réputés sont victimes de leur trahison : un ingénieur de la manufacture d’allumettes de Saintines, négrier du S.T.O., est abattu et le directeur d’une usine de Verberie, autorisé au port d’armes par la Gestapo, saute en faisant démarrer sa voiture piégée. La leçon est entendue et lorsque Jean-Hérold Paqui tiendra sa conférence à Compiègne en juillet 1944, il ne verra que 37 auditeurs pour l’écouter, officiels et journalistes compris.
Secteur Est numéro 3
Si la rapide et anormale défaite de la France surprit le monde entier, elle stupéfia aussi un grand nombre de Français qui n’admirent jamais cette défaite. La propagande fasciste s’efforça de faire croire à la légèreté des jeunes à se battre pour la libération de leur Patrie, comme aujourd’hui encore elle les présente pervers et les accuse de tous les défauts. Ce sont pourtant ces jeunes-là, mûrs avant l’âge, -tel ce Compiégnois, le lieutenant Ducloux. qui se fait tuer plutôt que de se rendre-, qui en 1940 luttèrent avec courage contre l’envahisseur jusqu’à épuisement de leurs munitions, malgré leurs 92000 morts, et ils iront languir pendant cinq ans dans les Stalags d’Outre-Rhin.
Les patriotes, hommes et femmes, de toutes les couches de la société, jeunes compris, se réveillent dans un sursaut prodigieux. La classe ouvrière, toujours sensible lorsque le sort de la Patrie est en danger, entre immédiatement dans la lutte ; la bourgeoisie blessée dans son honneur par la défaite militaire relève le défi. La Résistance allait se manifester et par son activité désorganisera les moyens de communication de l’ennemi, attaquera ses soldats pour s’emparer de leurs armes, ses dépôts de munitions et lors du débarquement retiendra sept divisions allemandes à l’intérieur du territoire qui feront cruellement défaut à Rommel pour faire face aux troupes alliées.
À Compiègne, dès novembre 1940, regroupant les forces dispersées, les patriotes confectionnent des tracts portant les mots d’ordre qui appellent à la résistance et à la lutte contre l’oppresseur.
En ce mois de novembre et en décembre, je travaille au Francport et je déjeune avec deux artisans de mes amis, Delattre et Thué, au café de la Place, Je mets tant d’ardeur à démoraliser les clients allemands, sous-officiers et soldats, que le patron de l’établissement et mes amis m’incitent à plus de prudence.
En avril 1941, sous l’impulsion de Dumontois, militant syndicaliste, de l’ingénieur Jauneau qui confectionné des bombes et deviendra le responsable départemental des Francs-Tireurs et Partisans Français et avec l’instituteur Léveillé, responsable interrégional, des groupes de trois camarades se forment dans l’Oise sous le signe du triangle. À Noyon, parmi les pionniers, Drapier, Foulon, Jacquin, Massé, Urrier, Vermont, Vinoffe exécutent des sabotages, récupèrent les armes françaises abandonnées qu’ils stockent au Bois des Usages.
En juin 1941, à la côte de la Tombelle, Dumontois, protégé par son fils et Vermont, monte dans un camion circulant au ralenti et s’enfuit après y avoir déposé des bombes qui explosent à quelques kilomètres plus loin. Encouragés par la réussite de l’opération, ils la renouvelleront. À Compiègne, suivant les instructions reçues, l’organisation est aussi formée sous le signe du triangle, c’est-à-dire par équipe de trois camarades. Les Partisans collent des grandes étiquettes portant les mots d’ordre, écrivent sur les murs et les chaussées des slogans patriotiques, déplacent les plaques indicatrices inversant ainsi les directions et sabotent les lignes téléphoniques.
Mon camarade de régiment Leroy, de Royallieu, Lancel, de Saint-Léger-au-Bois et Drujeon, de Clairoix, assurent la liaison avec les groupes de Noyon et sont hébergés par Vermont, à Cambronne par Charlet et à Thourotte par Herman. Moi-même j’assure la liaison avec les groupes de Jaux et de ce secteur. Je suis reçu par Lequeux, un cheminot.
Le 7 juillet 1941, un de nos camarades de Noyon, Vinche, est arrêté puis déporté, mourra dans une chambre à gaz d’Auschwitz. Garnier, Leleu et Ver- mont chargés de travailler au camp d’aviation d’Amy y relèvent les plans, les dépôts de carburants et de munitions, les voies d’accès et les postes de sentinelles. Ils font évader des prisonniers de guerre qui y travaillent, leur donnent de l’argent. Le 5 octobre 1941, des 10 heures du matin, tout le dispositif d’un sabotage prévu pour la nuit était mis en place. Mais à 16 h 30. les gendarmes français arrêtent Drapier, Jacquin, Flury. Vermont, Quatrevaux ancien des corps francs qui porte une blessure à deux millimètres du cœur et succombera à Saugerhausen après trois ans de déportation et Roy qui sautera sur une mine placée autour de son camp. Cinq jours plus tard, le 10 octobre, la Gestapo arrête Drujeon à Clairoix lequel, comme la plupart de ses camarades, sera déporté à Buchenwald. Le démantèlement de notre organisation se fait douloureusement sentir. Le député d’Amiens, André Catelas, bien connu dans la région où il fut le créateur des groupes de F.T.P.F. dans l’Oise, héros mutilé de 1448, est, sur ordre de Pétain, guillotiné le 24 septembre 1941, en chantant la ’Marseillaise’.
À Creil, où les arrestations sont toujours nombreuses, Caron, Deneux, le seul responsable en relation avec l’organisation nationale, Gevert, puis Lemaire de Cuise-la-Motte du réseau ’Robert’ qui connaitra trois prisons et six camps de concentration, en sont les victimes.
Le jeune Bernard Laurent abat des officiers allemands, participe à des actes de sabotage sur la voie ferrée, est arrêté et transféré au camp de Royallieu, d’où il est relâché en octobre 1941. Repris le 22 février 1942 sur dénonciation, torturé, il ne parle pas et jugé avec 25 de ses camarades, il prend à son compte l’accusation portée sur un père de famille qui, de ce fait acquitté, lui doit la vie. Le 17 avril 1942 à Troissereux, vingt-trois patriotes, parmi lesquels Bernard Laurent et une mère de famille avec sa fille âgée de 18 ans, partent aux poteaux d’exécution en entonnant une formidable Marseillaise. Cyniques, les S.S. de Lammerding font durer la tuerie de 13 h 30 à 18 heures.
Les plus anciens des militants se griment, s’éloignent de leur domicile. Duvivier venant d’Amiens et Lancel coopèrent avec les camarades de Noyon et de Compiègne tandis que Dumontois et Léveillé se rendent dans la Somme. Les F.T.P. y déploient une grande activité. À Amiens, un des attentats les plus spectaculaires est bien celui du Réveillon de Noël 1942. Après une tentative infructueuse le 11 novembre, Emile Baheu et Michel Bridoux (qui seront déportés] déposent une bombe contre la vitrine du restaurant «Le Royal» transformé en Foyer du Soldat, le Soldatenheim. Jules Bridoux -abattu plus tard au Havre-, Lalou (déporté), Gisèle Dujardin et Petit (internes comme leurs amis à Royallieu) font le guet. Lemaire, qui sera fusillé à Amiens le 2 août 1943, met le feu à la mèche d’amadou avec sa cigarette et à 21 h 30, chacun étant rentré chez soi, le Soldatenheim sautait dans un fracas du tonnerre. Plus de cinquante morts. des blessés par dizaines, tous allemands.
À Amiens encore, Mignon de Montataire, responsable interdépartemental, Georges dit «Jo», René et Charly, un neveu du général Leclerc, procèdent a l’évasion d’un camarade de l’hôpital où il était en traitement. Transporté sur une civière, recouvert d’un drap, le «mort» s’enfuit avec ses complices dès son arrivée à la morgue.
Les femmes qui ne sont pas les moins actives sont chargées de la liaison, de l’hébergement et du ravitaillement des maquisards et mènent une propagande intense dans les «queues», font des collectes en faveur des détenus au nom de l’Union des Femmes Françaises. La secrétaire «Mireille» Leroy assure la liaison avec Jeanne Léveillé et Eugénie Germain chargées du tirage du journal «les Jeanne Hachette».
Au cours de l’automne 1941, ma femme et moi nous fûmes dans l’obligation de quitter la maison où, totalement sinistrés, nous étions réfugiés. Le conservateur du Bois de Boulogne, M. Demorlaine nous offrit l’hospitalité de sa villa inhabitée dans le but de la soustraire à la réquisition des troupes ennemies. Sa situation est idéale à 200 mètres de la forêt à l’angle aigu de deux artères, l’entrée principale en pan coupé donnant sur la rue Saint-Lazare, une autre, éloignée d’une vingtaine de mètres sur la rue de l’Aigle, conduit au garage. Avec ses beaux arbres et l’épaisse haie de troènes formant un agréable écran de verdure, l’immeuble devient bientôt le rendez-vous des agents de liaison de passage et des maquisards anonymes qui sont hébergés en toute quiétude. Les responsables Dumontois, Léveillé, Gass, Genest (venu d’Eure-et-Loir), ainsi que d’autres patriotes inconnus y tiennent des réunions clandestines. Il y a là aussi une jeune fille dite «Paulette» ou «Michèle» et qui n’est autre que «Lucette» de l’E.M. du colonel Rol-Tanguy et qui participera avec le colonel Fabien à la libération de Paris. Aujourd’hui mariée, Lucienne Fabre-Sébart habite à Creil. Paulette assure avec courage la liaison jusqu’à Noyon sur une bicyclette dont les pneus se devinent sous les bandelettes qui les entourent comme des momies.
Au cours d’une de ces réunions, je proposai en 1942 l’exécution d’un coup de main au camp de Royallieu, d’en libérer les détenus et de les armer. Mais il s’avéra que nous n’en avions pas les moyens, l’attaque exigeait des forces et un matériel considérables. Ce projet sera pourtant repris en 1944, et l’opération confiée au colonel Philinte devait être menée par des forces aériennes et terrestres venues d’Angleterre en liaison avec tous les groupes locaux de la résistance. Or, par suite du débarquement en Normandie où ces troupes furent engagées, le coup de main ne put avoir lieu.
Jeanne pour les uns, Louise pour d’autres -pseudonymes de ma femme- contacte les agents inconnus que nous devons héberger et dont les rendez-vous sont fixés pour la plupart à la grande poste. Le signe de reconnaissance consiste en la moitié d’une enveloppe déchirée en deux parties. remise à chacun auparavant, lesquelles réunies reconstituent une adresse imaginaire connue des intéressés. Ce n’est certes pas sans danger et le sort de toute une organisation se joue. Parfois aussi, l’inconnu attendu n’est pas au rendez-vous…
En 1942, Henri, pseudonyme de Maurice Genest, futur député d’Eure-et-Loire, me recommanda de faire sauter le barrage de Venette et les petits ponts du chemin de fer de la ligne de Paris. Comme je n’avais pu m’approvisionner en explosifs. Henri promit de m’en fournir lors de sa prochaine visite. Je ne le revis plus, il avait été arrêté, « piqué ›› comme on disait, près de Chantilly. Plus tard, incarcéré à la prison d’Amiens, il s’en échappera lors de l’opération Jéricho.
Le 15 mai 1942, le Front National est officiellement constitué et André Dumontois promu capitaine commandant le F.N. du Secteur Est numéro 3. L’organisation est plus rationnelle et chaque membre doit remplir un questionnaire très détaillé. Huit groupes de F.T.P.F. sont organisés militairement au sein du F.N. dans le département. À Creil-Montataire, les frères Boulanger, Coëne, Germain. Mignon et Quenon, responsable départemental, constituent l’état-major des détachements Valmy (région de Creil), Patrie (Chambly), Jeanne d’Arc (Beauvais), Fournival (Mouy), Bastia (Noyon), désorganisé à la suite des nombreuses arrestations, Les membres de ce détachement se retrouvent dans les groupes de combat Jacques Bonhomme (Saint-Just-en- Chaussée) sous le commandement de Jauneau, Marseillaise (Thourotte, Chevincourt) avec Norbert Hilger et le détachement Grand-Ferré (Compiègne, Verberie, Saintines) avec Donnat, Duru, Léger, Robin, Thomas.
Les partisans opèrent de nombreux vols de cartes d’identité, de ravitaillement, de permis de travail dans les mairies, mais jamais d’argent.
Foulon se met en contact avec les époux Saget qui hébergent des maquisards, puis avec les Salagnac et Massé qui créent des groupes à Thourotte, Pimprez et dans les villages voisins. Sa machine à écrire est le seul appareil technique avec lequel il reproduit tracts, journaux clandestins et mots d’ordre. En dépit des consignes strictes, Foulon héberge trois agents de liaison à la fois et en est sévèrement blâmé par la direction départementale. «Je ne pouvais tout de même pas les laisser dehors», dit-il. Evidemment. À la suite d’une alerte, Foulon emporte sa machine à écrire et rejoint le maquis tandis que les Allemands perquisitionnent chez lui. Il recevra, au cours d’un engagement, une rafale de mitraillette dans les jambes.
Mais pour remplacer ceux qui disparaissent, il faut recruter. Un actif résistant, l’adjudant Laffite, fait rentrer un ancien camarade de régiment, l’agent de police Flamand, dans le réseau F.N. dans lequel, avec ses collègues, il déploiera une grande activité.
Je recrute moi-même les adjudants Trognon, Salgues et ses deux fils Georges et Maurice. Des officiers sollicités se récusent. Un commandant de cavalerie me rétorque «ne pas vouloir s’occuper de celai» J’ai compris et me félicite de m’en tirer à si bon compte. À Lachelle, un brave ménage d’ouvriers, les Glise, accepte avec empressement de recevoir et de ravitailler généreusement les camarades de passage. Je recevrai plus tard l’adhésion de deux autres sous-officiers de Compiègne.
Salgues est fier d‘avoir mis au point un système de clous arrache-pneus dont la surprenante efficacité cause d’importants dégâts parmi le matériel roulant ennemi.
L’activité des F.T.P. est intense. Ils n’attendent pas le débarquement pour harceler l’ennemi puisqu’à la date du 6 juin 1944 on dénombre officiellement à leur actif 14 déraillements de trains allemands et les sabotages des voies ferrées à Estrées-Saint-Denis, Rémy, Vauchelles, Verberie, de nombreuses sections de poteaux et lignes téléphoniques et de haute tension, des participations aux parachutages de Noyon et de Crépy, les sabotages de l’acqueduc de Montmacq, le 30 avril 1943, de l’observatoire d’Attichy, le 9 mai 1943, de Cuvilly, des lignes de la Luftwaffe du Francport au Bourget et bien d’autres.
À leur actif aussi une dizaine d’attentats à la bombe et les incendies de locaux de la L.V.F., de la Feldgendarmerie à Compiègne et du camp d’aviation de Margny-lès-Compiègne en 1942, à Saint-Claude, Gournay, Saint-Sauveur, Longueil-Annel, Coudun, Cambronne, la récupération de tickets d’alimentation dans une dizaine de mairies, le sabotage des usines Haggers, travaillant pour les Allemands, et celui de la tannerie de Verberie. Le 26 mars 1943, attaque à main armée d’une patrouille allemande qui perd 3 tués en forêt de Compiègne, le 10 novembre, nouvelle attaque de patrouille au cours d’une action de sabotage des voies ferrées à Béthancourt où tombe le jeune lieutenant Clergeot, de Chevincourt.
À Pont-Sainte-Maxence, 12 wagons charges d’amiante et de charbon sautent le 21 août 1943.
Victime d’une odieuse trahison, le capitaine du F.N. Dumontois disparaît dans des conditions tragiques le 8 juillet 1943 à Paris. Son remplaçant, Norbert Hilger, éprouve les plus grandes difficultés à rétablir le contact avec les chefs des autres groupes de résistance qu’il ignore. Il découvre enfin une filière et réussit à s’entretenir avec le capitaine Lefèvre, du réseau Résistance, Martin, de l’O.C.M., le capitaine de gendarmerie Charnotet et Champion, inspecteur à la S.N.C.F., du Service Interallié de Renseignement, le S.I.R. Un ancien officier allemand, cassé en raison de son hostilité au régime hitlérien, fait connaître à Mme Heurteaux, membre également du S.I.R., les décisions militaires, les dates d’arrivée et de départ des détenus du camp de Royallieu. Ayant appris à la Kommandantur l’arrestation., projetée pour le soir même de plusieurs suspects, l’ancien officier accourt chez le journaliste Jean Mermet. En l’absence de celui-ci, Mme Mermet qui le reçoit aperçoit avec terreur les fausses cartes d’identité fabriquées par son mari. Le visiteur qui feint de ne rien voir se contente de donner l’alerte.
Dès son retour, Mermet et sa femme filaient à bicyclette prévenir des résistants de leurs amis. À la libération, Mme Heurteaux hébergera l’Allemand qui partira pour Londres ou, à la B.B.C., il incitera ses compatriotes à déserter et à se révolter contre Hitler.
Le 23 octobre, vers 3 heures du matin, tandis qu’un groupe de maquisards F.T.P. se repose dans la ferme que dirige avec sa mère Daniel Roelandt, à Lassigny, les gendarmes de la localité tendent une souricière autour de la propriété. Une voiture survient, conduite par un agent de la Gestapo venu rejoindre deux de ses collaborateurs déjà entrés dans la ferme. Les gendarmes le prennent pour un maquisard, s’en emparent et lui mettent les menottes qu’ils fixent au volant de sa propre voiture, en dépit de ses vociférations. Profitant de la confusion générale, les F.T.P. ont pu s‘échapper sauf trois, dont Roelandt qui, malgré les coups, ne dénoncera aucun de ses camarades. Après un séjour au camp de Royallieu, notre ami partira pour Buchenwald le 10 décembre 1943 d’où il est heureusement revenu en 1945.
Un sabotage des lignes ferroviaires à Cambronne le 14 septembre fait 7 blessés ennemis. Dans la nuit du 14 au 15 mars 1944, le feu est mis au dépôt de carburant de Clairoix où 1400000 litres d’essence s’élèvent en fumée. Le 13 mai, il est incendié de nouveau : 500000 litres du précieux carburant sont brûlés. Ces actions, incomplètes, s’intensifieront après le débarquement allié.
L’adjudant Serge Hocquart est chargé, en plus de ses responsabilités, de la liaison avec Pourceaux à Gournay-sur-Aronde, lequel transmet les messages à Londres. Son poste émetteur-récepteur est installé dans une de ses ruches alignées dans son jardin. Pourceaux reçoit aussi les agents alliés parachutés chargés du courrier. En passant devant sa maison, les Allemands, intrigues par une voiture qui leur paraît suspecte, fouillent les occupants sur lesquels ils trouvent un plan militaire. Au cours de la perquisition qui s’ensuit, ils découvrent des documents et le poste de radio clandestin. Les époux Pourceaux, après avoir subi le martyre et l’emprisonnement, sont déportés. Le mari sera abattu lors de l’évacuation du camp et sa femme reviendra mourir à Gournay peu de temps après sa libération.
C’est par son médecin, le docteur Renet, à Paris, que Mme Louis apprend, le 22 octobre 1942, l’existence d’un mouvement «Résistance». Avec enthousiasme, elle crée, avec son mari, un groupe à Compiègne. En avril 1943, 13 membres se réunissent chez le responsable Baduel sous la présidence du général en retraite de Joybert qui, en juillet, sera incarcéré près d’un mois à la prison de Saint-Quentin. Outre les époux Louis, il y a là le lieutenant Lefèvre, dit «Jules», qui succédera à Baduel (massacré), Cottin (tué à Soissons), l’israélite Moscovici -mort en déportation avec sa famille-, le professeur Lacroux, Signaux, Dijon.
Ce groupe assure la liaison avec le B.O.A., le Bureau des Opérations Aériennes, lorsqu’en septembre 1943, un avion de la R.A.F., au retour d’un bombardement sur Juvisy, tombe à Jonquières. Des cinq hommes de l’équipage français qui le composent, trois, des Corses, s’en échappent et sont recueillis par le fermier Penon, à Armancourt. Les autres passagers, d’Astier de la Vigerie, neveu d’Emmanuel, qui est grièvement blessé, et Godin sont faits prisonniers par les Allemands, qui, les croyant seuls, ne poursuivent par leurs investigations. Deux aviateurs sont transportés l’un après l’autre chez Louis. Quinze jours plus tard, le troisième, Luchesi, les rejoignait tranquillement à bicyclette sous l’escorte d’un résistant, Ferrand.
Dans l’obligation d’obtenir un permis de circulation pour déplacer ses trois hôtes, le 3 octobre, à la Bruyère. entre Liancourt et Catenoy, Louis s’en vint trouver l’ingénieur des Ponts et Chaussées Bouquerel, chargé de la délivrance de ces permis. «C’est pour y conduire des aviateurs tombés près d’ici, dit-il. Si c’est pour cela, je vous le donne immédiatement !», répondit sans hésiter l’ingénieur ravi. À la suite de ce premier contact, le lieutenant de réserve Bouquerel adhérait au mouvement «Résistance». Pris en charge par Mlle Henri de Bysien, les Corses regagnaient l’Angleterre par l’Espagne et, le 11 novembre 1943, de la B.B.C., faisaient connaître par un message laconique convenu, leur heureux retour de l’autre côté du détroit.
Quelques mois plus tard, lors de la fusion des groupes armés au sein des Forces Françaises de l’Intérieur -les F.F.I.- Coffignon, qui doit en assurer le commandement du Secteur Est, tombe gravement malade. Après sa mort, Bouquerel est désigné pour assumer désormais cette mission.
À Chevincourt, chez Hilger, les résistants lâchent des pigeons voyageurs qui regagnent l’Angleterre, porteurs de messages qui font connaître I’existence d’un grand dépôt de munitions à Ribécourt, aussitôt bombardé.
À Karoubi, de Ribécourt, conduit des parachutistes alliés chez Hilger à Chevincourt et, dans le secteur de Noyon, Dromas et Zanni, d’Ugny-le-Gay, mèneront à bien le rapatriement de 48 aviateurs alliés tombés dans la région et feront évader 16 prisonniers soviétiques.
Les membres de chaque réseau harcèlent l’ennemi, exécutent des vols de tickets d’alimentation avec ceux des autres organisations et cette heureuse coopération est à l’origine d’une certaine confusion. Les résistants se rencontrent dans des réunions communes et ignorent souvent l’appellation, le sigle du réseau auquel ils appartiennent, si bien que certains ont travaillé sans trop le savoir pour plusieurs organisations qui revendiquent les mêmes membres.
Le réseau Libération-Nord s’étend dans le département et le capitaine Maillard, de La Neuville-sous-Ressons, en assume le commandement militaire, il mourra le 8 octobre 1944 au camp de Flossenbourg. Les instituteurs sont nombreux dans ce réseau. Les époux Blin, de Méry-la-Bataille, qui seront tous deux déportés -le mari, Georges, ne reviendra pas de Flossenbourg-, Marcel Mérigonde et Raffoux, de Clairoix, déportés au Camp de Neuengamme, sont de ceux-là, ils recueillent des faisceaux de renseignements utiles. recherchent les points vulnérables de l’ennemi, assurent les liaisons avec les autres groupes clandestins et recrutent des volontaires pour l’action. Dans la région de Creil le député Biondi, Bataillard, Philippe et leurs amis tracent les plans du camp d’aviation, des dépôts d’armes et des entreprises industrielles qui seront sabotées et bombardées.
Malgré toutes les précautions prises, des traîtres, officiers français, s’infiltreront dans l’État-major même des réseaux et livreront à l’ennemi, pour de l’argent, un grand nombre de leurs compatriotes.
Une pénible affaire surgit à Noyon. Un groupe O.C.M. (Organisation Civile et Militaire) a pris naissance sous l’impulsion de l’industriel Brunet qui moud du gravier destiné aux saboteurs des essieux de wagons. Sur son duplicateur. il tire des tracts rédigés en allemand par Neff. Les entrepreneurs Brézillon -qui seront déportés en 1944- requis pour travailler pour les Allemands, disposent de ce fait d’un permis de circulation de jour comme de nuit pour leurs ouvriers. Ces entrepreneurs en profitent pour transporter les treize tonnes d’armement parachutées une première fois, le 20 juin 1943, de Crisolies à Saiency avec le responsable Domangé, une deuxième fois en août, de Varesnes à la cote 155 avec le responsable Lemaire et la dernière fois en septembre, du massif de Saint-Gobain dans une cache en forêt dont le responsable est Dromas.
Dans le premier parachutage, outre armes et munitions, il y a des produits sanitaires, des ampoules de Dagenau, introuvables en France, et une grosse somme d’argent, un kilo de chocolat et 94 boîtes de 50 cigarettes anglaises qui disparaissent par enchantement. Ce fut le début de cette pénible affaire.
L’industriel Brunet, ancien commandant d’active, qui considérait que son groupe était un des mieux organisés de son réseau, s’en vint à Compiègne en septembre 1943 dans le dessein d’établir la liaison avec les groupes de résistance. C’est ainsi qu’il prend contact avec celui de Mme Louis et avec plu- sieurs résistants de Compiègne et de Ribécourt dont l’ingénieur des Ponts et Chaussées Bouquerel et Karoubi.
Pourtant des scènes violentes éclatent dans le groupe de Brunet, provoquées par les bavardages et la vantardise de certains membres. L’un d’eux, écœuré, menace de passer aux F.T.P., provoquant la colère de deux autres partenaires qui veulent l’abattre ; fort heureusement, un sursis lui est accordé.
Brunet, qui a reçu 2000 ou 3000 fausses cartes d’identité, charge Fourrier de les distribuer aux intéressés. Ce dernier en fournira une vingtaine au F.T.F. Foulon, coupé de son organisation pendant un certain temps par suite de l’arrestation des agents de liaison, et qui ne pouvait plus s’en procurer. La signature du sous-préfet d’alors était parfaitement imitée par un ancien employé des P.T.T. Ce dernier, arrêté porteur d’un revolver, à Creil fin 1943, révéla aux Allemands, au cours de son interrogatoire, la cachette de Salency. Il n’y avait plus que des parachutes et des produits pharmaceutiques, les armes et les munitions ayant été enlevées à temps par Brunet et Foulon.
La femme de l’industriel est arrêtée, incarcérée à Compiègne et libérée après quelques jours de détention au début de 1944, cependant que le malaise qui couvait au sein de l’organisation éclate en scandale, chacun jetant la suspicion sur chacun. Comme l’argent et les cigarettes, 200 litres d’alcool disparaissent sans qu’il soit vraiment possible de déceler les auteurs du vol et c’est dans cette atmosphère que Brunet abandonne toute activité. il y a des trahisons. les calomnies se poursuivent, un résistant se suicide, des traîtres sont exécutés.
Néanmoins, la résistance sous la direction de Fourrier et naturellement la répression ne se ralentissent pas et de nombreux patriotes seront déportés en 1944 dont Bieuze, Delnef, Degroote, Depierre, Mercier, Philippon, le docteur Roos. Sailly, Willecocq. Déjà le 1 décembre 1943, Laranjo avait été arrêté a Morlincourt.
De leur côté les gouvernants de Vichy sont inquiets de la tournure que prennent les événements qui leur sont signalés dans les rapports des préfets. Celui de l’Oise fait connaître en octobre 1943 que «la population refuse de collaborer contre les partisans».
Heureusement!
Mais à la fin de la tourmente, les pertes auront été lourdes dans le Secteur Est : une quarantaine de résistants auront été tués ou massacrés. Des 400 hommes et femmes qui avaient été déportés, plus de la moitié succomba dans les camps de la mort. Une centaine d’autres furent internes dans les prisons ou dans les camps de France.
Baignade tragique et cheminots
Au début de janvier 1942, on retirait de l’Oise, au barrage de Venette, non loin du camp de Royallieu, le corps d’un soldat allemand. La Feldgandarmerie et la police française conclurent après enquête qu’il s’agissait sans aucun doute d’un accident ou d’un suicide.
Quelque temps plus tard, Dupressoir, un de nos camarades cheminots appartenant au F.N., me parla de cet incident. C’était le jour de Noël, vers 20 h 30, il faisait nuit lorsqu’il s’engagea sur le pont désert et cheminait sur la chaussée. Les trottoirs étaient interdits à la population française et réservés aux sentinelles allemandes; il croisa bientôt l’une d’elles qui se tenait le long du garde-fou.
Croisant l’homme botté et casque à mi-chemin des deux rives, Dupressoir. hanté par le mot d’ordre «à chacun le sien», fonça sur le soldat nazi en le poussant si violemment sur la poitrine qu’il le fit basculer par-dessus la balustrade et, l’empoignant par les jambes, accéléra la chute dans l’eau glacée. Surpris, engoncé dans sa capote, le soldat disparut sans jeter un cri dans les tourbillons de l’0ise que les nombreux pilotis de garde autour des piles de bois rendent impétueux en cet endroit.
Je restai stupéfait devant une telle audace. «Que veux-tu, me dit Dupressoir, c’était peut-être un brave type, un bon père de famille, mais si chacun de nous en faisait autant, il n’y en aurait pas pour tout le monde !» Le cheminot regagna ensuite son domicile à Margny-lès-Compiègne et n’en fit plus état Jusqu’à la Libération. Moi non plus!
Au cours de la nuit du 15 au 16 juillet 1944. un autre cheminot, âgé de 16 ans, Marlier, trompant la surveillance de ses gardiens, mettait le feu au dépôt d’essence de Clairoix qui brûla pendant plusieurs heures. Le jeune homme, arrêté peu après, ne dénoncera aucun de ses camarades complices.
Le personnel de la S.N.C.F., surveillé et doublé dans son travail par des cheminots allemands, renseignait la résistance sur le passage des trains ennemis à saboter, la formation des convois de déportés ordonnés par la Kreiskommandantur et sur leurs dates précises qui seront communiquées aux familles. Parmi cette magnifique phalange de patriotes 99 9 1500 cheminots furent fusillés. 12000 déportés, dont 3000 seulement sont revenus., il y a Leclercq qui succédera à Hilger -arrêté en 1944- à la direction du F.N., Dupressoir, son adjoint, Van der Kerken, Renard, lequel, chargé de l’entretien du matériel, graisse les essieux avec du gravier, Huet, de l’O.C.M., grand blessé de guerre, Guérin, agent de liaison du groupe Tempo de Résistance-Fer -déporté à Dachau- et le brave et infortuné Baduel, de Résistance, mas- sacré à la Kommandantur.
Le chef de gare Carpentier, doublé et surveillé par son homologue allemand Müller, accueille et renseigne les familles désemparées venues dans l’espoir de revoir une dernière fois leurs parents déportés.
C’est grâce à la perspicacité de ce chef de gare que l’agglomération compiégnoise échappera à une catastrophe épouvantable en août 1944, lorsqu’il apprendra la nature du chargement d’un train de munitions et de nitroglycérine stationné face à la gare. Conscient du danger, sans plus attendre, il le fait diriger sur Rémy dont la station est fort éloignée du village.
Un agent de liaison du réseau Hunter, le cheminot Dervillé, fait parvenir un message à Londres par son beau-frère Provençale, l’informant de la présence du train à Rémy et d’un autre à Rethondes, isolé en forêt de Compiègne. L’attaque est immédiate, le convoi et la gare de Rethondes sont pulvérisés, tandis qu’a Rémy, par un bel après-midi, le 2 août 1944, une escadrille de la R.A.F., composée de Canadiens, surgit en trombe. Le chef de gare de Rémy, Damiens et son employé, à cette heure où le trafic est nul, sont chez eux dans le village, tandis que dans la scierie, proche de la gare, une quarantaine de soldats allemands travaillent qui, l’alerte donnée, courent se réfugier sous les wagons dont ils ignorent le chargement.
Descendu à peu de distance du sol, un premier avion, suivi bientôt d’un deuxième, largue ses bombes sur l’objectif. L’expulsion est formidable et telle que le deuxième appareil est emporté dans une ascension terrifiante. il va s’écraser dans l’enceinte d’une ancienne distillerie où l’on découvrit le corps de l’infortuné pilote. Sur les lieux du bombardement régnait un affreux chaos. Une monstrueuse tranchée trahissait l’emplacement du convoi, de la gare et de la scierie pulvérisés. Les débris de rails et autres matériaux jonchaient le sol à plus de deux kilomètres à la ronde. Dans le village, portes, fenêtres. toitures étaient arrachées. maisonnettes et pans de murs écroulés. Un jeune garçon de 14 ans, Denis Coupelle. atteint en pleine poitrine. était littéralement fauché par un rail tandis qu’il courait se mettre à l’abri dans une tranchée du jardin de ses parents, à 800 mètres de l’explosion. Plus loin, dans les champs, près du cimetière non loin de l’église, on retrouvera des rails tordus de 12 mètres de long, emportés comme des fétus de paille.
L’enseignement de l’instituteur
Un charmant et intelligent garçon d’une haute culture, Edmond Léveillé, avait lutte ardemment contre cette guerre qu’il prévoyait avec lucidité. Membre de ce glorieux corps d’instituteurs qui considèrent que leur profession les engage au-delà de leur» charge, ce patriote s’imposa une attitude ayant la valeur d’un exemple et toute la force d’une action.
Fait prisonnier en 1940 au, cours de la débâcle, il s’évadait pour reprendre sa place à l’école qu’il aimait tant. Bientôt révoqué par le gouvernement de Vichy en raison de ses convictions républicaines. Léveillé ne pouvait supporter l’injure faite à sa patrie par la présence de l’envahisseur nazi sur son territoire et il fut un des créateurs du Front National dont il devint le représentant permanent départemental. On le voyait partout et sous son impulsion le F.N. devint le groupement le plus actif et le plus important du départe- ment. Sa responsabilité s’étendit à une zone interrégionale groupant les départements de l’Oise, de la Somme, Seine-Maritime. Eure. Eure-et-Loir et du Calvados. il courait de Paris à Chartres et à Amiens. du Havre à Soissons. établissant de solides ramifications dans cette partie du pays, participant à de nombreux attentats.
Les directives et les conseils qu’il exposait avec clarté lors de ses visites a Compiègne nous étaient précieux. il était hébergé la plupart du temps chez mon excellent camarade Jean Léveillé, son frère Puiné, parfois chez les Melchior, beaux-parents de ce dernier, plus rarement chez nous et chez Salgues, et enfin chez le cheminot Leclercq, à Margny-lès-Compiègne. Il ne manquait pas de rendre visite au receveur des Domaines Fraissinet, qu’il avait connu à Beauvais. lequel fut le principal fournisseur du réseau en timbres fiscaux qu’il etait difficile de se procurer en grande quantité pour la confection des fausses cartes d’identité. Devenu, après sollicitation de Léveille, membre du F.N., le receveur Fraissinet fut envoyé en mission à LaCroix-Saint-Ouen, auprès d’Osset «Léonard», lieutenant à l’État-major du Secteur, il s’y rendit et échappa de peu aux Allemands qui, furieux de ne pas trouver Osset qu’ils recherchaient, mettaient le feu à son domicile.
Léveillé, dit René. réorganisa le Secours Populaire Français dont l’aide fut précieuse aux déportés. aux internes. aux maquisards et à leurs familles dans le besoin. C‘est lui qui fut charge. en novembre 1943. de constituer le Comité Départemental de Libération Nationale qui groupa à ses débuts le F.N., les Radicaux, le P.C.F., la S.F.I.O., l’U.D. des Syndicats. l’U.F.F., la F.U.J.P., Libération. L’O.C.M. sollicitée refusa de s’y associer à l’époque. arguant de sa conception purement militaire de la lutte. mais s’y rallia par la suite ainsi que tous les mouvements de résistance.
Le 24 avril 1944. Edmond Lévelllé, fondateur du «Patriote de l’Oise». organe départemental du F.N. dont l’influence était incontestable -10000 exemplaires en 1944- était arrêté par la Gestapo dans des circonstances restées mystérieuses, au cours d’une mission qu’il effectuait à Amiens. Les Allemands le considéraient comme un patriote lucide et ardent, comme un chef et un «terroriste» dangereux.
Interrogé, torturé, il se tut, ne révélant dans les cris de souffrance ni les amis, ni les lieux que l’ennemi aurait eu tant d’intérêt à connaitre. Cela dura un mois et, le 25 mai 1944, par un jour radieux et beau comme l’espérance, les nazis l’assassinaient lâchement à Dugny, près d’Amiens, il avait 38 ans.
Dans la dernière lettre qu’il adressait à sa femme. Edmond Léveillé écrivait: «Je suis heureux, intégralement heureux de m’être engagé dans cette voie qui aura abrégé mon existence, mais qui l’aura tellement enrichie, que je n’aurais aucune hésitation, si j’avais à la recommencer.»
C’est ainsi que ce modeste fils du peuple est entré dans l’Histoire et dans la mort, comme un pur héros. L’exemple de cet instituteur sera donné aux générations futures qui apprendront que son sacrifice, comme celui de tant d’autres, leur ont assuré la liberté et la dignité. Nous perdions un chef. un ami très cher, quatre mois avant la Libération qu’il savait proche et pour laquelle il avait tout donné, entrevoyant lui aussi des lendemains qui chantent.
il repose aujourd‘hui au cimetière de Gouvieux, auprès de ses camarades F.T.F. assassinés eux aussi : Madje, Pierre Caquet, âgé de 17 ans, tué par la Gestapo sur son lit d’hôpital à Creil. Gilbert Thiébaut et André Corbier, Abattus, eux, par des gendarmes français au cours d’une ronde près de Laigneville, le 19 novembre 1943, ils avaient à peine 22 ans.
Bataillon de France
À Compiègne, où comme partout, l’esprit de la Résistance soulève la population, un groupe de patriotes. parmi lesquels l’ancien conseiller municipal et champion du monde d’escrime, Tainturier, crée le Bataillon de France dépendant du réseau Hector. Dans un local voisin de la gare, ils y rassemblent armes et munitions en vue des opérations futures.
L’un des membres du Bataillon de France. Bourson, au cours d’une visite à son ami Tony Ricoux, à Paris, se trouve en présence d’un certain Desoubrie, alias Jacques Duverger, qui l’enthousiasme par son élan et ses projets. Ce Duverger inspire la confiance, est audacieux, d’autant plus qu’il n’a rien à craindre, puisqu’il est un agent de l’ennemi muni de tous les ‘Ausweise’ nécessaires que lui fournit la Gestapo, il est jeune, portant beau, conduit des voitures puissantes et étale ostensiblement sur les banquettes des tracts anti-allemands. «Quand on est soldat, on fait la lutte ouvertement». dit-il, ce qui était pour le moins surprenant.
En février 1942, le faux Duverger, Desoubrie, rendait sa visite à Bourson à Compiègne et s’entretint de l’activité de son groupe, le félicita et demanda à en connaitre les membres. Bourson. confiant et imprudent, lui en remit la liste nominative et Desoubrie participa à leurs activités et au transport des armes afin de connaître personnellement les hommes.
Je le vis par hasard au cours de son séjour, tandis que je bavardais a l’an9le de l’Hôtel de Ville avec Toustou et Vandendriesche, deux amis de ma jeunesse. Desoubrie sortit alors précipitamment d’un café voisin d’où il nous observait, pour se mêler à la conversation. Souriant, il nous aborda, déclarant crânement : «Je reviens de Lassigny où j’ai vu les armes là-bas, ça marche bien, et maintenant je vais partir à Soissons !» J’étais stupéfait, je lui reprochai son imprudence devant moi, témoin susceptible de les dénoncer. «Non, dit-il, car le me doute bien que vous êtes des nôtres !». Je m’éloignai en recommandant aux deux amis d’être plus vigilants. Je ne devais plus les revoir.
L’instituteur Nicot, à qui je racontais le fait, m’assura qu’il s’agissait bien de Desoubrie et que je m’en étais bien sorti. Lui-même l’avait éconduit lorsque cet individu s’était présenté chez lui, à Boulogne-la-Grasse, de la part de Bourson, pour contrôler les armes qu’il détenait. Méfiant, perspicace. Nicot rétorqua qu’il n’avait pas d’armes et ne comprenait pas que Bourson l’ait chargé d’une telle démarche et se proposait de lui téléphoner pour obtenir des éclaircissements. Desoubrie le pria de n’en rien faire, revint rapidement à Compiègne et regagna Paris le surlendemain en promettant de revenir. Convaincu d’avoir affaire à un traître, Nicot vint à Compiègne et recommande à Bourson et à Toustou la nécessité urgente de le supprimer des son retour.
Mais il était trop tard, le lendemain 3 mars, les dix-sept membres dont Desoubrie possédait les adresses étaient arrêtés à six heures du matin et internes à Fresnes. Bourson, absent de Compiègne, craignait des représailles pour les siens et alla se livrer lui-même à la Gestapo. À Vez, le radio Woilez, de la Villeneuve, était aussi arrêté.
L’un d’eux, Fouquoire, simulant la folie, fut libéré quelques mois plus tard. Les autres membres, après treize mois d’emprisonnement, passèrent en jugement à Sarrebrück, Tainturier, Flandrin, Gandoin, les deux frères Heraude, Laville et Vandendriesche condamnés à mort, furent décapités à la hache a Cologne, le 7 decembre 1943. Deux également sont morts à Cologne : Béchon de diphtérie et Vervin de dysenterie, Bourson mourra d’une pneumonie le 17 décembre 1944. Toustou, épuisé, fut tué par un S.S. près de Chiwitz, le 1er mai 1945 sur la route, lors de l’évacuation du camp d’Oranienburg par les Allemands. Le lendemain, ses camarades du convoi étaient libérés par les Russes 1010 10 Le 29 novembre 1944 Bourson et Toustou qui, en raison de l’avance de l’armée soviétique,avaient quitté la forteresse de Sonnenberg, virent au camp d’Oranienhourg les deuxfrères Choquenet, originaires des environs de Compiègne, qui s’efforcèrent d’adoucir leur sort.. Rousselet, dont les nazis ont falsifié la date de naissance, il n’a que quinze ans et ils l’ont vieilli de deux ans, est condamné à huit années de réclusion puis libéré par les Américains. Deux jeunes gens, Clara et Elvire, sont morts en déportation. L’ancien conseiller municipal Claux, acquitté, porte officiellement disparu par les nazis à Sarrebrück au cours d’un bombardement aérien, est, en réalité, mort à Buchenwald auprès de deux amis qui ont assisté à sa fin. René Nicot est enfin revenu, rescapé de Dachau où il fut le secrétaire général du Comité Français du Camp à la Libération.
Le traître Desoubrie, sujet belge, âgé de 22 ans, était un militant du parti fasciste Rex. Coupable du démembrement de douze réseaux de résistance, il se flattait d’avoir causé la mort de trente-cinq patriotes. Son complice Grapin se targuait d’en avoir fait fusiller trente-neuf autres.
Les deux ignobles individus qui avaient depuis longtemps dénoncé des résistants, s’en vinrent un jour trouver le R.P. Riquet et, feignant le remords, lui demandèrent ce qu’ils pourraient faire pour être pardonnés. Le prêtre leur conseilla de racheter leurs fautes en prenant la place de leurs victimes, et de lutter avec lui dans son groupe de résistance. C’était inespéré. Les deux traîtres acceptèrent immédiatement et le dénonçaient à son tour ainsi que les autres membres de l’organisation qui, le 27 mai 1944, partaient pour Mauthausen, après un séjour au camp de Royallieu.
Ce jour-là, par rangs de cinq, un convoi particulier de plus de deux mille hommes descendait la rue de Paris. Les Compiégnois, cachés derrière leurs fenêtres, n’en croyaient pas leurs yeux: outre le R.P. Riquet, Zamanski, doyen de la Faculté, Me Arrighi, bâtonnier de Paris, Paul Picot et l’abbé Charpentier, de Chantilly, Chandezon, d’Orléans, actuellement directeur commercial a Compiègne, marchaient côté à côte des intendants généraux, des préfets et sous-préfets, des ecclésiastiques, des ouvriers en salopette, des officiers supérieurs et subalternes, des gendarmes et des douaniers, des gardes« forestiers et des cheminots qui s’adressaient les uns aux autres par leurs titres ou qualités qu’exigent les convenances!
Hélas! ils n’étaient déjà plus que des numéros.
Dès la Libération, Desoubrie se mettait au service des Alliés et les aidait dans la recherche des criminels de guerre, ses maîtres de la vaille, il avait abandonné son amie et ses deux enfants. Sa compagne, par vengeance, le dénonça à la police qui l’arrêta à Augsbourg le 10 mars 1945, tandis qu’il s’apprêtait à s’enfuir en Roumanie.
Condamné à mort, il fut fusillé à Beauvais, à l’issue d’un procès au cours duquel il ne cessa de narguer les juges et les familles de ses victimes.
Feux de joie d’un premier Mai
Le Front National avait recommandé de marquer le 1er mal 1942 par des exploits spectaculaires, que nos jeunes camarades eurent à cœur de célébrer eux-mêmes, en refusant notre participation.
Vers onze heures du soir, une meule de foin, requise par les Allemands, est incendiée par Claude Leroy et Jacques Bourgeois à proximité du camp de Royallieu. L’incendie gigantesque illumine le camp pendant des heures. Plus loin au Sud. vers Mercières, Lucien Thaye et André Langelez font flamber un grand hangar utilisé pour le ravitaillement de la Wehrmacht. Le local de la L.V.F. est l’objet de l’attention de Lucien Lesne et de Jacques Chevallier (mort en déportation), qui lancent leur bombe dans la vitrine du magasin d’alimentation réquisitionné qui déshonore la rue des Trois-Barbeaux au centre de la ville. Les locaux et leur contenu : littérature fasciste et mobilier, sont pulvérisés.
Les nazis furieux voient avec stupeur les hangars du camp d’aviation savamment camouflés, s’effondrer dans les brasiers immenses de l’incendie qui fait rage sur l’aérodrome qu’Hitler utilisa deux ans auparavant, lors de la signature de l’armistice, en 1940. Les jeunes F.T.P. forment deux groupes. L’un opérant au nord se compose de Norbert Barbier, Roger Visse et Etienne Drujeon, l’autre au sud, de Marcel Letort, René Grenier, Paul Pinel et du brave Robert Georgelin qui exige d’être présent dans tous les coups de main. L’attaque a été bien préparée. Le soir, avant de quitter les lieux, le personnel. composé de Dru, du gardien Ferreira (un Portugais), Franchomme, Pioche, prothésiste dentaire transformé en manœuvrier, avait coupé les amarres des bâches et des tentes camouflées.
À l’heure convenue, le dispositif Incendiaire mis en place est allumé, il consiste en plaques de phosphore reliées à de longues mèches d’amadou allumées simultanément. Le matériel est d’excellente qualité puisqu’il provient de la manufacture d’allumettes de Saintines où travaille le père de l’un d’eux, Marcel Chevallier, père de Jacques, ce qui facilite les choses. L’opération est rondement menée et, coupant les fils téléphoniques et tous les autres fils qu’ils aperçoivent, les saboteurs rentrent chez eux en toute quiétude.
Après plusieurs mois de recherches, l’enquête menée de pair par la Feldgendarmerie et les gendarmes français aboutit à l’arrestation de Bourgeois et de Leroy, le 14 août 1942. Le lendemain, Letort et Tournaux arrivent chez Georgelin à Venette et apprennent par sa mère que la Gestapo et la gendarmerie française venaient d’opérer une perquisition et recherchaient son fils. À Clairoix, Russel était également arrêté. Le 4 septembre 1942, Robert Georgelin et des camarades du maquis font dérailler un train à Sarron, mais à son retour, Georgelin croise sur la route des Allemands qui l’arrêtent et le fouillent. Trouvé en possession d’un revolver, Georgelin est frappé furieusement. Jeune et vigoureux, il leur échappe et, à travers les champs labourés, gagne le bois voisin, cependant que les nazis, essoufflés, mitraillent vainement le fugitif qui rejoint un maquis de la région. Le même jour, après quatre mois de recherches, la Gestapo arrêtait outre Chevallier, le père, Dutriaux à LaCroix-Saint-Ouen et tous les jeunes patriotes dont le benjamin avait seize ans, le plus vieux vingt-trois.
Tous ces jeunes gens s’étaient spécialisés dans le sabotage des lignes téléphoniques et des moyens de transport. Ils avaient en outre mis au point un procédé qui avait toute leur faveur: il consistait à lancer dans les wagons au passage des trains, des fragments de sodium, lesquels à l’air humide éclataient et incendiaient chargement et convoi. Détenus à la prison de Compiègne, jugés et condamnés à des peines sévères, ils furent transférés à Amiens et ensuite à la Centrale d’Eysses, participant à la téméraire rébellion qui leur valut à chacun des peines de plusieurs années de prison. En 1944, cruelle ironie, ils étaient internés au camp de Royallieu d’où la plupart d’entre eux partaient pour le sinistre camp de Dachau. Quatre d’entre eux manquaient à l’appel à leur retour : Bourgeois, Chevalier Fils, Pinel et Visse.
Robert Georgelin, porteur d’une fausse carte d’identité, arrêté peu de temps après son escapade, est incarcéré sous le faux nom qui lui a été attribué. La Gestapo ayant découvert la supercherie, il est condamné à mort, gracié en raison de son âge et, déporté à Buchenwald. Il fut tué par les S.S. lors de l’évacuation du camp devant la progression des armées alliées.
Comme Moïse, sauvé des eaux
S’il est impossible de citer les noms de tous les résistants chevronnés qui bravaient l’ennemi au plus fort de l’occupation, bien avant août 1944. certains ont droit à une attention particulière en raison des circonstances spéciales dont ils ont été, soit victimes, soit les acteurs, isolés ou non.
La répression était terrible et raffinée et dans le Secteur les arrestations des patriotes étaient fréquentes. Dans le groupe de Noyon qui compte à son actif de nombreux sabotages, missions de renseignements, évasions de prison- niers de guerre français et alliés, se trouvait Georges Garnier, décédé depuis, qui réussit à faire évader trente-deux détenus au camp d’aviation d’Amy.
Arrêté le 9 juillet 1941, il fut incarcéré à la prison de Compiègne, puis au camp de Royallieu jusqu’au 23 janvier 1943, date de son départ pour Buchenwald. Refoulé faute de place, les arrivées étant massives et trop récentes. la mort n’avait pas encore fait suffisamment de vides. Garnier était dirigé sur Oranienbourg, puis dans les environs de Berlin d’où il fut transféré dans l’effrayant camp d’extermination et de vivisection de Natzwilier-Strüthof, en Alsace. Après un séjour de quatre mois dans ce camp, en septembre 1944 la percée des armées alliées faillit délivrer tous les malheureux déportés de ce camp. Les nazis les transportèrent en toute hâte dans le nord de l’Allemagne et les attachèrent sur de vieux bateaux qui devaient être coulés dans la mer Baltique, en rade de Lübeck, afin de les y noyer. L’arrivée des troupes soviétiques les sauvèrent in extremis de cet horrible destin.
Emule de Moïse sauvé des eaux. notre ami Garnier, qui détenait un des records de la déportation, allait enfin rentrer chez lui. il revenait de loin. Mais sa santé était trop ébranlée. Il est mort le 14 mars 1964.
Vivre libres et combattre
Dans la soirée du 14 août 1942. Mireille Leroy. venant de Royallieu. accourait à la maison. Elle était accompagnée d’un inconnu que les Leroy devaient héberger ce soir-là, Son mari Albert vint la rejoindre une heure plus tard. Entre-temps, sa femme nous apprenait l’arrestation de son fils et d’un autre camarade. En raison de l’insécurité qu’offrait dorénavant son domicile, Leroy et l’inconnu nous chargèrent des consignes et des responsabilités qui incombaient jusqu’alors aux Leroy.
Les jours et les mois s’écoulèrent tandis qu’une quinzaine de nos jeunes camarades étaient toujours détenus à la Maison d’arrêt de la ville et cependant nous gardiens le contact avec eux. Dumontois, notre chef de groupe, m’ordonna de prendre les dispositions nécessaires pour les faire évader avec le minimum de participants. Quelques outils -des limes- purent être transmis aux prisonniers avec lesquels Deflers et Letort confectionnèrent des clés dans leurs cellules respectives. De mon côté, j’exposai à Trognon un plan que nous mîmes au point : nous irions au gymnase municipal prélever cordes à nœuds, échelles de corde et autres instruments jugés utiles et. en compagnie de Châtillon et Leroy, procéderions à l’évasion de nos jeunes amis.
Restait à fixer le jour J. Ordres et contre-ordres se succédèrent: enfin Leroy vint me faire connaître qu’une équipe belge, spécialisée dans le genre, était chargée d’exécuter l’évasion. Les jours passèrent sans que le projet se réalise pour des raisons que nous ignorions et nos camarades détenus furent dirigés à la prison d’Amiens. Nous sûmes plus tard qu’à la prison de Saint-Quentin un raid de ce genre avait échoué complètement et dont les conséquences furent désastreuses.
Nous étions consternés. J’avais confectionné dix-huit fausses cartes d’identité munies des timbres fiscaux nécessaires, seuls manquaient les photos et le cachet officiel attendus.
Nous avions obtenu la promesse de la propriétaire de la villa voisine. Mme Lombois, qu’elle tiendrait ouverte sa grande porte, ce qu’elle fit, facilitant l’évasion, en juin 1943, de Marius Dutriaux. Celui-ci s’enfuit par les gouttières en compagnie d’un jeune Rouennais et put atteindre la propriété contiguë en se servant des branchages du vieux lierre comme d’une échelle dressée fort à propos le long du mur. La Gestapo interrogea la dame âgée, la menaçant de la jeter en prison à son tour. mais elle, gardant son sang-froid, affirma n’être au courant de rien et être absolument étrangère à cette opération. Les nazis arrachèrent le lierre et la grande porte resta désormais fermée.
Quelques jours plus tard, je reçus l’ordre de me mettre en relations avec un ancien cafetier que je ne connaissais pas. Marquet. Le lieu de rendez-vous était fixé dans le chemin de la Plaine. Je m’y rendis en compagnie d’un agent de liaison qui venait d’arriver chez moi, porteur de renseignements et de pistolets. Marquet jouait d’une badine -signe de ralliement- en le croisant, je prononçais un vague mot de passe auquel il répondit et nous le suivîmes à travers bois pour atteindre son jardin. À Royallieu, dans le sous- soi de la maison, je retrouvai Dutriaux et son compagnon d’évasion ainsi que des jeunes gens affaires à scier du bois.
Je recommandai aux fugitifs de faire demander à leurs familles par des voies détournées, leurs photos d’identité et en attendant je confectionnai leurs fausses cartes avec de faux noms. Le 12 juillet, j’allais chercher les photographies mais, pris d’un étrange pressentiment, je les confiai, dans l’attente d’un cachet officiel, à la nièce de Lequeux, de Jaux, chez qui je me rendais fréquemment pour me procurer les instructions et les tracts qu’il recevait en dépôt.
Le surlendemain, dans la nuit du 14 au 15 juillet, j’étais «piqué» à mon tour, arrêté comme suspect. Un mois plus tard, relâché faute de preuves, je filais avec prudence rechercher ces photos, dont Lequeux ignorait les propriétaires, et je les collais sur leurs cartes. Rien n’y manquait: signature du préfet et cachet officiel confié pour quelques jours et que je serais dans une cachette aménagée dans la toiture d’un appentis.
Je rapportai les précieux documents aux évadés qui partaient le lendemain même et que nous ne devions plus revoir. Nous ignorons le sort du jeune Rouennais, mais nous sûmes ce qu’il advint de Marius Dutriaux. Courageux, il combattit dans les maquis de Normandie. Repris, «interrogé», il ne trahit personne. Enfin, un jour, en compagnie d’un de ses camarades du maquis, ils furent martyrisés jusqu’à ce que mort s’ensuive, près de Vimoutiers, dans l’Eure. On découvrit leurs corps sur les lieux du supplice désignés par les nazis au maire de la commune, qu’ils avaient chargé de leur sépulture. Par respect pour la conscience humaine, nous tairons l’atroce spectacle offert aux autorités locales.
Dutriaux laissait une veuve et deux orphelins. Sa femme, une Soviétique, eut la présence d’esprit, lors de l’arrestation de son mari, de détruire immédiatement les papiers compromettants parmi lesquels se trouvait une liste complète des noms de notre groupe que l’imprudent «Marius» avait établie en dépit des consignes formelles.
On juge du sort qui nous aurait été réservé.
Bon sang ne peut mentir
La jeunesse décriée a donné tant d’exemples de courage et d’abnégation, qu’elle force la fierté et l’hommage de la nation.
Un étudiant compiégnois, Charles Gand, fils d’un docteur en médecine, avait depuis longtemps formé le projet d’aller par delà l’Espagne, rallier les Forces Françaises Combattantes stationnées en Afrique du Nord et échapper ainsi au S.T.0. 1111 11 Service du Travail Obligatoire.. En septembre 1943, après son baccalauréat, le jeune homme s’en ouvrit à son père, lequel conduisit tout naturellement son valeureux fils, le 23 septembre, à la gare d’Austerlitz, à Paris, pour Rivesaltes. Une organisation clandestine des Pyrénées-Orientales. qui avait à son actif de nombreuses réussites, devait mettre le jeune patriote sur le chemin de Barcelone. Un inspecteur des Contributions directes avait recours aux avis et sommations de recouvrement d’impôts pour informer les réfractaires à le venir voir pour régler un prétendu contentieux. Ce subterfuge faisait connaître le jour et l’heure convenus pour le passage en Espagne.
L’organisation fut découverte et Charles, arrêté avec cinq compagnons de route, par la Gestapo à la frontière, fut incarcéré à la citadelle de Perpignan. Il subit trois interrogatoires au cours desquels, bien que battu, il éluda adroitement toutes les questions qui lui étaient posées.
Le 14 octobre 1943, au matin. il arrivait au camp de Royallieu et fit prévenir son père. Le 22 octobre, troisième anniversaire de la mort de sa mère, une courte entrevue eut lieu entre le père et le fils, au cours de laquelle ce dernier recommanda au docteur de ne pas s’inquiéter, ce qui était. disait-il, son seul souci. Un officier allemand s’approcha et s’adressa au jeune interné: «Vous avez voulu passer la frontière?» Dans un garde- à-vous impeccable. et le regardant bien en face, l’adolescent répondit: «Oui, j’ai voulu passer la frontière et je regrette de ne pas avoir réussi !», «Vous ne vouliez donc pas travailler pour nous !», «Non, je voulais aller servir mon pays !» L’officier ne broncha pas, il semblait interloqué devant une si courageuse réponse et s’éloigna.
Huit jours plus tard, le 29, Charles faisait ses adieux à son oncle, le commandant Guérin, interné lui aussi au camp, et partait avec un cran et un courage remarquables, par le troisième des quatre convois de la matinée, pour Buchenwald où son oncle ne tarda pas à le rejoindre. À son père qu’il aperçut rue de Harlay, non loin de la Tour millénaire, il cria: «À Dieu vat !» Ce fut ses dernières paroles. Transféré à Dora, il mourait en janvier 1944. Il avait 19 ans.
Son oncle le commandant Guérin est revenu de Buchenwald et son cousin. le capitaine Jacques Guérin. de sa déportation à Dachau. Un autre cousin, l’abbé Emile Lavallart fut massacré à Mauthausen en avril 1945. Son frère. André, engagé dans les Forces Françaises Libres, combattit en Allemagne. C’est au cours de ces dures années qu’il contracta une terrible maladie qui l’emporta cinq ans plus tard.
Il faisait le Jacques sur la moto
Dans le sous-sol de la maison de Marquet. parmi les «planqués» qui s’y trouvaient, j’avais remarqué Jacques Deflers, alors âgé de 17 ans, récemment libéré de prison par les Allemands.
Le jeune homme avait échoué, près de la frontière, dans sa tentative de rejoindre les F.F.L. en Angleterre en passant par l’Espagne et après maintes péripéties était revenu à Compiègne. À son retour, avec un camarade, ils collent sur les panneaux officiels de la mairie et de la Kreiskommandantur des tracts trouvés en forêt et largués par la R.A.F., rédigés en français et en allemand, dont ils reproduisent les slogans sur les murs et sur les routes. Dans un communiqué officiel le commissaire de police flétrit les jeunes irresponsables de ces actes, mais cette note menaçante reste sans effet.
Un soir, Jacques s’empare au nez et à la barbe de la sentinelle postée devant l’immeuble opposé, d’une belle motocyclette de l’armée allemande qu’il avait repérée dans le garage de la Kommandantur. Pendant six mois elle lui servit pour se rendre à son travail ou pour aller admirer les frondaisons de la forêt.
Arrêté passant devant la Kommandantur, Deflers démarre en trombe et échappe aux gendarmes nazis jusqu’au jour où, faisant admirer à un ami sa belle acquisition qu’il entretenait avec amour, il était mécanicien, un officier lui mit la main sur l’épaule et l’arrêta. Cette plaisanterie lui valut 9 mois de prison que les Allemands réduisirent à 6 mois en raison de sa bonne conduite et de sa jeunesse.
Reprenant sa place dans la résistance, l’audacieux Jacques participera au parachutage de Champlieu et, victime de la trahison. sera arrêté le 12 octobre 1943, incarcéré à Saint-Quentin et déporté à Buchenwald d’où il sera libéré en 1945.
Quand les armes tombent du ciel
Les armes si précieuses faisaient défaut. La plupart de celles-ci avaient été remises sur ordre à la Kommandantur et les réserves de munitions s’amenuisaient sensiblement en dépit des inlassables et pressantes demandes adressées à Londres, où le B.C.R.A. 1212 12 Bureau Central de Renseignements et d’Action. ne paraissait nullement empressé à les satisfaire. Cependant, en Angleterre, un homme. Thomas Cadett, avait depuis longtemps compris l’intérêt d’armer les groupes de résistance sur le sol de France qui représentaient à ses yeux une force considérable. Cet homme et le colonel Buckmaster admirablement secondé par le commandant Buddington. créaient en décembre 1940, malgré toutes les difficultés qu’ils rencontrèrent la S.O.E., Section des Opérations Extérieures, avec une ‘French Section’, une section française dont Buckmaster fut le chef à Londres.
Les débuts de cette organisation furent pénibles et laborieux, la S.O.E. ne disposant que de trois avions bimoteurs et de trois vedettes rapides, mais devant la ténacité toute britannique du colonel Buckmaster et les remarquables exploits de la résistance, le Haut Commandement Allié accordait enfin l’appui le plus total à cette S.O.E. au point qu’en juin 1944 elle put accomplir 95 missions en France. C’est grâce à ces missions que les F.F.C. recevaient des ordres des organismes de Londres et que de nombreux réseaux A.S., F.T.P.F., O.R.A., et Résistance-Fer purent bénéficier des parachutages et surent s’en servir. Toutefois, un ordre formel de Londres stipulait que la distribution des armes ne devait être effectuée que peu de temps avant le jour J du débarquement.
Une magnifique phalange d’agents secrets de l’Intelligence Service’ et de la résistance purent ainsi établir le contact entre les iles Britanniques et le Continent et créer le Réseau Jean-Marie, dont les cinq groupes de Compiègne, sous la responsabilité d’un jeune homme de 19 ans, André Pons. Baduel, Dumontois, Gass et Laffite se joignirent à ce mouvement.
Au cours d’une mission à Paris auprès du colonel Frager, un des chefs du réseau Jean-Marie, le cheminot Baduel entra en relation avec le lieutenant Bardet, dit Raoul, qui témoignait d’une expérience approfondie et d’une audace combative d’autant plus téméraire qu’il était au service des nazis et aux ordres du fameux agent secret allemand Hugo Bleicher, pseudo Monsieur Jean pour les Français et l’Oberst -le colonel- Henri pour ses compatriotes. Bardet conquit la confiance d’Andre Baduel en lui communiquant des renseignements que la B.B.C.1313 13 British Broadcasting Corporation. confirmait par des messages en code diffuses de Londres. Il fut, au cours de leur réunion, présenté à Ogé du réseau Résistance, lequel conquis à son tour, enfreignant les ordres formels, l’amena chez Destrée, un des principaux responsables du réseau. Cependant. certains faits inquiétèrent Pons et le groupe des Compiégnois à un point tel, que le doute sur la présence d’un traître au moins planait si lourdement, qu’il fut question de supprimer quatre membres douteux dont Bardet et l’intègre Frager.
Au début de juin 1943, le groupe reçut l’assurance d’un prochain parachutage et fut instruit du message et des coordonnées convenus entre les officiers anglais et le réseau Jean-Marie quant à l’aire de largage, rue Biscuit 1414 14 Aujourd’hui nomée rue Édouard Dubloc à Compiègne dans la pension Carnot tenue par Mme Boissonnet, les responsables s’affairaient. Située presque en face de la sortie de la cour de la Kommandantur, les chambres étaient occupées non seulement par Laffite, ses amis de passage, Dumontois et son inséparable Gass et un officier du B.O.A. chargé des parachutages, mais aussi par les officiers nazis de la Kommandantur qui entretenaient les meilleures relations de voisinage. Les réunions des responsables se tenaient dans la salle à manger présidées par la propriétaire. Une de ses amies, Adrienne Blanchard assurait le rôle d’agent de liaison.
Bientôt un message laconique: «Les rondelles de saucisson s’arrosent de vin blanc» diffusé par la B.B.C. fut capté, confirmant l’opération prévue vers minuit, le soir de la Pentecôte au cours de la nuit du 13 au 14 juin, non loin des ruines romaines de Champlieu, à l’orée de la forêt de Compiègne. Pons donna des instructions à ses hommes qui, en ce jour de fête, ralliaient à bicyclette et par petits groupes l’emplacement déterminé dont le point avait été fait par le capitaine d’infanterie en retraite Maïnetti.
Ils étaient dix-huit, munis de fortes lampes électriques, échelonnés sur le périmètre du terrain, émettant des signaux clignotants convenus, lorsque dans le lointain ils entendirent, le cœur battant, le ronronnement du moteur de l’avion ami se dirigeant vers eux, se rapprochant de plus en plus et qui exécuta plusieurs tours de reconnaissance avant de larguer sa lourde et précieuse cargaison. Chacun se précipita, trancha les cordages des immenses parachutes qu’ils devaient enterrer, tandis que l’avion repartait vers l’Angle- terre. Les containers en plastic, rassemblés et cachés, restèrent sous la garde jalouse de Dumontois qui promit à ses camarades de l’assurer seul jusqu’à ce qu’ils reviennent pour le transport. À l’aube, Baduel accompagné de Bardet venaient le rejoindre.
Chaque container pesait une centaine de kilos et contenait lui-même trois petits fûts métalliques remplis d’armes et de munitions. Le lendemain le tout fut chargé et transporté dans le camion de Rossi. Pons et Dumontois étaient sur le siège, Picq et Tedeschi étant à l’intérieur. Le camion demeura en stationnement devant la porte de Rossi une journée entière et fut conduit aux Fonderies de l’Oise pour y brûler les containers encombrants et dont les flammes immenses et la fumée épaisse qui s’en dégageaient inquiétèrent Pons et le directeur, M. Leyondre. L’inventaire fut dressé aussitôt. Baduel. Cottin, entre autres, y procédèrent, aidés en cela par Bardet, à la suite de quoi le jeune Georges Salgues remporta (sur la remorque de sa bicyclette) la belle mitraillette qui lui était allouée.
Le jour suivant, le jeune Michel Picq ayant auprès de lui Fons, emportait dans la camionnette de son père, maraîcher, une partie de l’armement à la Faisanderie. Aidés de Camus, de Dumontois et de Gass, ils en déposèrent une autre partie dans les remises de la pension Carnot, à quelques mètres de la Kommandantur.
La chance les favorisa au cours d’un troisième transport, mais la camion-
nette se heurta à un barrage de gendarmes français dressés au carrefour
des rues d’Amiens et de Noyon. Vérifiant les papiers de Picq, le brigadier
ne fit pas d’observation concernant l’absence du permis de conduire
de Picq, il n’avait que dix-sept ans, il se contenta de recommander sérieusement
le nettoyage de la plaque minéralogique recouverte de poussière. Les
gendarmes se montrant peu soucieux de soulever la bâche et de vérifier la
cargaison, Pons et Picq poursuivaient leur route en direction de Cambronne-les-Ribécourt
où Dumontois et Gass les attendaient chez Charlet pour procéder
au déchargement de la précieuse cargaison
1515
15
Le surlendemaim, Charlet recevait la visite de son ami Clergeot: - «Tu as été dans le bols. lui dit ce dernier. – Oui. tu m’as vu? - Non, mais tu as creusé un trou! - Quel trou? - Un trou dans lequel tu as caché des armes et des munitions. J’ai voulu savoir ce qu’il y avait sous la terre fraîchement remuée, j’ai creusé et je les ai trouvées bien enveloppées dans un papier d’emballage, portant encore ton nom et ton adresse. Tu te rends compte ?»
Quatre mois plus tard, l’officier F.T.P. Clergeot tombait au cours d’un accrochage.
Le dépôt constitué dans les remises de la pension Carnot représentait un arsenal impressionnant d’armes de toutes sortes et d’explosifs qui n’étaient pas sans inquiéter Mme Boissonnet, que la présence des officiers allemands parmi ses pensionnaires engageait à plus de prudence. Afin de la rassurer, Laffite, Dumontois et Gass profitant de son absence l’après-midi d’un dimanche, cachèrent le stock à son insu dans une ancienne fosse désaffectée située sous l’immeuble et ayant une issue dans un angle de la cour et recouverte d’une lourde dalle. La propriétaire, rassurée, convaincue qu’elle était de l’enlèvement du stock, continua à vivre, comme ses pensionnaires, dans l’ignorance et en toute quiétude, sur un volcan capable de faire sauter tout le quartier.
Le ’Supreme Headquarter’ avait été généreux et promettait de l’être encore bientôt.
Trahison
Un deuxième parachutage attendu pour le 13 juillet ne put avoir lieu, en raison des nombreuses arrestations provoquées par la trahison des officiers français agents de l’ennemi, infiltrés dans les réseaux et même jusque dans les états-majors mis en confiance par la présence des officiers anglais du ’War Office’ qui, dupes également, les accompagnaient.
Le 6 juillet 1943 la Gestapo faisait irruption dans la pension Carnot et mettait en état d’arrestation la directrice Mme Boissonnet, Laffite, un cama- rade de Rouen qui venait d’abattre un officier nazi, et Gass porteur d’armes et d’explosifs. Conduits à la Kommandantur voisine, leur apparition fit sensation parmi les officiers nazis qui les côtoyaient tous les jours avec confiance et se chargèrent de leur «interrogatoire». Mme Boissonnet fut maltraités, abreuvée de toutes les injures, bombardée de tomates qui s’écrasaient sur son visage, Laffite et le Rouennais roués de coups. L’infortuné Gass, le visage tuméfié, ensanglanté, démesurément enflé, renvoyé à coups de poings de l’un à l’autre de ses tortionnaires, étaient devenu méconnaissable. Transporté en compagnie de Mme Boissonnet au domicile de Dumontois à Noyon, pour une confrontation avec sa femme et ses enfants, ces derniers ne les reconnurent pas tout d’abord et assurèrent ne pas les connaître, ni même les avoir déjà vus. Les détenus ne dénoncèrent aucun des camarades, ni ne révélèrent l’existence de la cachette d’armes que les nazis ne découvrirent que longtemps après, au cours d’une perquisition méticuleuse.
D’abord détenus quelques jours à la prison de Compiègne puis conduits à Saint-Quentin auprès de la Gestapo chargée de l’affaire, les quatre incarcérés furent transférés à Fresnes, Romainville puis Forbach. De là, Mme Boissonnet était déportée à Ravensbrück et Charles Gass à Buchenwald où il mourra.
Le 8 juillet, André Dumontois était arrêté à Paris et disparaissait dans des conditions tragiques, comme André Baduel, lui-même appréhendé par les Schupos en gare de Compiègne le 12, quatre jours plus tard.
Le surlendemain, Pons répondant à la convocation du colonel Frager, partait pour Paris dans le courant de l’après-midi, en compagnie de deux amis. Pons qui suspectait, à la suite des récentes arrestations, la présence d’un traître parmi la liaison, se proposait de demander au colonel le retrait de tous les agents et leur remplacement par un seul en lequel il avait toute confiance, Ptchelintseff, il fallait également prévoir un autre parachutage sur un autre terrain et substituer un message différent à celui qui était prévu. il voulait aussi être assuré que le maquis de l’Yonne était toujours le secteur de repli de son groupe.
Pendant son séjour à Paris, Pons apprenait qu’une nouvelle vague d’arrestation venait de déferler sur Compiègne. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 1943, vers deux heures du matin, la Gestapo venue pour l’arrêter emmène son frère Robert, - arrestation qu’on lui cachera -, ainsi que Desseaux, âgé de dix-sept ans, qui avait participé au parachutage, Pigot, Pioche et moi-même. Pons, le père, sera incarcéré huit jours durant. Quelques jours plus tard, l’étudiant parisien Renard. dit le Bouc en raison de la barbe qu’il portait. était arrêté dans la pension Carnot où il venait aux renseignements et qui était transformée en souricière. L’agent de liaison Adrienne Blanchard était également appréhendée, puis Camus et Cotterets qui mourront en déportation, Deflers, Mousset, Picq et Rossi identifiés par Bardet lors du parachutage. À Paris ce sont le colonel Frager, Ogé, le docteur Renet dit Destrée, Odette et Peter Churchill, envoyés en mission en France, et des centaines de résistants qui sont les victimes de la trahison.
Les traîtres Bardet et Kieffer, comme ces officiers français qui venaient de livrer le général Delaistraint pour 10000 francs, avaient bien travaillé. Traduits devant un conseil de guerre après la Libération. Ils furent condamnés à mort, mais nul ne sait s’ils furent exécutés.
Leur chef, l’agent secret allemand Hugo Bleicher, retrouvé en Allemagne après la victoire, fut détenu quelques années en Angleterre. Son amie et complice Suzanne Laurent condamnée en 1946 à trois ans de prison, à la confiscation de ses biens et à 100000 francs d’amendes se proposait de s’installer ensuite en Argentine ou aux Etats-Unis pour y oublier le passé.
Martyre de BADUEL
Le cheminot André Baduel, pseudo Jean, avait trente-cinq ans. Il était le chef d’un groupe du réseau Résistance lorsqu’il fut arrêté par les Schupos en gare de Compiègne le 12 juillet 1943.
Baduel, conduit à la Kommandantur, y subit un interrogatoire des plus odieux au cours duquel, malgré les coups et les tortures les plus raffinées et hurlant de douleur, il ne livra aucun de ses secrets. Pas plus que sa femme et sa fille «interrogées» elles-mêmes dans une pièce voisine, horrifiées par les échos de l’affreuse tragédie qui se déroulait auprès d’elles, ne firent connaître les précieux renseignements qu’elles détenaient. Son martyre dura une journée et une nuit entière à l’issue de laquelle à la veille de notre fête nationale, ce fut le silence. Un camion fila vers la route de Paris. Aucun doute, les tortionnaires transportaient la dépouille mortelle de Baduel en forêt, peut-être dans un lieu qui devait rester ignoré. Après la libération, l’interprète de la Kommandantur Munsch, retrouvé à Metz et interrogé, avait affirmé ne pas avoir été témoin du drame mais que Baduel était vraisemblablement mort des suites de son martyre. Il ignorait le lieu de la sépulture.
Pendant vingt-trois ans, opiniâtrement, la fille de Baduel, devenue Mme Cailleux multiplia démarches et recherches dans les bureaux et les cimetières et dans la forêt de Compiègne. En vain. En juin 1964, la découverte des cendres présumées de Jean Moulin au cimetière du Père-Lachaise à Paris l’assaillit d’un étrange pressentiment et elle se persuada que les restes de son père s’y trouvaient également. Le 11 juin 1966, Mme Cailleux accompagnée de son mari et de sa fille aînée partait pour Paris. Une demi-heure d’investigations au Columbarium, parmi les niches fleuries des résistants incinérés, suffit pour récompenser la piété filiale: la fille du martyr, bouleversée, découvrait, sous le N3965, une plaque de marbre : BADUEL André, incinéré le 23-7-43.
Mais que s’est-il passé du 13 juillet date présumée de la mort du martyr au 23, celle de l’incinération? On peut supposer que le malheureux garçon, évanoui, aurait été transporté d’urgence au Sicherheitsdienst qui le réclamait afin d’extorquer ses secrets par des moyens qu’il jugeait efficaces, dès la syncope terminée.
La non plus Baduel n’aurait pas «parlé» et les résistants locaux qu’il connaissait pour la plupart, ils étaient moins nombreux qu’en septembre 1944, ne peuvent pas l’oublier.
Quant à la négligence des services intéressés informés par la conservation du cimetière du Père-Lachaise et qui ont omis de transmettre soit à la famille, soit aux services de l’état-civil document ou procès-verbal, elle est inconcevable.
Les cendres d’A. Baduel reposent aujourd’hui à Compiègne.
14 Juillet tricolore
Quelle ne fut pas la surprise des malheureux internes de Royallieu et leur joie partagées par les Compiégnois, de voir flotter au sommet d’une usine voisine, nos trois couleurs comme le symbole d’un peuple fier en ce jour du 14 juillet 1943. il avait fallu une audace extraordinaire et une adresse peu communes aux auteurs de cet exploit, pour le réaliser de nuit. Notre glorieux drapeau flotta plusieurs jours, défiant l’occupant furieux qui ne cessait de donner des ordres d’amener nos trois couleurs, que personne ne voulait ni ne pouvait aller chercher. il était immense et visible très loin à la ronde et il fallut pour l’amener avoir recours à un matériel spécial et à l’aide d’ouvriers requis. les volontaires faisant défaut. Cette démonstration avait renforcé le moral de la population et provoqué la colère de la Gestapo.
Peu de temps avant son arrestation, Dumontois m’avait recommandé de fleurir les monuments aux Morts et de pavoiser partout où ce serait possible dans une harmonie tricolore. Mais les drapeaux étaient rares dans notre région dévastée et le 14 juillet risquait de passer inaperçu. La veille de notre fête nationale j’allai trouver un ami de notre groupe, l’adjudant Salgues à Royallieu, et lui exprimai mes craintes de ne pouvoir trouver un drapeau à exhiber près du camp. Enthousiaste, Salgues me tranquillisa: «J’ai ce qu’il faut, je m’en charge avec les deux garçons, et cette nuit, nous en accrocherons un sur les fils électriques en travers de la route de Paris. Compte sur moi !» Puis m’entraînant vers son clapier, si nécessaire à l’époque, il en sortit une magnifique mitraillette fraîchement parachutée, une merveille que je voulus emporter. Comme il s’y opposait fermement, je lui recommandai de ne pas la laisser à cet endroit que je considérais comme peu sur en cas de perquisition.
Son refus fut plutôt assez heureux, j’étais arrêté la nuit du lendemain. Quant à notre drapeau. il flottait comme promis en travers de la route nationale où chacun venait le saluer en manifestant une joie ironique. Pour ne pas être en reste, je fis comme tout le monde; les Feldgendarmen, les officiers nazis hurlaient des ordres aux autorités locales impuissantes et aux spectateurs narquois. Le drapeau flottait toujours et il fallut faire appel aux pompiers, lesquels munis d’une grande échelle automobile eurent toutes les peines du monde et peu d’enthousiasme à le décrocher et à dérouler les cordages qui enserraient les fils en un volumineux toron. Salgues et ses fils avaient parfaitement réussi leur mission, notre emblème national avait flotte une grande partie de la journée.
De plus, j’avais fleuri le monument aux Morts de la ville d’un bouquet de fleurs tricolores: bleuets, marguerites et coquelicots cueillis dans les ruines, qui furent promptement enlevées, comme les agents de police bienveillants m’en avaient amicalement averti.
Nos trois couleurs étaient un emblème séditieux.
Un fameux capitaine: André Dumontois
Parmi les héros de cette guerre secrète. André Dumontois est bien un des plus ignorés et pourtant des plus courageux de la résistance nationale. Communiste, originaire de Tracy-le-Mont situe à dix kilomètres de Compiègne. à mi-chemin de Noyon qu’il habitait depuis peu avec sa famille, c’était un gars du bâtiment.
Dumontois fut le créateur des premiers groupes de F.T.P. qu’il anima de toute son intelligence et de son courage reconnu par tous ses camarades et ses ennemis. Promu capitaine, il devint le chef du F.N. du Secteur Est N3 de l’Oise. Déjà à Noyon, avec son fils René, un gosse de douze ans. au début de l’occupation en 1940. Ils récupéraient armes et munitions abandonnées par l’armée française sur le cours Druon et avec l’aide de Charlet. Gass, Lesur et Vermont constituaient cinq dépôts d’armes chez chacun d’eux. au moulin de Pont-l’Évêque et dans un hangar voisin. L’un de ces dépôts était un véritable arsenal: un mortier français de 81, un canon antichars monté sur pneus, des caisses de munitions, de bandes de mitrailleuses. grenades, détonateurs, cordon Bickford, obus et fusils-mitrailleurs.

En 1941, Leroy vint me présenter Dumontois sous le pseudonyme de Lucien (le mien étant Maurice), cependant qu’il était pour d’autres Jean de Noyon et pour la Gestapo, Tudor. Celle-ci, mai informée, se rend pour l’arrêter à son ancien domicile de Tracy en juillet 1941. Un voisin de ses amis file à bicyclette à Noyon l’en avertir. En grande hâte, Dumontois emporte quelques affaires personnelles, s’enfuit par le jardin au moment-même où la Gestapo pénètre dans la maison, et il va se réfugier à Villers-Bretonneux près d’Amiens, d’où il enverra ses directives à René, son fils, devenu agent de liaison. Le jeune René prend goût à ce nouveau genre de vie et va se révéler un actif résistant, comme son père.
En juillet 1942, au hameau de Rimbercourt, Dumontois le père et René. accompagnés de Fourrier, s’emparent de quatre cent cinquante grenades F1 quadrillées qu’ils cachent dans un four à chaux au Bois-des-Usages. Dumontois met le feu au pont de bois de Ribécourt et à un train au dépôt de Compiègne, décrochant les wagons qui vont dérailler.
Dumontois est repéré dans Senlis par les Allemands qui se livrent à sa poursuite, mais il leur échappe encore, court à travers la ville, les champs et les bois et réussit à gagner Paris. Cette vie sans repos, toujours sur le qui-vive, inquiète l’état-major du F.N. qui décide de l’envoyer en Normandie y prendre le commandement des maquisards, mais il refuse d’abandonner ses camarades de la région qu’il connaît bien. Plus tard, la direction nationale convaincue de la nécessité de décharger Dumontois de ses nombreuses responsabilités, la Gestapo étant toujours à ses trousses, veut lui confier un poste à Londres. L’avion qui doit le transporter en Angleterre est prêt à le prendre. Il refuse encore cette proposition déclarant que les nazis sont en France et non en Angleterre, qu’il y a encore du travail à faire et qu’il entend rester ici.
Pour les étrennes de René, en accord avec Gass, il lui offre une mitraillette Stan avec cinq cents balles pour renforcer son armement qui se compose déjà d’un parabellum et de quelques grenades. Parfois il revient chez lui en cachette par le jardin et pour ne pas attirer l’attention des voisins se fait appeler Lucien par ses enfants, et non papa. À Paris, ses filles Annette et Madeleine l’hébergent ainsi que ses amis de passage.
À Compiègne il vient se reposer chez nous, puis chez Salgues ou à la pension Carnot. Entre temps, sous le nom de Jean Ducassière, il loge à l’hôtel Chambaraud sur le cours Guynemer où la Gestapo tente de l’arrêter. Il s’enfuit de sa chambre, en s’agrippant à la gouttière.
Il change constamment de signalement. Certain jour, il ordonne à René qui aura une valise à la main chargée de vingt grenades F1, de prendre le train à Noyon à destination de Paris, dans le troisième compartiment du troisième wagon de tête, dans lequel il le retrouvera lui-même à l’arrêt de Compiègne, porteur d’une énorme valise bourrée de grenades, d’explosifs et d’armes automatiques destinés aux Parisiens. Faisant voyage de concert, mais craignant un contrôle possible des voyageurs civils, lors de l’arrêt de Pont-Sainte-Maxence, ils changent de wagon et s’installent dans le couloir d’un compartiment réservé aux permissionnaires allemands et nullement inquiétés, arrivent à Paris sans encombre. Une heure plus tard, dans un rayon de la Samaritaine, ils déposaient leurs précieux fardeaux, lesquels furent emportés promptement par des amis qui disparaissaient en voiture. Délestés de leurs colis, le père regagnait Compiègne, le fils Noyon.
Le 24 février 1948, averti par les cheminots du passage en pleine nuit d’un train de permissionnaires allemands venant de Paris et précédé de trois minutes par un express cobaye français, il décide de faire dérailler le deuxième convoi. Charlet, Gass et deux autres camarades armés de parabellums, munis de clés à éclisses et à tire-fond, l’accompagnent et se dirigent vers Pimprez en longeant le canal latéral de l’Oise, emplacement que Dumontois a jugé favorable pour l’opération 1616 16 Ils étaient cinq mais une vingtaine d’individus la revendiquent!. Il expose son plan et le travail qui incombe à chacun dans le minimum de temps, car les gardes-voie sont vigilants. Disposés en deux équipes sur une trentaine de mètres, quatre hommes dévissent promptement les tire-fond, n’en laissant que quelques-uns qui doivent assurer le passage du train français, pendant que Dumontois surveille le travail et que les gardes passent non loin d’eux, qui sont bien dissimulés, au moment même où surgit l’express cobaye ! Aussitôt, les saboteurs se ruent sur les derniers tire-fond et les éclisses, qu’ils font sauter, et s’enfuient vers la retraite prévue pour chacun.
Dans un fracas épouvantable, le bolide se renverse. De l’amas de ferrailles s’élèvent des cris, des hurlements de douleur que font entendre dans la nuit noire les agonisants. Alertées, les autorités allemandes réquisitionnent les véhicules de la région, établissent une navette ininterrompue entre les lieux de la catastrophe et les hôpitaux de Compiègne, tandis que les services de la S.N.C.F. mandent les cheminots pour rétablir le trafic.
L’horrible carnage avait provoqué la mort officielle de vingt-huit soldats allemands, auxquels il fallait ajouter une centaine de blessés graves. Le lendemain, Charlet, un des saboteurs, revenait en curieux et, atterré, au milieu d’une foule nombreuse, mesurait l’ampleur du désastre.
Les sabotages des lignes à haute tension et téléphoniques se succèdent. Celui de la ligne Paris-Lille échoue par suite de l’arrivée soudaine d’une patrouille de miliciens à laquelle Dumontois ne peut faire face, sa mitraillette s’étant enrayée. À Thourotte, aide de Gass et René, ils lancent des bombes à la Kommandantur et au mess des officiers.
Le 9 mai 1943, encouragés par la réussite de Pimprez, les saboteurs. auxquels s’est joint Berluc, se rendent à Baboeuf pour y rééditer le coup de main, mais la garde a été renforcée et les rondes sont plus fréquentes. Ils s’emparent des deux gardes-voie de la première ronde, puis des deux suivants qu’ils ligotent auprès d’une meule de foin et recommencent la même opération. Mais ils ne peuvent la mener à bien, le convoi survient trop tôt. La locomotive, seule, se renverse sur le talus alors qu’ils n’en sont éloignés que de 50 mètres et ils regagnent leurs domiciles à 17 kilomètres de là, exténués de fatigue. Les dégâts, moins spectaculaires, étaient cependant importants.
Saboteurs ils l’étaient, certes, mais les coups n’étaient réservés qu’à l’ennemi et jamais lorsque la vie des Français paraissait en danger. C’est ainsi que le sabotage du déversoir de Ribécourt fut jugé périlleux pour les mariniers voisins et Dumontois y renonça. Il aurait été provoqué par un obus de 155 que Charlet avait transporté sur sa bicyclette depuis le Pont-du-Matz.
Tous ces coups de main épuisaient les stocks, affaiblissaient encore l’approvisionnement des groupes amis qui en étaient dépourvus ou leur découverte par les Allemands. À la suite du parachutage de Champlieu qui permit la reconstitution d’un important arsenal, Dumontois se prépare à dynamiter la maison d’un dénonciateur, rue de Paris, et une villa du quartier des Sablons, trop accueillante aux officiers nazis, après avoir conseillé aux voisins de déguerpir. Il n’en eut pas le temps.
La mort d’un héros
DUMONTOIS André, Joseph, Né le 15 octobre 1902 à Tracy-le-Mont (Oise), mort le 6 juillet 1943 à siège de la Gestapo à Paris ; ouvrier ; couvreur ; marié, huit enfants ; militant communiste de l’Oise ; résistant FTP.
Fils d’Aristide Dumontois, brossier âgé de vingt-deux ans, et de Marie Thérèse Foulon, brossière âgée de vingt-trois ans, domiciliés à Tracy, André Dumontois se maria à Crisolles (Oise) le 18 avril 1923 avec Marie Rose Eugénie Baron. André Dumontois exerça plusieurs professions en particulier dans le bâtiment (terrassier, plombier-zingueur…). Pendant la guerre, il était couvreur à Noyon (Oise). Militant communiste, il fut candidat au conseil général en 1934 dans le canton d’Attichy et recueillit 56 voix sur 2 352 suffrages exprimés. En 1937, il se présenta dans le canton de Guiscard et obtint 190 voix sur 1 151 suffrages exprimés. Père de famille nombreuse, André Dumontois ne fut pas mobilisé. Mais il commença à récupérer des armes abandonnées lors de la campagne de mai-juin 1940. Dès la fin de la même année, il participa à la reconstitution du Parti communiste clandestin puis plus tard à la constitution des premiers groupes armés. Il organisa notamment un groupe spécialisé non seulement dans la récupération d’armes, mais aussi dans leur transport et dans le sabotage. Il participa par ailleurs aux activités des réseaux Buckmaster, réseau Jean-Marie (SOE). André Dumontois fut à l’origine des premiers sabotages des voies ferrées dans la région de Noyon et assura la réception d’un parachutage. Recherché dès juin 1941 par les autorités allemandes et françaises, il échappa aux rafles d’octobre 1941 au cours desquels furent arrêtés plusieurs communistes noyonnais : Henri Drapier, Maurice Quatrevaux, René Roy, Raymond Vinche. Entré en clandestinité, capitaine FTP, il poursuivit son activité. Arrêté une première fois, il réussit à s’évader. À nouveau interpellé, le 6 juillet 1943 à Paris lors d’une mission, il fut torturé par les services allemands de l’avenue Foch. Les circonstances de son décès sont mal connues : suicide, défenestration, ou mort sous la torture. Il semble qu’il se soit jeté d’une fenêtre du troisième étage de l’immeuble. Inhumé le 8 août 1943 dans le cimetière de Thiais (Val-de-Marne), sous le numéro 619, son corps fut cinq ans plus tard placé dans une fosse commune. Il reçut à titre posthume la Légion d’honneur, le titre de commandant FTP et celui de lieutenant du réseau Jean-Marie. André Dumontois fut reconnu « Mort pour la France » (AC 21 P 176830) à titre militaire. Une stèle commémorative a été érigée à Tracy-le-Mont, dans l’espace André-Dumontois. Un monument a été élevé à l’entrée du cimetière de Noyon. L’un de ses enfants est René Dumontois. Né le 20 février 1928 à Usigny-Gadelrange (Moselle), il participa également à la Résistance.
Le 8 juillet 1944, avant de partir pour Londres dans un centre de perfectionnement, Dumontois était convoqué d’urgence à Paris, mais auparavant il avait recommandé à son fils de se tenir prêt pour le lendemain 8 juillet et René restait à l’écoute de la B.B.C. afin de capter un message, «Jeanne d’Arc arrive», promesse d’un nouveau parachutage. Dumontois avait eu aussi le temps d’apprendre l’arrestation de Charles Gass et de plusieurs de ses amis.
À Paris, Dumontois descendait chez ses filles pour repartir immédiatement au Jardin du Luxembourg afin de rencontrer des officiers anglais de l’Intelligence Service’. Revenu chez ses filles, il leur dit son inquiétude de n’avoir vu personne et, vaincu par la fatigue, il s’endormit. Il ne s’était pas reposé depuis trois nuits. Sa fille Annette, sachant qu’il avait un autre rendez-vous l’après-midi dans le quartier de l’Étoile, le réveilla en temps voulu et il partit. Elle ne devait plus le revoir, la trahison allait triompher.
En quittant l’appartement de ses filles, Dumontois se rendit dans un immeuble de l’avenue Victor-Hugo où l’attendaient des officiers alliés et des personnages importants de la Résistance.
André Dumontois, qui avait juré que les Allemands ne le prendraient pas vivant, portait en permanence dans une couture de son veston, sur l’épaule gauche, un cachet de cyanure de potassium. Il ne put s’en saisir lors de son arrestation.
Pourtant, il tint parole.
L’agent secret allemand Hugo Bleicher, qui l’arrêta dans Paris, nous apprend la suite de ce dénouement d’une tragique grandeur, dans l’ouvrage d’Erich Borchers «Monsieur Jean» 1717 17 Die Geheimmission eines Deutschen. Adolf Sponholtz Verlag. Hannover 1951. Je remercie l’auteur et les éditeurs qui ont bien voulu me permettre d’évoquer le chapitre ’Ein Gorilla watscheit die Strasse entlang’ : Un gorille vacille dans la rue, page 110..
Dans l’immeuble de l’avenue Victor-Hugo, Dumontois, alias Tudor pour le contre-espionnage allemand, s’était trouvé en présence, outre celle du colonel Frager - mort à Buchenwald, - des lieutenants Bardet dit Raoul et Kieffer dit Kiki, deux traîtres aux ordres de Bleicher, auxquels Dumontois confia son projet de dynamiter un train de permissionnaires à Compiègne au cours de la nuit suivante, attentat pour lequel, en effet, Dumontois nous avait avertis. Châtillon, Leroy et moi-même, de nous tenir prêts.
Kiki courut prévenir Bleicher de la présence de Dumontois et de son projet, et les deux agents revinrent en hâte par le métro, la voiture de l’agent allemand étant en réparation, Bleicher demeura dans l’avenue tandis que Kieffer montait rapidement rejoindre «ses amis» au moment même où Dumontois descendait l’escalier. Kiki alerta Bleicher en éclairant l’appartement, ce qui était le signal convenu. En l’apercevant, Bleicher fut effrayé par la carrure de Dumontois -qu’il qualifie de gorille-, et n’osa pas, seul, l’aborder, aussi s’accrocha-t-il à ses pas en souhaitant trouver du renfort en cours de route, ils prirent le métro, sans rencontrer de soldats, et en descendirent pour prendre le train qui devait les conduire à la gare du Nord. Ils se retrouvèrent sur le quai en même temps que deux officiers allemands. Bleicher se présenta, sa carte de l’Abwehr à la main, et leur demanda de l’aide pour arrêter l’homme, «qui, dit-il, est très dangereux, en conséquence, prenez vos armes».
La rame de métro arrivait. Au moment où Dumontois s’apprêtait à monter dans le compartiment, un des capitaines, revolver à la main, cria: «Vous êtes arrêté!» 1818 18 En français dans le texte. cependant que Bleicher lui tirait les mains dans le dos et passait les menottes. Dumontois fut si surpris qu’il grogna un furieux juron et trébucha. Les voyageurs, atterrés, virent avec amertume et colère entrer dans le wagon les quatre hommes et leurs regards étaient pleins de haine pour les nazis. Craignant des complications, les deux officiers prétextèrent de fallacieuses obligations et descendirent rapidement à la station suivante, abandonnant Bleicher et son prisonnier.
Bleicher n’en menait pas large parmi la cohue parisienne qui ne lui ménageait pas son hostilité, et l’agent allemand, qui ne voyait toujours pas de soldats, se demandait ce qui allait se passer car Dumontois s’énervait, grinçait des dents et ne paraissait pas vouloir le suivre docilement.
Les stations se succédaient devant Bleicher, lorsque l’idée lui vint de descendre à la République où il savait trouver un poste de garde. Six stations restaient à parcourir. Le trajet paraissait interminable et, enfin, ce fut avec soulagement qu’il poussa son détenu sur le quai, sur lequel circulait une patrouille. Le lieutenant qui la commandait consentit, non sans mécontentement, à conduire Dumontois à la G.F.P. - Geheimfeldpolizei -, la police militaire secrète - proche, où Bleicher recommanda aux gardes d’être très vigilants vis-à-vis du prisonnier, pendant qu’il allait chercher sa voiture pour le conduire lui-même à Fresnes où devait avoir lieu l’interrogatoire. En même temps, par téléphone, il alertait la Gestapo de Compiègne pour lui recommander d’exercer une surveillance attentive sur le trafic ferroviaire, dont le sabotage pourrait être perpétré par des complices.
À son retour, deux heures plus tard, les services étaient en émoi. Dumontois, que l’on avait conduit dans un bureau pour une vérification d’identité, s’était lancé la tête la première à travers les vitres d’une fenêtre du deuxième étage, toujours menottes aux mains, et gisait depuis dix minutes, le crâne fracassé, dans la cour d’une prison parisienne, l’œil droit sorti de son orbite. Huit mois plus tard, Brossolette l’imitait. Tous étaient saisis d’horreur devant cet horrible spectacle, devant ce grand résistant qui consentit au sacrifice suprême, emportant dans la mort tous ses secrets. Il avait 40 ans, laissant une veuve et neuf orphelins.
Ceux qui l’ont connu, les siens, ses amis et qui n’ont pas la consolation
de fleurir sa tombe, gardent en leurs cœurs le souvenir d’une des
plus grandes et des plus pures gloires qui honorent le peuple de notre Patrie,
du sublime héros que fut le capitaine André Dumontois
1919
19
Dans son ouvrage, Erich Borchers érit que Bleicher avait hâte de conduire son prisonnier dans un lieu sûr. Les prisons de la Wehrmacht de Fresnes ou du Cherche-Midi ? impensable de parcourir Paris la nuit, seul avec ce prisonnier qui grinçait des dents et tirait sur ses menottes. Certainement, des voyageurs lui viendraient en aide. il fallait trouver une solution. Il la trouva; se rendre à la Maison d’arrët de la G.F.P. dans le voisinage immédiat de la station République. (Test la que l’auteur situe le drame sans toutefois préciser de quel immeuble il s’agissait et que l’on supposait être l’Hôtel Moderne ou la Caserne des Gardes Mobiles. Au cours de l’enquête que nous avons menée à Paris, le fils de Dumontois, René, et moi-même. nous avons recueilli le témoignage de l’Administrateur-Directeur qui habitait à l’Hôtel Moderne et qui est formel: l’établissement était occupé en totalité par des jeunes filles allemandes travaillant au Central «Archives» et que, mis à part le corps de garde, aucune présence masculine était tolérée.
S’il faut l’en croire, lorsque Bleicher revint avec sa voiture pour prendre Dumontois, il vit que -son corps inanimé, raidi et muet, gisait sur le pavé froid de la cour d’une prison parisienne-, «lag sein entseeiter Körper stumrn und starr auf dem kalten Pflaster eines Pariser Geiangnishofes ». Quelle était cette prison parisienne ? Celle de la Santé était très éloignée de la place de la République et la maison d’arrêt de la Petite-Roquette n’a jamais reçu de détenus hommes.
Reste la caserne du prince Eugène, aujourd’hui caserne Védrine, celle des Gardes Mobiles dont l’entrée avait été strictement interdite aux Allemands. Cependant ces derniers s’étaient installes avec leurs radars dans les sous-sols et ils occupèrent entièrement la caserne à partir du 15 août 1943. Un des policiers français, demeuré sur place pendant la guerre, a bien voulu me faire savoir qu’à cette date il n’y aurait pas eu de suicidé, mais vraisemblablement un fusillé. martyrisé auparavant.
Ainsi le mystère n’est pas éclairci, d’autant plus que la Direction de l’Administration pénitentiaire ne peut fournir aucun renseignement concernant la détention dans les prisons qui étaient sous le contrôle de la G.F.F., la police secrète militaire allemande, qui détruisit toutes les archives avant son départ. .
Les plus jeunes résistants de France
René Dumontois avait douze ans, il naquit le 20 février 1928 à Hussigny-Godgrange en Meurthe-et-Moselle, lorsque avec son père il récupérait. dès 1940, les armes et les munitions abandonnées par l’armée française pour les entreposer en lieu sûr. Le père et le fils ne se quittaient pour ainsi dire pas. Un jeune ami, Georges Lesur, les accompagnait souvent.
Dès la tentative d’arrestation de son père en juillet 1941, René quitte l’école, devient son agent de liaison auprès des résistants, transporte des armes avec Gass à Porquéricourt où ils sont hébergés par le maréchal-ferrant Lefèvre et à Vauchelles par le curé, l’abbé Dardenne, ainsi que dans une ferme de la localité.
Tous les huit jours, il se rend auprès de son père et du capitaine Fourrier pour organiser les sabotages et transmettre les renseignements. Il attaque seul, au mousqueton, une voiture allemande sous les yeux de Lesur et participe à des parachutages.
Entendant deux résistants, à qui son père avait recommandé de faire sauter le pont de Bailly, dire qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité d’accomplir cette mission, René décide de les remplacer et secrètement, la nuit, il court à l’endroit prévu, pose quatre pétards de cavalerie, mais une patrouille le surprend et le pourchasse jusqu’à Oilencourt d’où René parvient à se réfugier chez son oncle à Tracy-le-Mont. Le lendemain il retourne au pont, sa musette à l’épaule chargée de deux grenades et d’un revolver. Une autre grenade cachée dans le phare de sa bicyclette, aux Allemands qui l’interrogent, il allègue qu’il travaille dans la ferme voisine et, quelque peu rassurés, les soldats le laissent continuer sa route et René rentre chez sa mère qui ignore toutes les activités de son fils.
Avec son père, il confectionne une grenade à retardement qui éclate plus tôt que prévu, heureusement sans trop de dégâts, mais la combinaison s’avérant avantageuse, le père et le fils la mettront en pratique par la suite.
Au cours d’un transport de munitions à Pont-l’Évêque vers 11 heures du soir, les treize participants sont mitraillés et René blessé à la main droite. En déguerpissant, il glisse sur la berge, manque de se noyer et en est quitte pour la peur.
Les perquisitions se succèdent à la maison à la cadence d’une ou deux par semaine et chaque fois le gosse est interrogé, menacé, frappé sous les yeux de sa mère et incarcéré un ou deux jours sans jamais rien divulguer. Rien non plus n’est découvert et pourtant, sous le sol d’un hangar, existait un véritable arsenal.
Une nuit le père et son fils emportent une dizaine de mitraillettes Sten, des munitions parachutées à la Tombelle qu’ils déposent dans le grenier de la maison. Dumontois, qui doit s’absenter, avant de s’éloigner, recommande à son fils de bien cacher le tout le lendemain matin. À l’aube la Gestapo pénètre dans la maison. Mais elle a été aperçue par René, qui monte au grenier, enroule les mitraillettes dans les fragments de parachutes, lance le tout dans le jardin, saute lui-même par la fenêtre haute de quatre mètres. cache l’armement dans le bois voisin, et revient vingt minutes plus tard. Les Allemands sont toujours là, demandent d’où il vient. «Jouer au ballon». assure-t-il, et le rouent de coups sous les yeux de sa mère effrayée: ils le gardent au secret pendant deux jours. À son retour, il va rechercher la précieuse cargaison qu’il emporte chez son jeune ami Gilbert Hec.
Cette affaire de parachutes qui se déroula devant son frère âgé de sept ans, frappa l’imagination de l’enfant, à un point tel qu’il voulut être et devint un fameux parachutiste.
Gilbert et René virent un jour à Noyon un détachement allemand sortir d’un cantonnement, se glissent par un soupirail tandis que les sentinelles sont de faction et recherchent des armes qu’ils ne trouvent pas. Dépités, ils saccagent tout, éventrent les paillasses, polochons, paquetages, lacèrent les couvertures et repartent par le même chemin, sans être inquiétés.
Un ouvrier polonais avertit René que les Allemands ont déposé une caisse de munitions au Mont Renaud, l’adolescent s’en empare dès que possible. Son père arrêté, le fils ne ralentit pas pour autant son activité, et le 16 octobre 1943, accompagné de son ami Hec, munis de mitraillettes, ils incendient un grand hangar de lin, destiné aux Allemands, à Bury. Le lendemain les deux gosses étaient arrêtés, dénonces par deux femmes du village.
Leur arrestation mettait tin à une épopée. De nouvelles aventures les attendaient.
Jéricho
Au cours de l’interrogatoire à Compiègne, René subit la torture trois jours et trois nuits consécutifs. La Gestapo n’oublie pas qu’il est le fils de Dumontois. Il n’a plus de cheveux sur la tête; les genoux posés sur la tranche d’une plaque métallique, une charge de 30 kilos sur les épaules, les doigts serrés dans une presse, il ne reconnait aucun des faits reprochés, pas plus que les personnes dont les photographies lui sont présentées et qu’il connaît, pour la plupart.
De Compiègne les deux amis sont conduits à Saint-Quentin, à Amiens et mis au cachot. René, ayant droit à toute la sollicitude de la Gestapo, en février 1944, couche complètement nu sur le ciment dans l’obscurité, n’ayant pour toute nourriture qu’une gamelle d’eau tous les quatre jours. il fait un froid glacial et Flury, un interné noyonnais qui remplit les fonctions d’homme de corvée, organise dans la prison une collecte de vivres qu’il lui apporte tous les vendredis. Il sollicite ceux qui partent en déportation. leur demandant de «laisser quelque chose pour le gosse de Dumontois» dont chacun connaît la détresse et qui ne peut remercier ceux qui lui ont laissé l’un un croûton de pain, l’autre un biscuit. Après leur départ, René subit de nouveau le régime de la mort lente composé de la seule gamelle d’eau bihebdomadaire qui lui est allouée.
Le 17 février 1944, on le sort du cachot. Le lendemain la prison était bombardée par l’aviation britannique au cours de l’audacieuse et sanglante opération Jericho, dont les rapports avec celle de la ville de Palestine n’eurent rien de commun, car les murs ne tombèrent pas au son de sept trompettes comme le rapporte la légende.
Avec 640 détenus de droit commun et 180 résistants, parmi lesquels de nombreux camarades du Secteur, comme René Dumontois, Gilbert Hec, Genest dit Henri et des chefs des plus actifs de la résistance étaient incarcérés à l’époque dans cette fameuse prison d’Amiens. Plusieurs d’entre eux devaient être fusillés à brève échéance. Déjà, une douzaine de F.T.P., arrêtés depuis peu, avaient été passés par les armes en décembre. Un autre, Pache, fin janvier.
La résistance locale, qui avait pu établir une liaison assez étroite avec les internes, apprit que l’un des leurs, Jean Beaurin, devait être fusillé le 20 février et que deux précieux agents secrets britanniques de l’I.S.2020 20 Intelligence Service. capturés le 12 février au moment de leur parachutage en France, y avaient été transférés. Le temps pressait et il n’était pas question de renouveler l’attaque désastreuse de la prison de Saint-Quentin, aux conséquences tragiques. Un résistant d’Amiens, Ponchardier, imagina cette extraordinaire opération que les journaux et les revues ont relatée2121 21 Courrier Picard du 17 au 28 février 1962 et Historia, n66. p. 421. L’Opération Jéricho. Colonel Rémy. sous le nom de l’Opération Jericho, que le cinéma a quelque-peu déformée.
En dépit des multiples appels en code radiodiffusés, le Quartier Général des Armées Alliées hésitait à assumer la responsabilité d’une telle opération qui comportait de graves dangers. Les appels de plus en plus pressante, les renseignements alarmants sur la situation critique des prisonniers, émurent enfin Londres, qui promit à la résistance d’Amiens d’entreprendre cette périlleuse et audacieuse opération.
La R.A.F. arrêta un plan d’attaque, bien différent de celles exécutées jusqu’alors, qui consistait à bombarder un objectif, la prison, à éviter de faire des victimes, à abattre des murs et à ouvrir des brèches afin de Permettre l’evasion à des hommes voués aux poteaux d’exécution. Des agents emportèrent en Angleterre des plans, des croquis cotés extrêmement précis et des renseignements concernant les locaux occupés soit par les gardiens, soit par les prisonniers. Les pilotes alliés prirent des photos et une maquette faite à l’échelle permit aux équipages, enthousiasmés par un tel projet, d’en étudier tous les détails.
La ’2 Tactical Air Force’, la plus valeureuse des escadrilles alliées, commandée par le jeune colonel Pickard, fut chargée de l’opération. L’attaque devait être exécutée à très basse altitude, le plus près possible du sol, par dix-huit appareils De Haviland Mosquitos mk xviii disposés en trois vagues et escortés de douze chasseurs Mustang. La première vague était composée de Néo-Zélandais, la deuxième d’Australiens, la troisième, formée d’Anglais et d’un Français, le commandant Livry-Level, ne devait attaquer qu’en cas d’insuccès des précédentes. Dès le 14 février, les résistants se tiennent prêts à attaquer les soldats nazis qui pourraient réagir. Ce sont vingt-deux communistes décidés à tout, sollicités par Ponchardier et pourvus de trois camions destinés à transporter les fuyards. Mais le 15 le temps est affreux, la neige tombe en abondance, ainsi que le 16, et le 17 les nuages sont bas et la visibilité est nulle. Les résistants découragés, les nerfs tendus, apprennent qu’une tombe a été creusée derrière la prison et que leur camarade Beaurin doit être fusillé le 20. Ils craignent aussi que l’opération soit annulée.
En Angleterre, le vendredi 18 février 1944, la météo prévoit un temps clair et même du soleil sur la France, cependant qu’à l’aube la neige tombe encore, et, en dépit du mauvais temps qui sévit à Londres, l’action est pourtant décidée. Les avions prennent leur envol de Hunsdon, rasent la mer pour échapper aux radars allemands et, tandis que les uns font une diversion sur la région de Compiègne qu’ils bombardent, les autres foncent sur Amiens. Il est midi lorsque le premier avion, descendu à 10 mètres du sol, lance avec une précision remarquable la première bombe de 226 kilos, munie d’une fusée de 11 secondes de retardement, sur la muraille d’enceinte oui s’écroule sur une largeur de six mètres. La deuxième vague anéantit le bâtiment du corps de garde, ensevelissant ses occupants qui prenaient leur repas, et ouvre deux autres énormes brèches dans les murs du bâtiment pénitentiaire terriblement secoué.
Les portes des cellules sont arrachées par la déflagration et des lèvres des prisonniers s’échappe un filet de sang.
Le jeune Dumontois, seul survivant de sa cellule au deuxième étage, est resté accroché à une ferraille, il s’en dégage; court sur le palier, s’enfuit couvert de sang et de ravois, enjambe les morts, les blessés et les agonisants dans ce chaos dantesque. Un résistant détenu est empalé par les barres de son lit de fer. Au parloir, Mme Platel, d’Albert, libérée, a les deux jambes coupées au-dessus des genoux et mourra deux heures plus tard dans les bras de son mari.
Les résistants d’Amiens, armés de mitraillettes, descendent de leurs camions, foncent sur les gardiens qui ont échappé au massacre et qui tirent sur les fugitifs, tandis que d’autres se terrent à leur approche dans la mitraillade qui fait rage. Des évadés s’entassent dans les camions, dont l’un ne peut démarrer et reste en panne. Les rescapés s’enfuient de toute part cependant que les renforts allemands, dépêchés en hâte, les pourchassent dans la neige épaisse qui couvre encore les routes.
René est repris 100 mètres plus loin tandis que nos camarades F.T.P. de Creil ou de Montataire pour la plupart en costume de bure : Andrée Bonmarchand-Meulmestre couverte de sang, Eugénie Germain, Dutrieux, Genest venu d’Eure-et-Loir que nous hébergions, Hénoumont, de Margny-lès-Compiègne, Jacquet qui sera tué plus tard, Longa, Michel, Rouxel, Thuillier, Vibert et Wargnier ont pu s’enfuir et sont à l’abri. La population amiénoise héberge, habille les 255 rescapés et leur assure le salut. Des infortunés fuyards sont repris et conduits à la citadelle, d’autres, dont René, sont enfermés à l’usine Lebel pendant trois semaines, en attendant d’être re-transférés dans les cellules épargnées du rez-de-chaussée. René et Gilbert s’y retrouveront.
Sur le chemin du retour vers l’Angleterre, dans le ciel de Picardie, une formation allemande de Focke Wulfe 190 et la Flack en position à Cachy, prennent à partie les avions alliés. Un Mustang de l’escorte et un Mosquito. touchés, laissaient une fumée noirâtre derrière eux, celui du colonel Pickard et de son compagnon Broadley frappé à mort, tombait entre Bertangles et Poulainville, à 7 kilomètres au nord d’Amiens. Après avoir accompli un nombre considérable de missions, dont une centaine avec le groupe tchèque de la R.A.F., le jeune ’group captain’, colonel aviateur, Percy Charles Pickard, qui avait si minutieusement mis au point ce formidable exploit aérien des annales de la guerre, était tombé glorieusement à l’âge de 28 ans ainsi que son fidèle lieutenant John Alan Broadley âgé de 23 ans. Ils reposent aujourd’hui dans le cimetière militaire britannique de Saint-Pierre, à 200 mètres du théâtre de leur exploit.
Le bilan de l’opération était lourd: on déplorait la mort de 104 internes et 92 blessés conduits à l’hôpital. Si curieux que cela paraisse, ces victimes ne sont pas assimilées aux ayants-cause des fusillés et massacrés, le décès n’ayant pas été causé par une action délibérée de l’ennemi2222 22 Réponse du Ministre des A.C. à la question du parlementaire Meitz du 11 juin 1964. Il en est ainsi du bombardement d’Amiens ou de la gare de Compiègne..
182 évadés furent repris, certains d’entre eux, craignant des représailles dans leurs familles s’étaient livrés aux nazis, certains étaient restés figés sur place et seront déportés. Les rescapés, pour la plupart condamnés à mort. Et les deux agents britanniques, reprirent leur place dans le combat clandestin.
Des Amiénois, dont Mme Lequin, rue Voltaire, étaient tués, de nombreux habitants plus ou moins grièvement blessés. Les immeubles aux abords de la prison avaient gravement souffert. Un ouvrier, rentrant de son travail, se réfugia dans l’encoignure du grand portail de cette prison, se retrouva sain et sauf et, dans l’épais nuage de poussières et de fumée, recherche sa maison volatilisée. De leur côté, les Allemands reconnaissaient la perte de 20 tués et plus de 60 blessés. Des miliciens de Pétain étaient également tués.
Quelques semaines plus tard, René Dumontois et son ami Gilbert Hec, réunis dans leur cellule, entendent de nouveau la sirène et pensent qu’il s’agit d’une nouvelle attaque aérienne. René défonce la porte et, avec Gilbert, tente à trois reprises de s’enfuir. Le lendemain, menottes aux mains, en chaussettes, ils sont expédiés par les nazis en détention à Belle-Île-en-Mer. Lorsque les Américains débarquent en France, les deux jeunes gens s’évadent. arrivent à Quiberon, parcourent 12 kilomètres dans les champs de mines. Traversant les lignes entre Ploermel et Carnac ils se retrouvent enfin parmi les résistants bretons, lesquels, découvrant qu’ils sont sans papiers et sans argent, les remettent aux autorités militaires, qui s’empressent de les rejeter en prison à Rennes puis à la Centrale de Fontevrault d’où ils sont enfin libérés par deux inspecteurs délégués par le Ministère de la Guerre, le 22 décembre 1944.
Otto
Un visiteur inattendu vint en novembre 1942 troubler la quiétude de la villa que nous occupions rue de l’Aigle à la demande des propriétaires. L’officier allemand chargé du service du cantonnement venait reconnaître les lieux aux fins de réquisition à l’intention de son colonel. Je partis immédiatement avertir mes camarades qui, après avoir examiné la nouvelle situation, nous conseillèrent vivement de faire l’impossible pour rester dans ce poste d’observation inespéré et tenter d’obtenir le plus de renseignements. Les renseignements étaient considérés, à juste titre, comme les yeux et les oreilles d’une armée.
Vers midi, le lendemain, l’officier revenait accompagné de son Oberstleutnant, que l’on sut être le Doktor Lohse, commandant de la Place de Compiègne et du Camp de Royallieu, sexagénaire habitant Berlin, où il était à la tête d’une importante parfumerie.
La villa lui convint et il nous informe de son intention de l’occuper bientôt et qu’en conséquence nous devions déguerpir. Nous lui apprîmes que nous étions sinistrés et dans l’impossibilité de nous reloger et que s’il y consentait, nous souhaitions occuper une pièce quelconque de la villa. Compatissant, il nous proposa une mansarde du deuxième étage et la disposition de la cuisine en commun avec son ordonnance. Ma femme serait chargée de remettre de l’ordre dans son bureau personnel au premier étage, pendant son absence quotidienne de onze à treize heures.
Nous acquiesçâmes d’autant plus vivement que le froid commençait à se faire sentir et que le capitaine recevait l’ordre de faire rentrer du charbon. devenu un combustible rare. Nous nous félicitions de ce premier résultat.
Les jours suivants, le chauffage ayant repris un service interrompu depuis trois ans, le colonel s’installait avec son ordonnance Otto2323 23 Pour des raisons faciles à comprendre je tais son nom. dans l’immeuble. Le lendemain, comme convenu, ma femme mettait de l’ordre dans son bureau, sur la table duquel voisinait, auprès des rapports de la Wehrmacht, un abondant courrier émanant soit d’ignobles délateurs, pour la plupart anonymes. soit des familles des internes de Royallieu.
Ma femme me mit au courant de ses indiscrétions et, profitant de l’absence des deux occupants partis à leurs cantonnements respectifs, nous nous empressâmes d’aller compulser les papiers en toute tranquillité, Ma femme lisait le courrier français, moi-même le courrier allemand, chacun de nous deux prenant les notes jugées intéressantes. J’étais assis dans le fauteuil du colonel, ma femme penchée sur le bureau, tous deux absorbés dans notre lecture, lorsque nous fûmes surpris et terrifiés par l’apparition inopinée, dans l’embrasure de la porte, de l’ordonnance que nous n’avions pas entendu marcher sur les épais tapis. Je me levai d’un bond, blême, prêt à sauter sur l’intrus, lorsque l’homme en uniforme, la main sur son revolver, nous menaça en hurlant «Was machen Sie da?» Que faites-vous là? Dans un éclair fulgurant, je nous voyais au poteau d’exécution. «Wir iesen» (nous lisons) répondis-je. «Ja, nicht nur lesen Sie, sondern schreiben Sie auch !» oui. non seulement vous lisez, mais vous écrivez aussi ! Nous ne pouvions nous disculper, l’Allemand proférait des menaces et je me voyais incapable de neutraliser le terrible témoin. Un abîme de silence angoissant, pénible, shakespearien régnait dans la pièce, que l’homme rompit en se dirigeant vers la grande baie vitrée d’où il pouvait surveiller la porte d’entrée. «Ach! continuez!», dit-il. Nous étions figés d’étonnement et pourtant l’Allemand paraissait sincère, cherchant à inspirer confiance, mais le choc avait été trop rude et nos investigations s’arrêtèrent là pour la journée.
À la cuisine, une étrange conversation s’engagea. L’ordonnance, comme bien d’autres de ses camarades, n’était pas nazi, il était père d’un garçon de quinze ans membre des jeunesses hitlériennes, que sa femme et lui craignaient plus que tout, et qui les aurait dénoncés aux autorités du III Reich s’il avait été au courant de leurs convictions hostiles au régime. Fanatique, il s’était engagé dans la Luftwaffe.
De ce jour, Otto devint un fidèle ami et un allié sûr, tous les jours à la même heure il assura le service de garde pendant nos investigations, durant les quatre mois que nous vécûmes côte à côte dans la villa. Otto me mit ensuite en relation avec une douzaine de soldats allemands antifascistes chargés du matériel automobile militaire non loin de la Kommandantur. Je leur communiquais les nouvelles transmises par Londres, qu’ils ne pouvaient écouter.
Les renseignements que nous recueillîmes au bureau du colonel furent naturellement adressés aux échelons supérieurs du F.N. Les responsables s’en étonnèrent et l’un d’eux se déplaça et vint vérifier sur place la source de nos informations. Nous reçûmes ses félicitations et ses encouragements.
Lorsqu’en avril 1943 nous fûmes dans l’obligation de partir de la villa, Otto continua à trier le courrier. Il nous l’apportait à notre nouvelle demeure, nous relevions les soucis et les projets de l’occupant et Otto remportait les papiers qu’il remettait sur le bureau de son chef. Les jours et les mois se passèrent ainsi jusqu’au jour où Otto fut détaché à Romainville. Il revenait de temps à autre porteur de renseignements, même de Mauser que nous ne pouvions conserver dans notre appartement exigu et peu sûr, face à la Feldgendarmerie et avec des voisins douteux.
Pris dans l’engrenage de la résistance. Otto entra en contact avec les partisans du M.L.N. de Romainville, leur communiquant les renseignements puisés au bureau même du Camp, les listes nominatives hebdomadaires de prisonniers, leur présence, les dates de leur départ et leurs destinations. Le 18 août 1944, désertant l’armée allemande, il s’enfuit, emportant les registres du camp, accompagné d’internés qu’il fit évader, remit ces documents aux résistants locaux, resta parmi eux pendant les journées où Drancy fut libéré et partit pour le Limousin. En 1945, Otto, demeuré en France. nous enverra la copie de la citation élogieuse qui lui a été décernée à Paris et qui stipule qu’il «a bien mérité pour les services véritablement exceptionnels qu’il a bénévolement rendus, les égards de la Résistance, des Forces Françaises et des Alliés».
À ce témoignage de reconnaissance, nous ajoutions le nôtre !
Étranges conversations
Bon gré, mal gré, des contacts entre la population et les occupants nazis s’établissaient au cours desquels certains Allemands, surtout après boire, se laissaient aller à quelques confidences antinazies, confidences qu’ils regrettaient par la suite. Aussi évitaient-ils de nouveaux entretiens.
Trois sous-officiers passablement gais s’en revenaient à leur cantonnement voisin de notre domicile provisoire par une belle soirée de printemps 1943 et nous abordèrent près de la grande porte et, très loquaces, exhibèrent des photos serrées dans leurs portefeuilles. Sur l’une de celles-ci, l’un des trois allemands était représenté à la portière d‘un car bariolé de calicots recouverts de slogans nazis, et sur le côté duquel se tenaient des hitlériens en chemise brune avec brassards à croix gammée. Ce que voyant, les deux autres le huèrent, l’accusant d’être un sale nazi, ce dont il se défendait, disant qu’il n’était que le chauffeur du car, en habits civils. La scène dura un moment, animée de quolibets et de mépris, puis chacun regagna son gîte, mais jamais plus les trois lascars ne se hasardèrent à renouer conversation.
Par contre, le capitaine, mutilé de 1914-18, qui venait fréquemment prendre des ordres auprès du colonel Lohse, désirait visiblement nouer conversation et, à cet effet, en cachette de son supérieur, nous invita à l’aller voir dans une villa de l’allée des Avenues. Nous étions du même âge, avions combattu dans les mêmes secteurs au cours de la première guerre mondiale. La glace était rompue et il se montra inquiet de la situation militaire, qu’il savait grave pour son pays et beaucoup plus inquiétante pour son fils qui combattait en Russie où la guerre n’était ni fraîche ni joyeuse.
Après qu’il nous eut adjuré de n’en rien dire à son colonel, ce qui était superflu. nous primes congé. Une semaine plus tard, assuré de notre discrétion, il nous invita de nouveau, cette fois dans un immeuble de la rue Saint-Joseph, au 71, occupé par un bureau militaire. Lorsque ma femme et moi y pénétrâmes, les officiers écoutaient une émission de la B.B.C. en langue allemande et les nouvelles ne leur paraissaient nullement réconfortantes. Les présentations faites, nous abordâmes le vif du sujet. Ils voulaient connaître nos impressions et celles de nos compatriotes en général. Je répondais à la façon d’un Normand, par prudence: nous pensions que les chances étaient égales pour les deux camps et que l’Allemagne était solidement fixée sur le continent. Bien sûr, la puissance industrielle de l’Amérique lointaine était invulnérable, la Grande-Bretagne un grand camp retranché et la Russie, pour eux un véritable cauchemar, reprenait l’initiative depuis Stalingrad, mais la Wehrmacht était forte également. Ils rétorquèrent que la Kriegsmarine et la Luftwaffe étaient incapables de barrer la route aux navires qui sillonnaient l’Atlantique, et encore moins celle des avions survolant le pôle à longueur de journée pour se rendre en Angleterre et en U.R.S.S. D’autre part, les partisans les contraignaient à être constamment en alerte dans un climat d’insécurité, et les officiers étaient persuadés que leur situation militaire était de plus en plus catastrophique. J’admis qu’en toute franchise que les Français en étaient convaincus et nous nous séparâmes après qu’ils m’eurent recommandé de ne pas faire état auprès de leur colonel de cette entrevue.
Le soir même. Je rédigeais un rapport sur ces conversations et sur l’état d’esprit de ces chefs démoralisés.
On comprend qu’aucune conversation de ce genre ne se soit déroulée avec le colonel, dont l’activité s’étendait à l’administration du camp de Royallieu et à celle de la Place de Compiègne. Une jeune Parisienne de 20 ans. Claudie. agrémentait les heures de loisir du vert-galant sexagénaire. Cette fille était venue le retrouver une dizaine de jours après son installation dans la villa. à l’insu des officiers de son entourage. La fille, installée en maîtresse de maison, donnait des ordres à Otto, l’ordonnance, qui s’exécutait séance tenante; elle avait la prétention d’en donner à ma femme. N’obtenant pas satisfaction. des altercations s’ensuivirent, au cours desquelles ma femme la tançait de si verte façon devant le colonel, qu’Otto, effrayé, ne cassait de nous dire en cachette: «Nicht parler comme ça, Madame Royallieu! >> Quelques semaines plus tard, en avril 1943, «l’horizontale» réussissait à nous faire déguerpir.
Mais le colonel m’avait remis le 5 janvier une note écrite de sa main. ordonnant au service allemand de la poste française de me remettre son courrier particulier, et ne me la réclama pas. Cet ordre, que ]’ai gardé judicieusement, me fut précieux lors de mon arrestation, trois mois plus tard.
Un ausweis insoupçonnable
Comme chaque employé du C.R.T.P.G.2424 24 Centre de Réception et de Triage des Prisonniers de Guerre., j’étais pourvu d’un brassard tricolore, qui servait de coupe-file homologué par les polices allemande et française, et fut d’un grand secours pour les résistants de cet organisme.
Je me rendais fréquemment, comme agent de liaison, à Jaux à bicyclette chez le cheminot Lequeux pour y prendre livraison des volumineux paquets de tracts et de journaux clandestins, que le F.N. me chargeait de remettre aux camarades de la ville. Ma femme et moi les distribuions et les jetions dans les rues, ce qui faisait dire à nos concitoyens que des avions les avaient largués au cours de la nuit. J’y rencontrais divers responsables qui me transmettaient des ordres et des renseignements et réciproquement. Il m’arriva aussi d’attendre vainement le camarade, et pour cause.
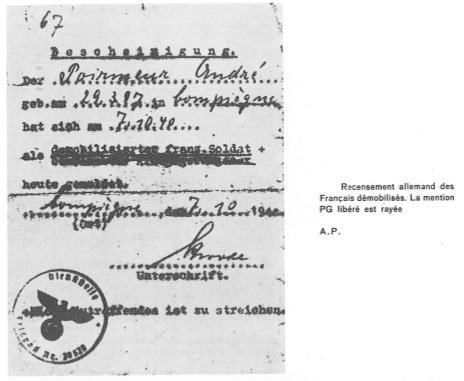
Souvent au retour. par suite d’une longue attente, il arrivait que l’heure du couvre-feu fût dépassée, elle était fixée à 22 heures l’été et 20 heures l’hiver, et il fallait pourtant revenir. Un soir, sur la route qui longe l’Oise entre Jaux et Venette, le porte-bagage chargé de tracts, je fus pris, dans le faisceau d’un projecteur surgi d’un mirador du camp de Royallieu, dont l’observateur s’obstinait à me poursuivre. Je descendis de vélo, me couchai sur le bas-côté de la route et attendis plus d’un quart d’heure que le balayage lumineux cessa et je repris enfin ma route lorsque, arrivé non loin du passage à niveau de Venette fermé fort mal à propos, j’aperçus deux gendarmes allemands auprès du portillon.
Faire demi-tour était dangereux, je glissai rapidement mon brassard et. tenant mon vélo d’une main, je tendis ma carte d’identité de l’autre. Voyant mon brassard, l’un dit à l’autre: «Ach! so, französische Abwicklungsstelle 2525 25 C’est ainsi que les Allemands désignaient le C.R.T.P.G.» ! Ah! Centre de Rapatriement de Prisonniers! Je confirmais tout souriant par un «Jawohl! ich gehe arbeiten. Gute Nacht! - Oui, je vais travailler. Bonne nuit». Elle fut bonne, ils me laissaient partir sans se soucier de mon chargement. Selon toute probabilité, le guetteur du mirador m’avait signalé et les «enfants de chœur» avaient daigné se déranger, mais je dois avouer que je n’étais pas très rassuré. La même mauvaise rencontre se renouvela place de l’Hôpital, à deux pas de chez moi. L’usage de cet intéressant laissez-passer favorisa aussi nos amis Salgues et Trognon au cours de leurs activités.
Plus bizarre fut la rencontre que je fis de jour, rue de Clermont, au retour de chez Lequeux, avec un chargement de tracts. Je croisais Champion, le conseiller national de Pétain, que je n’avais guère vu depuis le début de la guerre, qui m’interpella et descendit de bicyclette. J’en fis autant et je m’approchai, soupçonneux. Mon interlocuteur me stupéfia en me demandant si je pouvais lui procurer un cachet officiel dont il avait besoin pour estampiller des fausses cartes d’identité. J’avais précisément ce cachet sur mol qui venait de m’être confié, ce qui n’était pas sans m’inquiéter. Je lui rétorquai qu’il était beaucoup mieux placé que moi, en sa qualité de conseiller national. auprès des autorités. lesquelles se feraient certainement un plaisir de lui rendre ce service. Nous nous séparâmes. Je pensais qu’il voulait se dédouaner ce jour-là, cependant j’appris plus tard par Gracin, ancien maire de Margny-lès-Compiègne, qu’il était entré dans la résistance depuis quelque temps. Double jeu.
Arrestations parmi tant d’autres
Si le 14 juillet 1943 n’avait pas été fêté comme à l’accoutumée, nos trois couleurs avaient trotté dans le ciel compiégnois et, à l’intérieur même du camp de Royallieu, les internes l’avaient célébré à leur façon, chacun se réjouissant de ces manifestations patriotiques qui permettaient de se coucher le cœur plus léger.
Vers deux heures du matin, des coups donnés dans la porte et les volets de mon appartement du rez-de-chaussée qu’accompagnaient des appels gutturaux, me réveillèrent. À l’appel de mon nom, j’ouvris les volets, «Kommendantur» me signifièrent deux soldats casqués fusil à la main. Inutile d’insister, j’étais fait comme un rat, il était impossible de fuir. J’ouvris et m’habillai. Je n’étais pas autrement surpris. Depuis une huitaine de jours je le pressentais. Après l’arrestation de nos amis oie la pension Carnot et du général de Joybert, j’avais l’impression d’être épié, observé, suspecté. J’avais surpris un agent, décédé depuis, me montrant du doigt à un inspecteur vichyste, Michel. Flairant le danger, je m’en étais ouvert aux camarades qui devaient en tenir compte en cas d’arrestation. Les Allemands entrèrent, inspectèrent toutes les pièces de l’appartement et la cour. À ce moment précis, j’aperçus sur la table de la cuisine deux magnifiques tracts en papier glacé, frappés de deux drapeaux croisés, un français et un anglais, en couleur. J’en avalais un, ma femme voulut en faire autant, n’y parvint pas, le mâcha et le jeta dans la cuvette au moment précis où les deux soldats rentraient. J’étais prêt. Une voiture de tourisme m’attendait et, nullement flatte d’une telle complaisance à mon égard, j’étais conduit à la maison d’arrêt.

Le gardien allemand me fit remettre cartes d’identité, d’alimentation, papiers et tout ce qui garnissait mes poches, sauf un petit crayon et du papier à cigarette, prévus à l’usage d’une correspondance clandestine et cachés dans une petite poche de ma ceinture. Conduit à la cellule n° 13, un porte-bonheur, pensais-je, au deuxième étage, je manquais chavirer en entrant, tant la puanteur qui s’en dégageait était horrible2626 26 Le sénateur Patria me confiait récemment qu’il avait éprouvé les mêmes sensations Lorsqu’il vint l’occuper.. Sept hommes y étaient couchés, serrés comme des harengs, pour lesquels une grande boîte à conserves sans couvercle servait d’infâme tinette visiblement insuffisante. Je posai sur le sol la paillasse dont j’avais été doté à l’arrivée et m’asseyais dessus, philosophant sur l’énorme contraste qui existait entre mes deux couches successives de cette nuit de fête nationale.
Dans l’obscurité, le gardien avait coupé le courant sur le palier, les questions fusèrent: Qui étais-je, que, quoi? J’étais certainement un saboteur pris sur le fait pour être amené si tard. Les pauvres garçons ignoraient l’heure présente, et ils s’inquiétèrent de la situation, où en étaient les Russes, s’ils avançaient toujours, il n’y avait pas de second front. Je leur répondis qu’en effet, les Russes poursuivaient leur avance de façon spectaculaire et ils s’en montrèrent réjouis et réconfortés.
Depuis longtemps mis en garde par nos amis, j’affirmais ne pas être dans la résistance et ne pas connaître le motif de mon arrestation, certainement il y avait erreur sur la personne. À mon tour, j’interrogeais: deux n’avaient pas répondu à l’appel du S.T.O., d’autres avaient volé de l’essence aux occupants, l’un était un droit commun, l’autre un garçon de café que je connais- sais vaguement et qui est aujourd’hui à Cannes. Parmi eux; un tuberculeux qui crachait le sang. Restait un dernier pensionnaire qui n’avait pas parlé et auquel je m’étais adressé. J’appris par les autres détenus qu’il était Russe, prisonnier de guerre évadé et repris. Son compagnon qu’on était venu chercher la veille avait dû être fusillé. Lorsqu’il fit jour je lui demandai son nom. Il m’indiqua le mur et je lus: Mezetsev. Tout le monde s’étonna de m’entendre lire ce nom écrit en caractères cyrilliques et je ne leur donnai aucune explication. M’entretenant à l’écart avec lui, j’appris qu’il était des environs de Stalingrad et âgé de 18 ans. C’était un gaillard très enjoué, d’une taille moyenne et de forte corpulence.
L’heure de la récréation était arrivée, le geôlier ouvrait la porte et les initiés descendaient l’escalier, gagnant l’unique robinet de la cour pour les ablutions. Néophyte, je les suivais et passais de l‘eau sur la figure sans m’éponger, n’ayant aucun objet de toilette. Mes codétenus, qui avaient déjà l’habitude, pendant ce temps, tournaient en rond à la queue leu leu et me recommandaient de les suivre afin d’éviter des sanctions.
Je les suivais docilement lorsque, par l’interstice de deux briques descellées d’une fenêtre murée au deuxième étage, des voix amies m’appelèrent. Étienne Drujeon et Roger Visse, à peine âgés de 20 ans, m’avaient reconnu. Ils étaient condamnés à mort, coupables de l’incendie des hangars d’aviation de Margny-lès-Compiègne et de nombreux harcèlements 2727 27 Leur peine de mort fut commuée à la prison à vie et à la déportation. Étienne est rentré. Roger a succombé.. Nous ne pûmes tenir une longue conversation, un Allemand survint et me reconduisit dans ma cellule après m’avoir remis un paquet de cerises apporte par ma femme. Les geôliers avaient fait main basse sur les autres denrées.
«Vous partir!», surpris, abandonnant les cerises aux infortunés détenus, je le suivis au bureau dans lequel une autre surprise m’attendait, bien moins réjouissante. J’y retrouvais quatre Compiégnois arrêtés eux aussi la nuit précédente, ce que j’ignorais: le jeune Christian Desseaux, âgé de 18 ans, Georges Pigot, Jean Pioche, agent de police auxiliaire, et Robert Pons. Nous comprimes qu’il n’était pas question de nous relâcher. Menottes aux mains, encadrés pas les hommes de la Gestapo mitraillettes aux poings. nous traversâmes Compiègne, croisant des personnes amies qui nous adressaient des signes de sympathie et d’espoir. Sur la chaussée, la jambe de bois de Pigot rompait le silence imposé. Nicht parler! Nous avait recommandé le feldwebel, en partant. Nous avions compris.
À la gare, on nous fit prendre un express de permissionnaires qui allait à Berlin. Avant de monter, je criai aux voyageurs civils attristés et figés sur les quais, des paroles d’espoir et «Vive la France !». Le train nous conduisit à Saint-Quentin où une camionnette nous transporta de la gare à la prison. Là, la même scène que celle de la veille se renouvela: fouille devant le sous-officier Walter, ami intime d’une Compiégnoise, attente interminable dans la grande salle froide des pas perdus qui résonnait des bruits de bottes, des grincements inquiétants des serrures et du va-et-vient des lourdes portes et des grilles métalliques.
Deux heures plus tard, nous étions introduits dans des cellules différentes: la mienne. le n7, était au rez-de-chaussée et réservée aux terroristes dangereux! Celles de mes camarades aux étages supérieurs. Pigot avait dans la sienne un «mouton», lequel écoutait les conversations que souvent il provoquait entre détenus suspendus aux barreaux de leurs petites fenêtres et rédigeait ensuite un rapport que Pigot était contraint de signer. Pigot réussit à nous le faire savoir et depuis, il me dit toujours: «Toi, tu as eu de la chance, car tu étais drôlement catalogué !»
Plus sombre que celle de Compiègne, sorte de cachot éclairé par son petit châssis, obscurcie encore par les six mètres de hauteur du mur d’enceinte contigu, cette cellule de 4m 2 était plus propre, mais très froide. Une table assujettie à la cloison, un lit de fer, sous la table deux courtes et grosses chaînes ornées d’anneaux destinés à se refermer sur des chevilles récalcitrantes, tel était son ameublement. À notre entrée, un pathétique individu s’était dressé au pied du lit.
J’installai ma paillasse au travers de la cellule sous le châssis, tandis que le geôlier nazi refermait la porte. J’allais rester là un mois. Un mois au cours duquel l’inaction et les insomnies émoussaient les forces humaines. Le 17, Rossi vint nous rejoindre. Certain jour, à l’aube, nous fûmes douloureusement affliges par une tragédie qui se déroulait non loin de la cellule occupée par le seul Pioche. Un adolescent dont les tueurs bottés venaient s’emparer. ne cessait de crier d’une voix mêlée de sanglots: «Non, je ne veux pas mourir! Maman!» Nous étions bouleversés.
Entente Cordiale
L’aspect de mon compagnon de cellule m’avait quelque peu effarouché. De taille moyenne, maigre, -au fait, qui était gras, sinon les profiteurs-, le front largement dégarni, des cheveux noirs recouvrant la nuque et les oreilles, il portait une barbe de sapeur-pompier légendaire. Je n’imaginais pas qu’une dizaine de jours plus tard, je pourrais rivaliser avec cet homme d’aspect préhistorique. Il bredouillait quelques mots en mauvais français. Nous n’échangeâmes aucune conversation, chacun se méfiant de l’autre, je l’observais sans pouvoir discerner sa nationalité, que je supposais méditerranéenne. Il paraissait âgé d’une quarantaine d’années.
La nuit vint cependant, sans sommeil, je revivais les péripéties vécues depuis deux jours, nuit entrecoupée de temps à autre par la ronde d’un gardien, déchaussé pour ne pas éveiller l’attention, scrutant à travers le judas la cellule qu’il éclairait de l’extérieur. Mon compagnon, qui s’y trouvait depuis six mois, dormait profondément et rêvait en laissant échapper des paroles qui me semblèrent anglaises. Parfois je sommeillais, me réveillent brusque ment pour élaborer un plan de défense, rassemblant tous les conseils qui m’avaient été prodigués.
Le lendemain matin, après le jus qui méritait bien son appellation, mais d’une origine incontrôlable, ce fut la course aux latrines, devant lesquelles se pressait une queue impressionnante que surveillait un Allemand, jambes écartées, clefs en mains et pistolet à la ceinture, qui n’avait rien de rassurant. Mon compagnon, ses ablutions faites. lavait à grande eau la cellule, qu’il épongeait rapidement avec une loque empruntée aux gardiens. Un «raouss» amplifié par l’écho déclenchait une réintégration rapide dans les cellules respectives.
Nous restions assis sur nos couchettes sans dire mot par peur de nous compromettre, attendant la soupe que vinrent apporter deux prisonniers, les- quels, bien qu’accompagnés d’un geôlier nazi, colportaient en sourdine les dernières nouvelles que leur avait communiquées le personnel du Comité d’Aide aux Prisonniers, chargé du ravitaillement des détenus. Nous n’avions qu’une seule gamelle pour deux, la sienne. Force était donc d’y verser les deux rations peu substantielles il est vrai, mais bien préparées. Purée de pommes de terre, confitures, légumes mélangés constituaient une recette de cuisine peu commune.
Mon compagnon entretenait sa forme par des exercices physiques et me fit comprendre qu’il était Anglais. Je l’admis avec peine. La nuit suivante, qui fut identique à la précédente, je restai éveillé tel un hibou dans l’obscurité, prêtant l’oreille aux balbutiements en anglais de mon voisin. Le troisième jour, arpentant la cellule en cadence pour me dégourdir, je chantonnais « For he’s a jolly good fellow», ce qui eut pour effet de dérider l’homme, étonné, lequel me dit « Vous connaitre ?». Je lui répondis affirmativement en anglais, ce qui le rendit très loquace et enthousiaste. La glace était rompue.
Il me recommande de ne pas parler devant les gardes de crainte qu’en nous séparât et il me raconte son histoire. Né en France, dans le Nord, de parents français, il les avait suivis à l’âge de 9 ans en Angleterre où son père, mineur, avait trouvé du travail non loin de la côte. Attiré par la mer, l’enfant s’embarqua clandestinement à bord d’un navire de guerre britannique en instance de départ. L’équipage ne le découvrit qu’en haute mer, le prit en affection, heureux de la présence d’un si jeune mousse et en avertit les officiers stupéfaits. Dans |’impossibilité de le débarquer, force était de le garder et il fut la joie et l’enfant gâté de tous. Les officiers lui donnèrent une excellente instruction, lui apprirent l’anglais et il se montra un élève studieux.
En Amérique du Sud, première escale du navire, personne ne dévoila sa présence et il fit ainsi le tour du monde qu’il avait rêvé. Oubliant sa langue maternelle, sans nouvelles des siens, après vingt-huit années passées dans la marine de sa patrie d’adoption, il travailla huit ans dans les plantations de tabac de Virginie, aux États-Unis, dont il parlait le dialecte.
Atteint du mal du pays il revint en Angleterre en 1939, puis en France dans l’espoir de retrouver des membres de sa famille, qu’il ne put découvrir de l’autre côté du détroit, aux environs de Valenciennes. L’invasion allemande le surprit dans le Nord et, ne pouvant retourner dans les Iles Britanniques, il travailla sur place dans une entreprise de travaux publics. C’est là qu’il fit connaissance d’un architecte de Chantilly, qui lui écrivit en anglais. La lettre. adressée à Marcel Delaunay, son nom, signée Jean (il prononçait Djine), fut interceptée par la Gestapo qui recherchait l’architecte en fuite et lui-même fut arrêté. Il était détenu depuis six mois, au cours desquels il eut comme compagnon un Américain pendant quelques semaines. Je comprenais maintenant la méprise que son type méditerranéen, si courant chez nos compatriotes du Nord, m’avait fait commettre.
Les récits qu’il me fit de ses voyages dans toutes les parties du monde furent captivants et remplissaient les longues journées de détention avec la lecture des romans qui, bien qu’interdits, foisonnaient dans la prison, et passaient de mains en’ mains en dépit de la surveillance.
Un capitaine allemand avait fait subir à mon compagnon plusieurs interrogatoires en langue anglaise. L’Allemand pensait avoir affaire à un espion ou à un parachutiste nanti de faux papiers français. Notre Anglais lui raconta son histoire, sa vie de marin, son séjour en Virginie, intéressé, l’officier lui parla dans le dialecte local que l’insulaire connaissait bien, prouvant par la la véracité de son récit. Les deux hommes avaient été employés dans les mêmes plantations de tabac sans se connaître, mais cette particularité réjouit l’officier allemand, qui promit à l’Anglais de le prendre sous sa protection et de le faire libérer en qualité de Français immigré en Amérique et revenu dans son pays.
Je ne lui soufflais mot de mon activité dans la résistance mais nous résolûmes de nous évader. Nous avions échafaudé un plan d’évasion en direction de la côte où, disait-il, Churchill avait dit à la radio que des vedettes croisaient, prêtes à embarquer les volontaires. Il savait aussi où trouver des avions faisant la navette entre nos deux pays.
Un gardien m’apporta une valise dans laquelle je trouvai du linge de rechange et des objets de toilette qui furent les bienvenus, entre autres mon rasoir, que l’Allemand me reprit aussitôt après que nous nous en fumes servi rapidement, et un paquet de cigarettes. Mon compagnon se précipita sur celles-ci et les multiplia avec une dextérité remarquable, en les déroulant et en en refaisant deux avec une seule, à peine plus grosses qu’une allumette. J’admirais le travail et le priais de m’en garder une. Pour les allumer, il sollicitait du feu de la part des gardiens qui y consentirent volontiers. Quant au chocolat et quelques friandises ajoutes par mon petit neveu Bernard qui s’en était privé pour moi, ils servirent à l’amélioration de l’ordinaire de nos gardiens.
Un mois plus tard l’Anglais était libéré, comme moi-même. il m’écrivit et vint nous rendre visite quelques semaines plus tard. Nous ne parlâmes point de résistance et je n’ai plus entendu parler de lui.
Qui était-il? Agent secret? Ancien marin? Qu’importe, l’Entente Cordiale avait été parfaite.
À la Gestapo
Un matin, la Gestapo de la 21 brigade mobile de Saint-Quentin daigne s’occuper de nous et, voulant sans doute garder un bon souvenir des Compiégnois récemment arrivés, nous photographie de face et de profil, s’inquiéta de notre anthropométrie. Nous n’en étions pas plus fiers pour cela, ni flattés, et, une semaine après notre arrestation, elle nous reçut dans un grand hôtel particulier qui abritait les services de la Kommandantur.
L’interrogatoire individuel commença vers 13 heures, mené par deux agents de la Gestapo en civil. Le plus grand avait des yeux luisants comme des poignards bien fourbis. Six heures durant, le dos collé au mur, je dus répondre aux questions, corsées de gifles, de bourrades dans le bas des côtes, et de menaces d’un revolver placé entre les deux yeux. J’étais soupçonné d’être à la tête d’un groupe de terroristes et au cours de l’interrogatoire, les agents de la Gestapo, des Français, me présentèrent, ainsi qu’aux autres camarades, une vingtaine de photos de cartes d’identité que je devais reconnaître. J’admis connaître vaguement Baduel, sans être affirmatif, bien que nous fussions amis depuis longtemps. Hélas! J’ignorais que le pauvre garçon avait été martyrisé le 13 juillet à la Kommandantur de Compiègne, la veille de notre arrestation.
Un deuxième agent examinait mes papiers parmi lesquels j’avais glissé auparavant la fameuse note du colonel Lohse ordonnant à la poste de me remettre son courrier privé. Cet ordre parut impressionner le capitaine Müller qui sa tenait dans la pièce voisine. Les agents me sommèrent d’avouer que je fréquentais la pension Carnot, tenue par Mme Boissonnet, elle-même détenue à la prison. ils me demandèrent également ce que je pensais des personnes dont ils citaient les noms, parmi lesquelles un individu peu recommandable, D…, qui à coup sûr nous avait dénoncés. Ce triste sire était employé au mess des officiers, face à notre appartement et, fait troublant, vint prendre de mes nouvelles le lendemain de ma libération. Aujourd’hui. dans Ta Marne où il réside, il se fait passer pour un résistant et, qui plus est, un ancien déporté. Il est évident que chacun ne reconnaissait ni les photos, ni les faits reprochés, c’était plus simple et plus prudent.
Mes amis étaient rentrés depuis longtemps lorsque je réintégrai ma cellule et les gardiens, nullement surpris de ma longue absence, n’avaient pas cru devoir me réserver une ration, peut-être jugée superflue.
Trois semaines plus tard Pigot, Pioche, l’Anglais Delaunay, un jeune homme de Trosly-Breuil et moi-même, nous étions libérés, passablement étonnes. Nous avions eu de la chance, mais, suspects, nous étions des otages en puissance. Toutefois avant de partir j’eus droit à une correction: j’avais été surpris, suspendu aux barreaux du châssis, écoutant les messages que des camarades moins chanceux me demandaient de communiquer à leurs familles. Ce que je fis. Mais les coups avaient été durs; ma figure en témoignait. Après ce contretemps qui faillit tout gâcher, la porte de la liberté s’ouvrit. Nous nous rendîmes chez le plus proche coiffeur, ce n’était pas un luxe.
Le général de Joybert avait été libéré quinze jours auparavant. Pons et Laffite demeurèrent cinq mois de plus à la prison de Saint-Quentin. mais Laffite fut repris le 8 juillet 1944 et mourut à Buchenwald. Desseaux reviendra de Buchenwald. Pioche fut encore arrêté deux fois par la police française. puis relâché enfin.
Rafle des juifs
Le décret du 1 juillet 1942 imposait aux juifs le port de l’étoile jaune à six branches frappée du mot «Juif» en lettres rouges. Elle devait être en étoffe et cousue sur la veste ou le corsage à hauteur de la poitrine. Cet emblème était destiné, dans l’esprit des nazis, à livrer les Juifs à la vindicte et à la risée populaires. Mais il faut le dire, cela resta sans succès. La mention ’Juif’ était obligatoire sur les cartes d’identité et les titres d’alimentation. Il leur était interdit d’exercer une profession libérale ou un commerce et leurs biens étaient vendus, pour le plus grand profit de certains vautours.
Au cours de l’après-midi du 4 janvier 1944, les nazis et des miliciens, qui avaient déjà procédé à l’arrestation des juifs étrangers quelques mois auparavant, opérèrent une rafle ignoble de la communauté juive demeurée dans la ville, sans distinction d’âge et de sexe. Mondor, ancien commerçant devenu charretier, à qui j’avais fait part de mes craintes à son sujet. m’avait rétorqué qu’il était Français et de plus ancien combattant, comme si les nazis tenaient compte de ces considérations. Sa femme et lui furent embarqués et ses filles, recueillies par des concitoyens charitables, échappèrent ainsi à un sort tragique. J’assistai impuissant à l’enlèvement de trois enfants, les Cohen, que je connaissais bien, jetés comme des poubelles dans un grand camion bâche. Ces pauvres petits, aux cheveux noirs frisés, me lançaient des regards douloureux et terrifiés. Que pouvais-je faire? Rien. Quel fut leur sort? On n’ose l’imaginer. Leur mère, incapable de protéger ses petits, loque humaine, hurlait de rage et d’épouvante.
Me rendant compte qu’il s’agissait d’une rafle massive des juifs, je courus rapidement chez un médecin ami, afin de le mettre en garde ainsi que sa famille. Le docteur était absent, il visitait ses malades. Sa femme me reçut. Je lui racontai les scènes dont j’avais été le témoin et la suppliai de prendre ses dispositions pour parer à cette éventualité. Elle m’assura que son mari apprendrait la chose en ville et se mettrait à l’abri, quant à elle et à ses enfants, ils étaient catholiques, il était donc impensable qu’elle telle monstruosité fût commise à leur égard. Sa confiance était mal fondée vis-à-vis d’un tel adversaire. J’insistai sans succès et pris congé. À peine avais-je fermé la porte que la soldatesque sautait du camion et courait à la recherche du médecin. Celui-ci avait été effectivement averti et avait rejoint une cache prévue, qu’il ne quitta qu’à la Libération, sans jamais donner de ses nouvelles. Furieux de ne pouvoir l’arrêter, les nazis emmenèrent en otage sa fille, qu’ils gardèrent près d’un mois en prison.
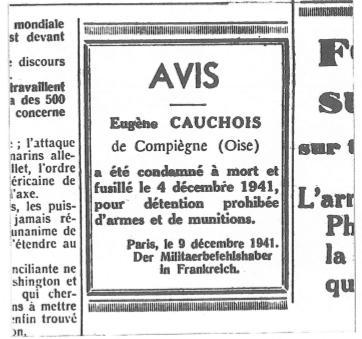
Des Compiégnois compatissants recueillirent des enfants et des jeunes gens; un ami, Ribouleau, réussit à sauver in extremis les deux enfants Blum-Malmed, le frère et la sœur, qu’il put élever dans l’incognito, et qui devinrent orphelins par la suite. L’épouse d’une Compiégnoise, Cohen-Levastre était aussi arrêté à Noyon.
Dans les maquis de l’Isère, les résistants juifs compiégnois vengèrent leurs coreligionnaires: l’antiquaire Baumöhl, qui fut grièvement blessé au ventre au cours d’une action, l’artiste lyrique Dreyfus (Murray, dans la Résistance et au théâtre) et dont le père avait 83 ans et son frère Marcel, un camarade d’enfance et de Verdun, succombèrent dans les chambres à gaz d’Auschwitz; le brave Palencia. seul survivant de sa famille, qui apprendra que sa femme et ses quatre enfants ont subi le même sort.
Aucun des trente israélites déportés n’échappera au Crématorium ni au massacre. Une famille de commerçants, heureusement réfugiée dans le Midi de la France, comptait quatorze victimes parmi les siens.
La police avec nous
En 1943, l’adjudant Hubert Laffite retrouvait un de ses anciens camarades de régiment, Firmin Flamand, lui-même agent de police. Ils parlèrent de la situation dans laquelle était tombé le pays et formulèrent chacun le vif désir de voir bientôt l’occupant déguerpir.
Flamand, qui depuis longtemps cherchait à entrer dans un réseau de résistance, accepta la proposition que lui fit Laffite d’entrer au F.N. Laffite le chargea de recruter des amis sûrs et créer un groupe de F.T.P. et bientôt Flamand formait une équipe composée d’agents de police pour la plupart. Un ami commun, l’adjudant Hocquart, assurait la liaison avec les responsables et avec Pourceaux à Gournay, chez lequel se trouvait un poste émetteur- récepteur. Les renseignements fournis par le groupe étaient précieux: en plus des’ ordres locaux et des consignes ordonnées par les Allemands, ils signalaient les mouvements de troupe que la police avait à connaître et les enquêtes sur les patriotes suspects, que réclamait la Gestapo.
L’activité des agents s’étendit aux sabotages et au harcèlement de l’en- nemi. Le 7 juin 1944, ils opèrent un coup de main sur un camion allemand près de Gournay, tuant deux soldats et en blessant un troisième, sabotant les voies ferrées de la ligne Compiègne-Roye, interrompant le trafic ferroviaire pendant une quinzaine de jours. À Rémy, ils firent dérailler un train de troupes qui resta immobilisé 24 heures, et le 6 juillet ils participèrent au déraille- ment spectaculaire d’un train de tanks de la division d’infanterie Adolf Hitler appelée d’urgence à Caen pour contenir les Alliés, et qui resta bloquée cinq jours durant, près de Roye.
La Gestapo, pendant ces jours de fièvre, poursuivait ses investigations et le 7 juillet mit la main sur Defoor qui habitait à Royallieu. Elle découvrit une liste nominative du groupe que Defoor, en dépit des recommandations sévères. avait établie, et y retrouva le nom de Laffite 2828 28 Libéré après un emprisonnement de six mois à la suite de l’affaire de la trahison.. Réfugié à la Faisanderie, en forêt, il y fut arrêté le 8 juillet et mourut en déportation. Le même jour, douze agents de police, Hocquart et les frères Salgues étaient incarcérés au camp de Royallieu d’où ils partiront tous le 16 août pour Buchenwald. dans le dernier convoi.
Le 18 avril 1945, Vigny réussissait à s’enfuir lors de l’évacuation du camp de Buchenwald et rentrait chez lui le 11 mai. Lapole, exténué, épuisé par la faim, était lâchement assassiné. Hébert. Lecareux, Verpillat, le jeune Georges Saigues avaient succombé.
La duperie de la Relève
La traite des prisonniers de guerre
Les pertes de l’armée française que nous avions à déplorer dans les combats de septembre 1939 au mois de juin 1940 s’élevaient à près de 95000 tués, auxquels il fallait ajouter des milliers de blessés. À ces pertes s’ajoutait le chiffre formidable de près de deux millions de prisonniers qui seront privés de liberté pendant cinq ans, en dépit de la promesse fallacieuse que leur avaient fait miroiter les Allemands d’une libération prochaine des camps de France où ils étaient rassemblés. Nos infortunés compatriotes se rendirent bientôt compte de la mystification, lorsque par petites étapes ou de grands voyages, ils prirent le chemin de l’exil pour languir derrière les barbelés des 55 Stalags et des 14 Oflags en Allemagne. Déprimés par l’oisiveté, démoralisés par une propagande insidieuse, ou travaillant en usines, en kommandos, de nombreux prisonniers étaient persuadés que la poignée de mains de Pétain à Hitler, à Montoire, scellait un accord sincère et nécessaire avec l’Allemagne.
Mais bientôt il n’y eut plus aucun doute pour personne que la guerre serait longue et que l’Allemagne exigerait un énorme matériel de guerre de toutes les usines d’Europe. Le gouvernement de Vichy, complice des nazis. comprit que pour faire tourner nos usines vidées de leurs spécialistes, il fallait d’une part rapatrier ces derniers, qui travaillaient avec une maladresse voulue et au ralenti dans les usines allemandes et, d’autre part, faire appel à des volontaires désireux de remplacer nos captifs dans leur emploi, en leur faisant miroiter des avantages extraordinaires de toute nature. Il s’agissait seulement de faire admettre par le pays ce fameux projet cher à Laval: la Relève. 2929 29 Le retour au pouvoir de Pierre Laval, le 18 avril 1942, coïncide à peu près avec l’arrivée en France de Fritz Sauckel, chargé par Hitler de pourvoir l’industrie du Reich en main-d’œuvre qualifiée recrutée dans les pays occupés. À cette date, moins de 100 000 travailleurs français étaient partis volontairement travailler en Allemagne. En mai 1942, les demandes de Sauckel s’élèvent à 250 000 hommes. Laval accepte à condition que 50 000 prisonniers de guerre soient libérés en échange de 150 000 ouvriers qualifiés, soit un prisonnier de guerre français contre le départ en Allemagne de trois ouvriers spécialisés. Il justifie cet accord par son discours du 22 juin, dans lequel il « souhaite la victoire de l’Allemagne parce que, sans elle, le bolchevisme, demain, s’installera partout ». Le gouvernement de Vichy lance une vaste campagne de propagande par la radio, la presse et l’affichage auprès des ouvriers, afin de les inciter au volontariat. Cette campagne présente cette « relève » comme une solidarité nationale, met en avant les avantages supposés accordés aux volontaires ou glorifie le « sacrifice » du soldat allemand devenu l’ultime rempart contre le bolchévisme : « Ils donnent leur sang - Donnez votre travail pour sauver l’Europe du bolchévisme » disait une célèbre affiche de l’époque. « La relève aura ainsi doublement sauvé la France de la pauvreté grâce à celui qui est parti, et de la famine grâce à ceux qui sont rentrés ». « Tout le confort est assuré, douches, salles de bain, chauffage central, la nourriture abondante est préparée par des cuisiniers spécialisés originaires de divers pays pour respecter les coutumes nationales ». « À Nice, je gagnais 2 000 francs par mois et aujourd’hui, après avoir vécu, j’envoie 3 000 balles à ma famille, sans compter ce que j’espère emporter lors de ma première permission ». Le régime organise, le 11 août, une cérémonie très médiatisée d’accueil du premier train de 1 300 prisonniers libérés qui arrive en gare de Compiègne, croisant un train de volontaires partant pour l’Allemagne. Laval, accompagné de nombreux dignitaires français et allemands, dont le délégué de Sauckel et celui d’Abetz, prononce un discours, devant les caméras, la radio et les journalistes, tentant de justifier sa politique. Cependant, cette mesure n’a pas de succès, seulement 7 000 ouvriers partent en mai, succédant aux 7 000 d’avril et 17 000 volontaires répondent à l’appel à la fin août4. Devant cet échec, le 22 août, Sauckel veut alors imposer un dispositif plus contraignant7. Laval édicte donc la loi du 4 septembre qui amorce une relève par réquisition, premier pas vers la loi du 16 février 1943 qui institue le Service du travail obligatoire8. D’avril à fin septembre 1942, Sauckel, très insatisfait, comptabilise 68 000 partants. La Relève permet à 90 747 prisonniers de rentrer en France, Wikipedia.
Ce fut une véritable escroquerie, un bluff énorme qui consistait effective- ment à remplacer un petit nombre de malades et d’inaptes, par un personnel valide et qualifié pour combler les vides dans les usines allemandes, vides provoqués par une mobilisation de plus en plus implacable. Parallèlement. dans le dessein d’obtenir un plus grand rendement, on promettait aux prisonniers qui travaillaient sous la férule, un prompt retour après leur transformation en travailleurs libres.
Les Allemands nous renvoyèrent les premiers convois de rapatriés à Châlons-sur-Marne. C’étaient des grands blessés aux pansements sanguinolents, des fous, des mourants demeurés sans soins depuis leur départ, entassés durant trois jours dans des wagons à bestiaux. Au début de juillet 1941, le gouvernement de Vichy envisagea, en accord avec les Allemands, la création d’un grand Centre de Réception et de Triage des Prisonniers de Guerre -le C.R.T.P.G.- à Compiègne, dans la caserne Jeanne d’Arc et le quartier Bourcier contigu. Le génie militaire fut chargé des travaux et requit les entrepreneurs de l’agglomération. Convaincus qu’il s’agissait d’un retour massif des prisonniers que chaque famille attendait, les ouvriers travaillèrent nuit et jour avec ardeur, il fallait de plus faire vite, les autorités allemandes ayant fixé la date du 21 août pour la réception des premiers prisonniers rapatriés.
Selon les occupants, Compiègne devait créer un choc psychologique, car si ce nom rappelait un armistice de gloire pour les Allemands, pour les prisonniers. Il en rappelait un autre de tristesse et de honte, celui de la défaite du 22 juin 1940. La caserne d’infanterie fut réservée aux services allemands, le quartier de cavalerie aux services français avec une installation de mille lits. Deux baraques Adrian, montées en deux jours, furent pourvues de 2.000 collections complètes d’effets civils. Un circuit organisé permettait aux rapatriés de passer d’un service à un autre pour satisfaire aux formalités de libération. Un centre d’accueil municipal était installé au manège ainsi qu’un bar avec boissons chaudes et froides, un réfectoire de 600 places, une salle de lecture vichyste et de correspondance, une cuisine. En face, un cinéma. Une annexe destinée à héberger les malades et les convalescents fut installée au château de Villette, à Pont-Sainte-Maxence.
Le camp français était sous les ordres du commandant Courrier, médecin principal, prisonnier libéré, seul à porter la tenue militaire. Les cadres étaient composés d’officiers de l’armée de l’armistice et le personnel de sous- officiers, renforcé d’un important contingent civil, modestement rétribué. dont je faisais partie. Le service du ravitaillement était le plus envié, il était très apprécie des voisins nazis qui y venaient à longueur de journée partager le ravitaillement et surtout le vin des prisonniers prélevés par certains employés de ce service et tout ce joli monde, dans une touchante collaboration, se livrait à de honteuses libations. L’un d’eux obtiendra la Médaille de la Résistance, ce qui est tout de même un exploit.
Au début de sa création, la collaboration était à l’honneur parmi de nombreux officiers. L’un d’eux, particulièrement éloquent dans ses conférences en faveur de Pétain, mérita le surnom de «Suivons le Maréchal››, slogan qu’il ne cessait de répéter. Parmi les sous-officiers et le personnel civil, la mentalité était meilleure: ainsi un feldwebel venu enquêter fut rabroué de verte façon par une Alsacienne du personnel, à la stupéfaction de tous. Un autre employé, Grignon. composait des chansons satyriques. Les autres colportaient les nouvelles de la B.B.C. et faisaient circuler des tracts. Par la suite, en raison du renversement de la situation, que ce fût par compréhension ou par intérêt, certains rallièrent la Résistance.
Heilag et C.R.T.P.G.
Le camp allemand, le Heilag, appellation barbare née de la contraction du mot composé Heimkehrlager, - camp de retour au foyer -, était placé sous l’autorité du colonel Von Gemmingen, ancien officier du Kaiser et préfet de Metz à l’arrivée des Français en 1918, châtelain des bords du lac de Constance. Il parlait un français impeccable ainsi que son interprète, originaire de Genève. Il ne semble pas que ce colonel ait été hitlérien car il a fait preuve, maintes fois, de compréhension et de sympathie discrète envers des prisonniers «resquilleurs» et des israélites que cette mesure de libération ne touchait pas.

Le 21 août 1941, après une inspection des aménagements des casernes par le ministre de la Guerre, le général Huntziger, signataire de l’armistice de 1940. le premier convoi de prisonniers libérés entrait en gare de Compiègne après avoir traversé la nouvelle frontière à Novéant, en Meurthe-et-Moselle, et les gares du parcours sur lequel se pressait la population qui, avide de nouvelles, leur distribuait boissons et douceurs, tout en espérant découvrir un proche ou un ami.
À leur descente des wagons à bestiaux, il leur fut servi du vin et du bouillon, et le déroulement des opérations fut sensiblement le même par la suite. L’homme de confiance du convoi remettait au Sonderführer du Heilag. la liste des prisonniers qui étaient comptés une première fois et rassemblés en rangs dans la cour de la gare pour y entendre, après leurs épuisantes journées de voyage, des discours fastidieux. Le délégué de Laval, Chasseigne, et André Masson, commissaire général du Mouvement Prisonnier, leur vantaient les bienfaits de la collaboration et les invitaient à acclamer la France qu’ils applaudissaient tous, cependant Pétain, Laval et l’orateur n’obtenaient que des murmures désapprobateurs.
En colonne par cinq, comptés de nouveau, -il en manquait toujours quelques-uns qui, méfiants, avaient réussi à se libérer eux-mêmes-, encadrés par les Allemands, les rapatriés étaient dirigés au Heilag et croisaient sur le parcours, en dehors de la population compiégnoise, des parents et des amis qui leur adressaient des signes pleins de tendresse et qui avaient été pré- venus par des inconnus sollicités dans les gares des départements traversés. Au Heilag, nouveau dénombrement et contrôle minutieux. Les formalités pour établir des certificats de libération ou des congés de captivité duraient trois heures, et par groupes de cinquante les rapatriés étaient dirigés dans une grande salle dans laquelle ils abandonnaient leurs effets militaires considérés comme butin de guerre, puis, dans le plus simple appareil, souvent par un grand froid, ils franchissaient le portillon qui s’ouvrait sur le bureau français du C.R.T.P.G. dans lequel l’assurais mon emploi. Le premier prisonnier qui le franchit fut le sous-officier Dubois, venu du Stalag 1 B aux environs de Hohenstein, en Prusse Orientale. Comme Bidasse, il était de la ville d’Arras.
Nous inscrivîmes son identité sur une feuille qui porta le n1 au composteur et qu’on lui remit, ainsi qu’une serviette, du savon, il passa aux douches voisines, tandis que ses affaires personnelles étaient étuvées. Il en fut ainsi pour tous. Un triage médical méticuleux les attendait, après quoi on leur remettait leurs affaires personnelles. Ils recevaient ensuite du linge de corps, un costume, béret et chaussures neufs. Dans la salle de la consigne ils déposaient leurs bagages et étaient informés de la lettre et de la couleur attribuées à leur région et que les rapatriés devaient signaler pour obtenir les renseignements les concernant, ainsi que les horaires des départs et les itinéraires. À cette consigne, plus de 400000 colis ont été reçus et remis sans une seule erreur, ni préjudice quelconque, ce qui est à l’honneur du personnel.
Sur le circuit organisé, un bol de bouillon leur était offert au passage, ils se présentaient ensuite aux tables du Service de Rapatriement, chaque table portant les couleurs de leurs régions accompagnées de la lettre qui avaient été communiquées à chacun des rapatriés. Leur ordre de transport était établi et ils recevaient plus loin une avance sur la prime de démobilisation. du tabac, des tickets d’alimentation, des mandats pour le remboursement des Lagermarks (marks des camps). Mais il y avait aussi dans le circuit un bureau parasite, celui du Mouvement Prisonnier, de Masson, non prévu par le Commandant du centre, et qui s’était installé là de connivence avec l’officier surnommé «Suivons le Maréchal!». Les libérés, se croyaient tenus de s’y présenter et s’y voyaient remettre, comme dans les foires, journaux, cartes d’adhésion, insigne de la Francisque et réclamer une cotisation de 50 francs, Soit plus du salaire journalier d’un employé, à l’époque, Masson ayant appris que le personnel conseillait aux P.G. d’éviter ou de refuser ces éléments de propagande, demanda des sanctions qui resteront sans effet, grâce à la solidarité du personnel qui jura être étranger à l’objet de la plainte. Masson en conçut un violent dépit et clama qu’il était grand temps de mettre de l’ordre dans la maison, car, disait-il. «ils n’ont pas encore compris». Il se trompait fort.
Abreuves de nouveaux discours élogieux sur Pétain, les rapatriés avaient un avant-goût de ce qui les attendait. et reprenaient le chemin de la gare. Nous eûmes la possibilité de converser avec eux et de recueillir des renseignements sur les conditions de vie dans les camps d’où ils venaient et sur leurs expériences. La plupart avaient été témoins de scènes horribles: les premiers gardes mobiles libérés nous affirmèrent avoir vu des chars blindés nazis broyer des prisonniers soviétiques parqués dans des rues sans issue et a qui il était impossible de s’enfuir.
Nous retrouvions les uns et les autres des camarades de régiment, des vedettes. des artistes. des sportifs, tel Rigoulot, très amaigri, qui fit quelques démonstrations, déchirant en deux parties un jeu de cartes, au grand ébahissement de tous.
En mars 1942. par une note confidentielle. «Suivons le Maréchal» créait un service de mouchardage, chargeant les sous-officiers de dénoncer les membres du personnel hostiles au nouveau régime. Il fallait répondre aux questions: qui, quoi. où. quand. par qui, etc. Une employée. femme de prisonnier et mère de famille. subit une peine de suspension de travail de quinze jours en date du 22 avril 1942, pour ce motif: propos diffamants à l’égard du Maréchal. Porteur lui-même de la francisque, cet officier entendait que tous l’imitassent, mais bien peu s’exécutèrent. Il rabroua le délégué du personnel, conseiller municipal de Margny-lès-Compiègne et frère d’un colonel, qui lui remettait la note de revendications que lui-même l’avait chargé de remplir. «Retirez-vous et ne me touchez pas avec vos mains visqueuses». préciser-il, en lui arrachant la note incriminée. Le personnel avait formulé des revendications! Admirateur de Laval que tout le monde haïssait, il fit accro- cher ses portraits en dépit de la vive opposition de son capitaine adjoint et interdit l’écoute de la B.B.C. au mess des sous-officiers. La fortune des armes changeant de camp, le commandant «Suivons-le-Maréchal» démissionna le 31 août 1943, rentra dans l’ombre, reparut à la Libération et plaida le double jeu. obtint de l’avancement, peut-être en raison de son intimité avec le général de Gaulle qu’il avait connu à l’école des chars et qu’il accablait de toutes les injures peu de temps auparavant.

Les autorités du Centre étaient tourmentées: la radio de Londres annonçait l’arrivée attendue des convois de rapatriés, pourtant tenue secrète, la quantité, leurs catégories, le nombre de malades, le parcours et les dates. Employé au Service des Transports. qui était en liaison téléphonique avec Novéant, je m’empressais de les communiquer à Londres par l’entremise des agents de liaison. J’étais pourtant soupçonné d’être un membre de la Résistance et mes collègues de bureau, dont Trognon et Jacques Lefèvre, me dirent avoir entendu des officiers exprimer des doutes quant à mon loyalisme. Aussi me firent-ils la leçon selon Vichy, après mon internement à Compiègne et à Saint-Quentin. Mais la résistance faisait tache d’huile parmi le personnel, de même que la répression. Les employés Laville, les deux frères Héraude et Georges, un des fils de Salgues, moururent en déportation. À la Libération, Trognon, reprenant du service, sauta avec ses hommes sur une mine en Normandie. Grièvement blessé au ventre, il a pu se rétablir grâce à sa robuste constitution.
En 1944, un renversement d’opinion se manifesta parmi les officiers, lesquels Jusqu’alors étaient restés inactifs; il y avait pourtant, dans un local du quartier, un dépôt d’armes en excellent état, dont ils connaissaient l’existence et qui aurait pu servir.
Laval inaugure la Relève
Afin de donner plus d’éclat au Rapatriement, plusieurs trains de prisonniers arrivèrent en gare de Compiègne le même jour. Les rapatriés durent attendre pendant plusieurs heures, en rang, l’arrivée de l’ambassadeur des prisonniers Scapini qui leur tint un très long discours.
Pour frapper l’opinion publique, il arriva que des libérés spéciaux les accompagnassent, comme ce fut le cas pour les Combattants de 1914-18 et de 317 Dieppois, le 22 octobre 1942, sous le prétexte que leurs concitoyens s’étaient montrés passifs lors du raid des Canadiens le 19 août 1942. En hiver, par un froid glacial, des marins internes en Turquie furent accueillis par le contre-amiral Abrial en gare de Compiègne. N’étant pas considérés comme prisonniers de guerre. leurs bagages furent dispensés de la fouille réglementaire, ce qui réjouit fort les matelots qui rapportaient dans leurs volumineux colis de nombreuses cigarettes, du tabac d’Orient et quantité d’objets divers. Sur ordre de l’O.K.W., Oberkommando der Wehrmacht, quelques Compiégnois furent libérés.
Enfin, les prisonniers apparentés aux traîtres engagés dans la L.V.F., Ligue des Volontaires Français, blessés ou tués sur le front de Russie, bénéficièrent d’une libération de faveur.

Le 18 avril 1942 Laval, remis de l’attentat qui faillit lui coûter la vie, était de nouveau chef du gouvernement. Deux mois plus tard, le 22 juin 1942, il s’empressait d’annoncer à la radio l’application de la Relève en vertu de laquelle les Allemands libéreraient un prisonnier de guerre français en échange de trois spécialistes qui iraient travailler en Allemagne.
La première manifestation symbolique de la Relève se déroula à Compiègne le 11 août 1942, en présence de Laval qu’accompagnaient de Chambrun, Paul Morand, Benoît-Méchin, Scapini, Luchaire. Touzé, secrétaire d’Etat à l’information, Pinot, commissaire au Reclassement des P.G. libérés, Bruneton, directeur de la Main d’œuvre en Allemagne, le colonel Ardouin, représentant le Ministre de la Production industrielle, le colonel Tezé, de la Légion tricolore, et de nombreux fonctionnaires. Hitler, de son côté, avait délégué son conseiller personnel Ritter, président de l’Arbeltsfront, et Rudolf Schleier, représentant Otto Abetz. La ville fut mise en état de siège; fortins et tranchées munis d’un armement considérable assuraient le dispositif de sécurité aux points névralgiques. Le service d’ordre, extraordinaire, était d’autant plus sur le qui-vive que des patriotes avaient fait sauter la nuit précédente la façade du local de la L.V.F. et que les attentats se multipliaient. L’Itinéraire que devait emprunter Laval fut détourné au dernier moment et, bien qu’entouré par d’imposants gardes du corps, Laval ne put s’empêcher de trahir une peur affreuse.

Le premier train arrivé en gare de Compiègne fut celui des travailleurs volontaires pour l’Allemagne. En attendant Laval, ils couvrirent le train de slogans flatteurs à son égard et comme au théâtre où les figurants jouent la comédie de la grande foule en passant d’une coulisse à l’autre, le train passa et repassa plusieurs fois devant la gare. Un train de prisonniers, ce jour-là ils eurent droit à des wagons de voyageurs, s’était arrêté à quelques kilomètres de Compiègne pour attendre Laval. Lorsque son arrivée fut confirmée, les prisonniers furent invités à couvrir les portières d’inscriptions enthousiastes et le convoi se remit en marche pour venir se garer le long du deuxième quai près duquel était arrêté le train des volontaires.
À un signal donné, les occupants des deux trains furent invités à descendre de leurs wagons et à se donner l’accolade, encouragés par les haut-parleurs qui tentaient de susciter l’enthousiasme, mais en vain. Des incidents violents mirent aux prises prisonniers et volontaires. Les premiers reprochent aux seconds une collaboration qui n’était qu’une trahison. Il faut dire aussi que ces hommes et femmes volontaires ressemblaient fort à des condamnés de droit commun et à des filles soumises, ce qu’ils étaient pour la plupart et ce que n’appréciaient nullement les prisonniers3030 30 Ils venaient des Stalags I, A et B en Prusse Orientale.. Trois fois dans la journée, la même comédie se renouvela avec les mêmes civils, mais Laval n’assista qu’à la grande première. Au cours de son inévitable discours, il affirme: «Vous ne serez pas sceptiques, vous qui avez connu les souffrances morales de l’exil». Quant au conseiller Julius Ritter qui, en septembre 1943, sera abattu au coin de la rue Pétrarque à Paris, il avait dû, sans doute, faire des promesses et des menaces.

Laval, écourtant son séjour, disparut en reprenant la route de Paris par un nouvel itinéraire afin de brouiller les pistes. Chasseigne, son représentant, revint plusieurs fois, de même que la musique des Gardiens de la Paix qui donnait une aubade de musique militaire; Sambre-et-Meuse, la Fille du Régiment ou la Marche Lorraine. Les Allemands n’ont jamais réagi.
Une deuxième comédie fut présidée par le comte de Brinon le 19 septembre 1942 à 19 heures. Il était accompagné d’une suite nombreuse et de personnalités nazies: von Rörich, représentant Abetz, et Rosenberg, délégué de l’O.K.W., mais les journalistes et photographes furent pourchassés afin qu’aucun témoin indésirable n’assistât cette fois à une probable répétition des incidents précédents. Ces rapatriés, pour la plupart cultivateurs, venaient des Stalags III, A, B. C et D en Prusse et Branolebourg. De Brinon glorifia la magnanimité du Führer et exhorta à la radio les ouvriers français à aller travailler en Allemagne, à raison de trois contre un prisonnier. Lagardelle, ministre du Travail, affirma sans rire que les Allemands, ces gens bien pacifiques et bien doux (sic), se faisaient tuer pour nous. Quelques instants plus tard, von Stulpnagel annonçait dans un communiqué qu’il venait de faire fusiller 50 otages tirés au sort et que 50 autres le seraient le lendemain. L’horrible réalité de l’occupation ne tardait pas à se révéler aux malheureux intoxiqués dans les camps par une propagande insidieuse.

Le 23 septembre à 16 heures 35, le troisième convoi de la Relève rapatriait 1128 prisonniers des Stalags VII A et B en Bavière. De Brinon ne parla que deux minutes en présence du ministre Rothe, des conseillers d’ambassade von Reiff et von Hoslitz. En raison des incidents qui se renouvelaient à ces cérémonies symboliques, celles-ci furent supprimées par la suite. Toutefois l’hostilité des prisonniers se manifestait parfois de façon inattendue: le préfet régional Quenette, qui les recevait un jour, eut la désagréable surprise de parler devant un auditoire restreint: les rapatriés s’étaient empresses d’aller rejoindre le chanteur Maurice Chevalier qui s’en revenait de Bruxelles et qu’ils avaient reconnu sur les quais. C’était plus sympathique.
Une rencontre particulièrement pénible et émouvante se produisit au cours de l’après-midi du 6 juillet 1942: un convoi de prisonniers rapatriés croisa aux abords de la gare un convoi de déportés venant de Royallieu partant en sens inverse, pour Auschwitz. Il se produisit une pagaïe indescriptible qui permit a quelques-uns des déportés de s’échapper avec la complicité des cheminots et de la population. Les rapatriés s’inquiétèrent et apprirent ainsi par les Compiégnois l’existence du «Camp de la Mort lente à de Royallieu. Ce soir-là le discours d’Hébert, délégué permanent de Scapini, sur la collaboration avec les bons Allemands fut accueilli par des cris et des huées. Des ordres sévères furent donnés par la Kommandantur pour que pareille rencontre ne puisse se reproduire à l’avenir. Quant à de Brinon, ancien bookmaker promu ambassadeur, on ne le revit plus. Il revenait pourtant souvent à Gouvieux. près de Chantilly, où il avait un pied-à-terre garde par les agents de la police judiciaire et des gendarmes. Dans la nuit du 16 au 17 octobre 1943, alors qu’il y dormait dans les bras de sa secrétaire, des F.T.P. déposèrent trois bombes dont une seule explosa. De Brinon fut blesse à la face, sa maitresse à la poitrine et le pavillon subit des dégâts importants.
267564 repas chauds et 256987 repas froids avaient été servis au C.R.T.P.G. Les avances de primes de démobilisation payées se montaient à 156685000 francs et les remboursements des Lagermarks à 957040700 francs. Compiègne avait prodigué la joie de la liberté retrouvée à 3259 officiers, 32 616 sous-officiers et 160 775 hommes de troupe, mais 6490 avaient dû être admis d’urgence à l’infirmerie et 2797 à l’hôpital.
Service du Travail obligatoire
Jusqu’au 2 octobre 1942, le recrutement des travailleurs se fit par voie d’appel aux volontaires, mais ces derniers, en dépit des nombreux avantages qu’on leur faisait miroiter, étaient notoirement réticents et les Allemands, qui exigeaient une main-d’œuvre de plus en plus importante, décidèrent de procéder eux-mêmes à la réquisition des ouvriers dans les territoires qu’ils occupaient.
Sachant que les Français s’empresseraient d’échapper à cette réquisition directe des nazis, Laval intervint et déclara que ce projet ne s’appliquerait pas à notre pays et que ce serait la France elle-même qui procéderait au recrutement. En même temps il ordonnait l’envoi immédiat de 150000 spécialistes au travail forcé en exil, avec, en contrepartie, le rapatriement de 50000 prisonniers malades ou inaptes au travail. Au début de 1943 les Allemands exigèrent l’envoi d’un nouveau contingent de 250000 hommes. De nombreux affectés prirent le maquis où tenteront de gagner l’Angleterre par l’Espagne dont la frontière était gardée par d’importantes forces de gardes mobiles, de gendarmes français et allemands et de miliciens. Chaque jour les arrestations étaient nombreuses et les réfractaires livrés à la déportation. Les nazis ne libérèrent que 50000 prisonniers en échange et demandèrent à Laval d’en transformer 250000 autres en travailleurs libres. Ce système s’avérait beaucoup plus avantageux.

Laval décida de créer des départs plus rationnels et ordonna un recensement de la main-d’œuvre d’après lequel les travailleurs étaient répartis en plusieurs catégories salon leur âge, leurs charges de famille, leur situation militaire d’ancien combattant ou d’ancien prisonnier et leur activité professionnelle. Ce dernier astucieux classement allait permettre une nouvelle déportation d’une jeunesse plus valide dont on espérait un meilleur rendement.
Toutes ces mesures de recensement ne pouvaient satisfaire les énormes besoins de l’Allemagne et, comme palliatif, le gouvernement de Laval institue par décret du 16 février 1943 le Service du Travail Obligatoire qui devait permettre, après avoir formé des spécialistes en France, de les envoyer grossir la masse de nos exilés. Ce décret appelait les jeunes gens nés entre le 1 janvier 1920 et le 31 décembre 1922. 77000 de ces jeunes Français partirent immédiatement en Allemagne, cependant que le gouvernement créait des organismes: Commissariat général au S.T.O., Commissariat à la main d’œuvre française en Allemagne, Association nationale des Amis des Travailleurs français en Allemagne, dont la mission consistait officiellement a soutenir le moral défaillant de ces Déportés du Travail. Bien que tous les hommes de 18 à 50 ans fussent astreints au port d’un certificat de travail. un nouveau recensement général de la population fut ordonné, afin de combler les vides causés par les bombardements massifs de l’aviation alliée en Allemagne.
Si des individus des deux sexes partirent comme volontaires, un grand nombre de réfractaires s’évadèrent ou se camouflèrent au cours d’un congé. Un Compiégnois imagina un plaisant stratagème pour rentrer en France avec la complicité de son frère. Papiers officiels à l’appui, il avait obtenu une permission exceptionnelle pour contracter un prétendu mariage avec une jeune fille consentante qu’il ne connaissait pas. Pris au jeu lorsqu’il la vit, sa pseudo-fiancée était belle, il voulut absolument l’épouser. Hélas! C’était la promise de son frère et notre S.T.O. partit pour Toulouse. Nombreux furent ceux qui, repris, furent renvoyés en Allemagne, cette fois dans les camps de la mort.
600 000 Français et Françaises furent ainsi déportés aux travaux forcés au service de l’ennemi. Abandonnés à leur sort, souffrant du froid et de la faim sous les bombardements continuels, ils attendirent leur délivrance jusqu’au printemps de 1945. Pas tous, hélas! 60000 d’entre eux n’en revinrent pas et. parmi ces victimes, figurait notre neveu Jean Gavrel, lequel, déporté S.T.O. fut tué à Dortmund le 16 février 1945, à 22 ans.
Le camp de Concentration de Royallieu
Royallieu
Le hameau de Royallieu est une dépendance de Compiègne. Dans les anciens titres, ce faubourg est appelé la Neuville-au-Bois, Beaulieu ou La Neuville-Saint-Germain, puis Franqueville à cause des privilèges accordés aux habitants. En 1153, la reine Adélaïde, veuve de Louis VI, y fit construire une maison royale et le hameau prit alors le nom de Royal-Lieu. Tous les rois habitèrent ce palais jusqu’à sa destruction par les Anglais lors du siège 1430.
Situé au sud de Compiègne, et sillonné par la route de Paris, le faubourg de Royallieu était isolé de l’agglomération urbaine lorsque, avant la guerre de 1914, l’autorité militaire fit élever, sur le plateau balayé par les vents, des baraquements destinés à recevoir les recrues dont la loi récemment décrétée sur les trois ans de service armé allait multiplier le nombre. C’est dans ces nouvelles casernes que le 54e R.I. tint garnison. Pendant la première guerre mondiale elles furent utilisées comme hôpital militaire. De 1919 à 1939 elles furent occupées, outre des unités indochinoises et malgaches entre 1922 et 1925, par des aérostiers et un bataillon du 67° RJ. Pendant la ‘drôle de Guerre, ces casernes furent transformées en hôpital d’évacuation secondaire n7, le HOE 2 n7.
Dès leur entrée dans la ville, le 9 juin 1940, les ennemis rassemblèrent tous les militaires français et britanniques qu’ils avaient faits prisonniers. dans ce grand quadrilatère de 16 hectares, qualifié de Frontstalag 170 KN 654 et placé sous l’autorité du kommandant Solf. Dans le plus extraordinaire affolement, le 22 juin 1941, lors de l’invasion de la Russie Soviétique par l’Allemagne nazie, les Allemands s’efforcèrent de faire rentrer les prisonniers qu’ils avaient détachés dans les bureaux administratifs et les fermes alentour. La moitié seulement de cet effectif rallia le camp, l’autre moitié, plus avisée. rentra chez elle. Dans la fièvre, un départ massif des captifs en Allemagne créait ie vide que des civils allaient bientôt combler. Le Camp de Concentration de Royallieu était né. Ce Polizeihaftlager3131 31 Camp de détention de la police. passait sous le contrôle du Service de la Sûreté nazi, le S.D., installé au 74 de l’avenue Foch à Paris et, changeant de matricule, pendant plus de trois ans allait être le Frontstalag 122.
Ce camp est bordé à l’est par la route de Paris sur une distance d’environ 425 mètres, à l’ouest par un chemin parallèle de 325 mètres, au sud par un sentier de 400 mètres et au nord par la rue du Mouton longue de 450 mètres. Un mur l’enferme au sud et à l’ouest. Le long des rues de Paris et du Mouton. le treillage métallique est masqué par une palissade de planches de 3 mètres de hauteur et de nombreuses sentinelles en interdisent l’approche. À 100 mètres de côté et d’autre du camp, des chicanes barrent la route, interdisant l’approche.
À l’intérieur du camp, près de la clôture, deux réseaux de fils de fer barbelés et de chevaux de frise de 6 à 8 mètres de largeur forment un no man’s land qu’il est dangereux d’aborder. Des pancartes innombrables le rappellent. «Danger!» «Si vous approchez des barbelés, la sentinelle fera feu!». Ce n’est pas une plaisanterie car, entre les barbelés et la clôture, les soldats armés qui circulent dans le chemin de ronde et les sentinelles mitraillette en mains, dont on devine la silhouette dans les miradors, ne s‘en feront pas faute. La nuit, les faisceaux lumineux des projecteurs balayent sans cesse le quadrilatère et malheur à celui qui est pris dans leurs rayons, les gardes-chiourmes nazis font bonne garde…

La grande porte principale, qui est réservée aux Allemands, s’ouvre au centre d’un immense terre-plein de 160 m de largeur et de 230 m de profondeur autour duquel s’élèvent à gauche les huit bâtiments du camp A. a droite les huit du B, au fond sur deux files de quatre les huit du C. tous parallèles à la rue de Paris. On dirait comme des maisons de poupée, de 60 m sur 15 m, disposées autour de cette immense pelouse, avec un rez-de-chaussée surmonté d’un comble recouvert de pannes. À gauche et à droite des pignons faisant face à la pelouse, la lettre du camp et le numéro du bâtiment se détachent en noir sur deux grands écus rectangulaires blancs. Les A, sont occupés par les internés, la bibliothèque et le chef de camp. Les Allemands ont installé leurs services dans les B, B1 étant celui du triage à l’arrivée des internés (mais les B1 et B2 seront bientôt détruits par un avion inconnu) et les B2, B3. B4 abritent les bureaux de la censure, du service de traduction et de ceux de l’habillement.
Les Américains internés occupent ceux de B5 à B8. Le G1, où sont installées les douches, servira de triage à l’arrivée en remplacement du B1 détruit et ensuite, en plus du C5, de chambrée pour les femmes et les enfants de Marseille. Les C2, C3, C6 et C7 abriteront successivement les internés de France et pour les internés de Jersey et de Guernesey sont réservés les C4 et C8, que les femmes occuperont à leur tour. Le G4 fut aussi la chambre des condamnés.

C5 et D1, situés au sud-ouest du camp, furent un centre de triage à l’arrivée, puis au départ. Le parloir américain se trouve au D2, le matériel aux D3 et D4, les ateliers aux D5 et D6, à une vingtaine de mètres de la grande porte qui s’ouvre sur la rue de Paris, par laquelle vont entrer et sortir cinquante mille internés.
D7 et D9 étaient réservés à la fouille et à la distribution des colis. D8 était la chapelle pour le culte catholique. Derrière les baraquements se trouvent divers locaux à usages multiples: E1 épluchage des légumes, E2 la cantine. E3 l’infirmerie française. E4 l’infirmerie américaine, E5 et E6 sont des locaux d’internement.
F1 abrite la cuisine, F2 celle des Américains les G, les lavoir et séchoir. P1 est réservé à l’entrepôt de la paille et des paillasses, R à la désinfection, T est le grand magasin des vivres. W1 et W2 sont deux ateliers de maréchaux-ferrants.
En face de la porte des internés, les Allemands ont installé leurs services et le bureau de renseignements, alors que l’administration du camp se trouve successivement au 68 du boulevard Gambetta au 89 et enfin au 103 rue de Paris.
Frontstalag 122
Les casernes de Royallieu deviennent un camp de concentration en juin 1341 sinus le sigle original de Frontstalag 122, contraction des mots Front-stammlager. camp pour la troupe du front, placé ainsi que le fort de Romainville, sous l’autorité de colonels et d’officiers.
Ce sont les Oberstleutnants Lohse, Paris, Possekel, le Kommandant Pelzer, les Hauptmäner Birkenbach, Möbuis, Müller, Nachtigall, les Sonderführer Krebs, Liebeskind, Reisige, les Adjudants Grote, Kelterborn. Umschlag. Les Unteroffiziere, Hild, Jaeger, Korries, Kuntz, Prüssmann, Rollin, Schilling, Sölner, Sudermann, Sydow, Trappe, Volkmann, von Achenbach et d’autres.
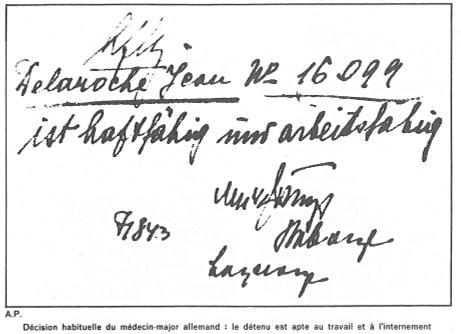
On y rencontre les médecins du camp, le Major Doktor Buckard et le Doktor Furtwaengler, un Autrichien, des agents du S.D., notamment le Hauptsturmführer Doktor Illers.
Quelques-uns de ces geôliers se sont montres humains comme Prüssmann qui a rendu de grands services en passant des lettres clandestines, ainsi qu’un autre sous-officier qui fut fusillé. Mais parmi les autres, les criminels de guerre n’ont jamais été inquiètés. Leurs dossiers, déposés au tribunal de Karlsruhe en 1947, sont dans les tiroirs. ’Le plus ignoble de tous fut le S.S. Erich Jaeger, trépané sur le front de l’Est, que les internes, auxquels il inspirait la terreur, connaissaient sous le sobriquet de l’Homme aux Chiens, avec ses molosses Klodo et Prado, il s’enivrait plus que de coutume avant de désigner les otages à fusiller, souvent pris au hasard. L’Unteroffizier Kuntz, ancien garçon de café de Montparnasse, fut également un infâme individu.
Ce sont les Sonderführer qui falsifiaient les cahiers des effectifs, dans lesquels ils transformaient les otages fusillés en évadés. Ils volaient ensuite leur colis. Ce sont eux qui soutiraient de l’argent aux familles des malheureux internés en leur faisant miroiter un adoucissement de leur peine ou même une libération proche. Ils mènent la grande vie dans les cafés de la ville et ils sont particulièrement bien reçus dans l’un d’eux.

Un de ces geôliers avait imaginé un subterfuge avantageux: un compère, un policier choisi parmi la basse pègre du camp, proposait à un interné une bague de grande valeur enrichie de pierres précieuses, volée évidemment à un prisonnier. L’interné, tenté par l’offre avantageuse, regrettait de ne pouvoir disposer de son argent dépose au bureau du Frontstalag, mais l’Allemand survenait fort à propos et acceptait de bonne grâce de prélever la somme nécessaire, 5000 francs en principe, sur le compte de l’intéressé et le marché était conclu. Quelques jours plus tard, l’acheteur subissait la fouille qui précédait sa déportation, le nazi récupérait la bague et le tour était joué. Il ne s’agissait plus que de rechercher une autre victime pour lui extorquer l’argent que les deux compères se partageaient.
C’était vraiment le bon temps! Aussi, lorsque la Wehrmacht fera appel aux Jeunes dont elle a tant besoin sur le front de l’Est, des récalcitrants seront fusillés. Le long du mur de droite, à l’extérieur du Cimetière du Sud, situé à 200 mètres du camp, parmi les 167 Allemands inhumés, on remarquait les tombes de dix-sept inconnus3232 32 Les corps sont ré-inhumés dans les cimetières allemands de Fort de Malmaison, Nampcel, Nouvion et Tracy..
De juin 1941 au 28 août 1944, les nazis enfermeront dans ce Camp de Royallieu cinquante-trois mille sept cent quatre-vingt-sept hommes et femmes et même des enfants de toutes nationalités. Français pour la plupart, et la population compiégnoise sera le témoin horrifié de scènes douloureuses et déchirantes.
54.000 internés sous le ciel d’Île-de-France
Maîtres du pays, les nazis, aidés en cela par un gouvernement à leur dévotion, se démasquaient et, fidèles aux principes d’Hitler qui proclamait dans «Mein Kampf» que «l’ennemi mortel et impitoyable du peuple allemand est le Français quel qu’il soit: royaliste ou jacobin, bonapartiste ou démocrate bourgeois, républicain clérical ou bolchéviste rouge», procédaient à l’arrestation des Français de toutes confessions religieuses et philosophiques, de toutes les couches de la nation.
Pendant plus de trois ans des Français, des étrangers aussi traversèrent Compiègne, brisés de fatigue, jetant sur la chaussée leurs valises, leurs pauvres ballots et couvertures, trouvant auprès de camarades plus valides un appui fragile mais combien fraternel ou, transportés sur des chariots pris à la gare, étaient conduits au camp, certains tels de dangereux forçats, menottes aux mains et enchaînes deux par deux.
Plus pénibles étaient ces convois encadrés de gendarmes français peu fiers d’accomplir une telle besogne. Pis encore, le 10 juillet 1943, venus des Pyrénées, des jeunes Français, des miliciens, des chiourmes aux uniformes bleu foncé coiffés d’un large béret noir, hurlaient, criaient, frappaient leurs victimes qu’ils abandonnaient au camp après avoir menacé les Compiégnois qui ne cachaient pas leur hostilité. Pétain pouvait être fier de ses hommes aidés dans leur sinistre besogne par les Camicie nére, les Chemises noires italiennes, qui livraient aux nazis de Royallieu les italiens républicains et les résistants français des territoires qu’ils occupaient ou limitrophes. Un de ces infortunés fut le boulanger Dante Pompili. Arrêté à Cannes le 15 janvier 1943, il fut interné au camp du Vernet, puis à Modène (Fossoli) en Italie. Transféré à Compiègne il fut déporté à Buchenwald.
Les phalangistes de Franco, nullement en reste, remettaient aux Allemands les évadés qu’ils avaient capturés en Espagne. En juin 1943, un groupe de ces derniers qui avaient été incarcérés au fort du Hâ, à Bordeaux, arrivait au camp.
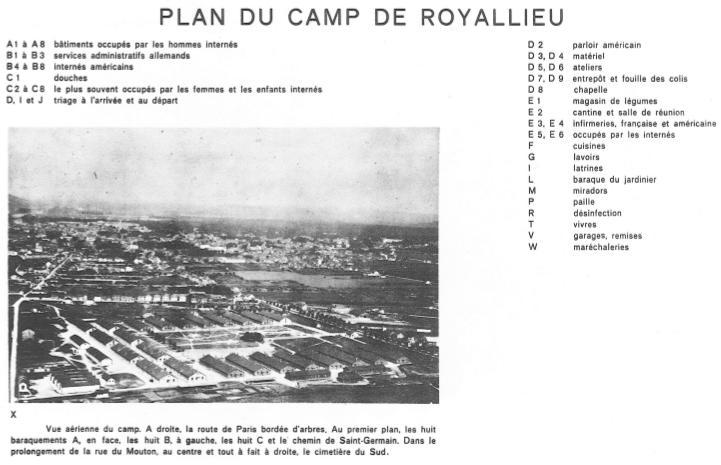
Quotidiennement ou presque, les civils raflés arrivaient de partout; en juin 1941 dès le début, ce sont des élus et des militants communistes ou syndicalistes. des Russes, des Anglais; le 3 août, une longue colonne d’ouvriers, de fonctionnaires, d’intellectuels, de petits commerçants arrêtés par la police française et la Gestapo; en octobre des femmes venant de Rouen; le 12 décembre, à 3 heures du matin, ce sont 1200 juifs; le 23, huit avocats transportés de Paris en autobus; dans le même temps, ce sont des Américains; le 28 février 1942, dans un rapport secret intitulé Stimmung und innere Sicherheit, Moral et Sécurité intérieure, Speidel fait connaître que, par mesure de représailles, il a ordonné le 3 février l’exécution de six otages à Paris et l’envoi de cent autres, juifs et communistes, à Compiègne; le 30 mars 1942, c’est une dizaine d’otages de Rouen qui avaient été libérés au camp deux mois auparavant et qui, repris, seront fusillés le lendemain; le 22 janvier 1943, un groupe arrivé de Limoges; le 23 janvier, 230 femmes de la région pari- sienne; le 26 janvier, 1800 Marseillais, hommes, femmes et enfants; deux hommes, enfermés dans un wagon à bestiaux, deviennent fous après un voyage de 68 heures; le 16 mars, 58 détenus de la prison Saint-Pierre, encore de Marseille; les 21 et 27 mars, de nombreux autres de Fresnes; fin mars, 48 nouveaux Marseillais; le 26 avril, 213 femmes du fort de Romainville et transportées dans des tombereaux de la gare au camp; le 20 juin, des jeunes gens arrêtés à la frontière espagnole et extradés de la citadelle de Perpignan; les 18, 26 juin et 2 juillet, de nombreux détenus des prisons parisien. nes; en juillet, ceux de Murat et 35 autres de Clermont-Ferrand; le 27, un contingent composé d’Alsaciens et de Lorrains et d’otages d’honneur de Nancy et de Maxéville; le 5 août, un important convoi d’hommes, de femmes et d’enfants en bas âge venus des Pyrénées; les 10 et 11 août, des intendants généraux, des officiers de tous grades, des fonctionnaires; le 22 août. un groupe venant de la prison de Fresnes duquel émerge la tête du frère du général de Gaulle; le 26, encore un convoi de Marseille qui comprend de nombreux enfants de 10 à 14 ans; le 29 octobre, une centaine de détenus de Nîmes; le 14 décembre, 150 de Nantua; le 20 janvier 1944, des centaines d’autres extradés du Fort de Montluc à Lyon; le 25 janvier 1944, 958 femmes arrêtées à Besançon, Bordeaux, Paris et Strasbourg; le 2 février, 80 femmes descendent de deux autocars venant de Laon; quelques jours plus tard, un groupe de Caen; le 30 mars, 75 prisonniers transportés en autocars de Fresnes au camp, cependant qu’en cours de route, un chauffeur coule volontairement une bielle pour favoriser des évasions, en vain; le 1er avril, des détenus arrivent de Rennes et le 12 avril d’autres détenus de Rouen; le 10 mai, des otages de Chantilly et de hautes personnalités, des militaires, des gendarmes, des douaniers, des cheminots; le 22, un contingent de la rafle monstrueuse de Figeac; le 2 juin, un autobus parisien, dans lequel sont entassés les membres de la municipalité d’Avron et plusieurs détenus, arrive de Fontainebleau. Sans être immatriculés dans les registres du camp, ces hommes3333 33 Dont le représentant industriel Desroches. Témoignage de sa veuve. sont immédiatement incorporés dans un convoi en formation qui part pour Neuengamme; le 3 juin, 1400 résistants mutins de la Centrale d’Eysses, parmi lesquels il y a de nombreux Compiégnois, en costume de bure et crânes rasés; le 5, un groupe venant d’Agen; le 16 juin, 36 détenus venant de Blois en camions; le 20, l’évêque de Montauban, bientôt rejoint par 86 oblats de Marie à qui les Allemands, incommodés par la vue des soutanes, remirent des habits civils en échange; le 24 juin, on note encore l’arrivée de détenus de Rouen; le 17 juillet, une quinzaine d’agents de police et de nombreux résistants de Compiègne, Noyon et de la région; le 7 août. un groupe de Besançon et de Dijon. Il en sera ainsi jusqu’au 16 août 1544.

Des braves gens victimes d’une confusion de noms ou arrêtés à la suite d’un attentat auquel ils étaient étrangers, sont internés, et certains, déportés. Les libérations octroyées dans ce cas furent rares.
La réception des internés se déroulait à quelques variantes près, de façon identique. Entrés par la grande porte du matériel, les nouveaux venus passaient leur première nuit aux baraquements C5, D et I. Chacun recevait une couverture, une gamelle -ustensile à usages multiples-, un ersatz de marmelade, 200 grammes de pain. Le menu ne variait guère, parfois le dimanche un peu de viande, 10 grammes de margarine pour corser la ’soupe’, quelques soupçons de rutabagas ou de pommes de terre, le matin un ’jus’ inqualifiable. Un régime de mort lente.
Le lendemain, dès l’appel de huit heures, douches au C1, visite à l’infirmerie par un médecin interné qui les examine sommairement par groupes de dix et ne retient que les cas graves. Nouvel appel et l’interné recevait une plaque de zinc de 65×18 qui portait son numéro matricule frappé tête- bêche, et dont il ne devait jamais se défaire. Cette plaque de zinc fut rem- placée en 1944 par une étiquette de 80×53 en carton de couleur orangée. munie d’un œillet. Le matricule, également frappé tête-bêche, était surmonté à gauche des lettres PHL, Polizeihaftlager, et à droite d’un C, Compiègne, en petits caractères de 2 millimètres. Certains internes portèrent aussi un brassard blanc chargé des lettres Z.I., Zivil Interniert. En juillet 1944 les internes recevront un simple carton portant, sur deux lignes, l’empreinte en plus grands caractères.
Après, venait la fouille des bagages au cours de laquelle, papiers, crayons, stylos étaient remis dans une enveloppe portant le nom du prisonnier. Le détenu était ensuite appelé trois par trois au D7 où, devant trois officiers et trois soldats, il déclinait son identité complète qui était inscrite sur une fiche individuelle que l’intéressé signait après avoir apposé ses empreintes digitales. Il devait aussi reconnaître que ses papiers et tout ce qui avait été saisi lors de son arrestation, l’avaient suivi. Enfin, une somme de 600 francs lui était remise.
Par rangs de cinq les nouveaux internés rejoignaient le bâtiment qui leur était assigné et s’installaient dans un des 24 lits à deux couchettes superposées des huit chambrées. Le chef de baraquement et ses adjoints logeaient dans une pièce à part. Une deuxième visite dite d’incorporation, effectuée le surlendemain par un médecin allemand, assisté de trois infirmiers internes, décidait de l’aptitude au travail. Peu de malades furent renvoyés dans leurs foyers, excepté ceux à qui leur santé trop altérée ne laissait pas d’autre alternative que la mort.

L’organisation des services intérieurs incombait aux détenus eux-mêmes, le doyen du camp étant le seul personnage en rapport avec les autorités allemandes qui désignaient les hommes de police parmi la pègre et qui. bien souvent, étaient plus barbares que leurs maîtres. Une de ces brutes, le Hollandais Porten, détenu de droit commun, fut rencontré à Paris en 1945 par une de ses victimes, Jean Panico, ancien interne de Royallieu, déporté à Dachau et mort en 1947. «Il y a des gueules qui ne s’oublient pas!», lui dit-il, en lui assénant un formidable direct au menton. L’ancien policier de Royallieu fut arrêté et condamné aux travaux forcés à perpétuité3434 34 Le Bataillon d’Eysses. .i.-G. Modin. Page 152. Amicale d’Eysses. Paris..
Annonces au sifflet, les appels rassemblaient à 8 ou 9 heures et à 17 heures tous les internés pendant trois quarts d’heure, parfois davantage. les Allemands n’étant jamais d’accord sur le nombre. Les douches ne fonctionnaient que tous les deux mois et, en dépit des mesures d’hygiène prises par tous, la vermine pullulait. Ce cheptel humain était livré à une mort lente. inéluctable, conséquence d’une carence des éléments énergétiques propres à la nourriture, indispensables à la vie de l’homme, mais ce système à tuer par inanition avait l’avantage d’être aussi efficace que le peloton d’exécution, la guillotine, la chaise électrique, la potence ou le bûcher. Il était essentiellement hitlérien.
Courrier clandestin
La correspondance, interdite pendant les deux premiers mois de l’internement, ne pouvait donc qu’être clandestine. Les nazis eux-mêmes en firent un trafic vénal et. en 1942, un sous-officier fut fusillé pour ce motif. Un autre demandait 100 francs pour poster une lettre bien souvent détruite et acceptait contre de l’argent comptant de remettre aux internes des colis confectionnés avec difficultés par les familles, colis qu’il réexpédiait à sa femme. Il se trouva même un transporteur de la ville qui possédait le monopole de la livraison des colis et qui se le vit retirer à la suite des nombreuses plaintes élevées non seulement pour le coût excessif, mais pour leur détournement. Il dut s’en expliquer à la Libération.
Le courrier lancé sur les routes était immédiatement recueilli par les habitants qui se chargeaient de son expédition. Les Allemands firent alors évacuer les maisons voisines. Tout étranger au camp était sollicité de poster des lettres, ce qu’il acceptait complaisamment. Un cultivateur de Venette, Bisseux, fut pris, arrêté et condamné pour avoir dissimulé du courrier dans ses bottes. La cuisinière des officiers. comprenant qu’elle est soupçonnés, s’enfuit de Compiègne alors même que la Gestapo venait l’arrêter. Mon beau-frère Emile Gavrel, qui livre du bois de chauffage, confectionne astucieusement une espèce de sacoche dans la bâche de son camion et les internés sont bientôt nombreux à se porter volontaires pour le déchargement. Mme Bourdon, femme du coiffeur qui demeure en face de la grande porte, autorisée à couper de l’herbe à l’intérieur du camp, ramasse les lettres jetées parles internes mis dans le secret jusqu’au jour où le ménage sera expulsé de son immeuble. De connivence avec un jeune employé du mess des officiers, les gérants du Nouveau Théâtre, les époux Pinson, assurent le courrier dans les deux sens, ils sont soupçonnés et priés de s’expliquer. Le facteur Baronick, qui recueille des lettres pendant la distribution qu’il effectue au poste de police, est pris sur le fait, fossé et détenu au camp pendant 48 heures. Moins heureux, le maçon Girard, qui exécute des travaux à l’intérieur du camp, collecte un volumineux courrier. Les sentinelles des miradors l’ont vu. Fouille, maintenu au camp. Girard part pour Buchenwald. Gravement malade, il est mort en 1959.
Les restaurateurs Dufresne, qui tiennent le Bar du Sud, font passer généreusement une correspondance considérable par l’intermédiaire de gardiens alléchés par de bons schnapps. Ces Allemands utilisent la petite porte qui s’ouvre sur le chemin de ronde à quelques mètres de l’établissement à l’angle de la rue du Mouton. Au cours d‘une corvée de nettoyage auprès de cette porte, le gardien Peters autorise Mme Dufresne à apporter aux internés une bouteille de vin qu’ils avaient demandée, L’argent sera sous la bouteille. Mais Peters a vu le manège; avec l’argent il y a un paquet de lettres que la restauratrice a emportées. L’Allemand se fâche, la brave personne explique qu’elle, Française, ne peut refuser son aide à des compatriotes malheureux. Le gardien se calme et demande seulement que cela ne se renouvelle pas. Il aura sa récompense.
Après deux mois de présence on remettait à l’interné une Postkarte allemande qu’il pouvait utiliser en écrivant au crayon le libellé suivant imposé: «Suis interné à Compiègne, ai le droit de recevoir colis de linge. Suis en bonne santé, n’ai ni le droit d’écrire, ni de recevoir de nouvelles; d’ici quelque temps, pourrai vous envoyer d’autres nouvelles.» Suivait la signature.

Les visites, en principe autorisées après six mois de présence, n’étaient en fait guère permises.
Un photographe chargé du tirage des 54000 photos d’identité et était tenu d’opérer et de détruire les clichés en présence des nazis. Il réalisa de la sorte des profits scandaleux.
La municipalité et la Croix-Rouge furent autorisées à faire parvenir deux ou trois soupes consistantes par semaine. De plus, la Croix-Rouge livra des pommes de terre dont rien n’était perdu, épluchures comprises, tant la faim tenaillait les corps squelettiques. Considérant que le Comité de la Croix-Rouge expédiait de trop abondants colis aux internes, plus «privilégiés» que les Allemands, le commandant du camp lui ordonna d’en limiter les envois. mais le Comité poursuivit son œuvre humanitaire en les expédiant des gares voisines sous des noms d’expéditeurs imaginaires. La Croix-Rouge fit parvenir ainsi pour 680000 francs de produits alimentaires et pharmaceutiques.
À la cantine, ouverte du mardi au samedi matin, on y vendait à des prix exorbitants des légumes mis au rebut, livrés par un Espagnol sans scrupule et dont un fils était pourtant mort dans les geôles de Franco. Aux clients de la ville qui les refusaient, il rétorquait que «ceux de Royallieu» seraient moins difficiles et «sauteraient dessus».
Un interné de Fonsomme, près de Saint-Quentin, membre de l’intelligence Service, Eugène Cordelette dit La Ficelle, réussit à entrer en liaison radiotéléphonique avec Londres. Un appareil lui avait été remis en pièces détachées au cours des examens médicaux auxquels il était soumis à l’hôpital et à l’insu d’un gardien allemand prénommé Ernst. Ce dernier ne se souciait guère de surveiller les médecins et les malades comme il aurait dû le faire. Une infirmière belge, Mlle Colinet, glissait ou retirait les messages dans les poches de la veste ou du pardessus d’un médecin traitant, lui aussi interné, qui venait à l’hôpital tous les lundis donner des soins aux internes malades. Ces faits et gestes passaient inaperçue, lorsque l’infirmière, méticuleuse, accrochait aux porte-manteaux les vêtements jetés négligemment sur les sièges ou sur les meubles par un médecin qui jouait la distraction.
Sur la route de Paris qui longeait le camp, les familles sollicitaient un poste d’observation du haut des véhicules qui circulaient, et recherchaient les figures chères auxquelles elles adressaient des signes affectueux par dessus la palissade. Les conducteurs compatissants passaient et repassaient au ralenti. Mais les tenanciers du «Café de la Victoire» voisin ont fait d’excellentes affaires en louant, toute honte bue, leurs fenêtres du premier étage aux familles qui s’y installaient pendant quelques instants. Les affaires étaient prospères, le café était fréquenté par les gradés allemands, et les propriétaires, que rien n’arrêtait, incitaient les jeunes femmes à se livrer à la débauche. Des plaintes furent déposées et la police ayant opéré une perquisition à la suite de détournements et de vols de colis, surprit tout ce beau monde attablé devant un poulet dont la provenance ne put être expliquée, car il lui avait été remis par une famille qui le destinait à un parent interné. Ce n’était pas le premier délit du genre car ces ignobles individus s’étaient offerts depuis longtemps, avec condescendance, à remettre ces colis aux destinataires par l’entremise de leurs bons compères. De retour de leur déportation, des anciens internes vinrent demander des explications à ces honteux proxénètes, mais ceux-ci, par prudence, avaient déjà quitté Compiègne. Le 24 juillet 1943 ils avaient été arrêtés et le café avait été fermé.
Parfois des colis étaient renvoyés à l’expéditeur et portaient la mention «nicht zustellbar», c’est-à-dire non distribué, l’infortuné destinataire ayant été déporté ou tout simplement fusillé.
Terroristes ?
Grâce à son volumineux courrier que j’ai pu consulter, j’ai pu voir l’immense dévouement dont fit preuve envers les déportés et les internés M. Michel. sujet suisse, représentant de la Croix-Rouge helvétique, qui ne cessa de s’entremettre auprès des autorités allemandes pour faire parvenir lettres et colis aux détenus. Des renseignements venus de part et d’autre furent prodigués aux familles qui ont eu recours à sa bienveillance.
Nous lui en exprimons notre plus vive reconnaissance.
Les familles angoissées par l’arrestation d’un ou de plusieurs membres dont elles ignoraient le sort, accouraient aux nouvelles à Compiègne ou adressaient un volumineux courrier à M. Michel. Celui-ci intervenait auprès des autorités du camp et du Sicherheitsdienst, le S.D., au 74, de l’avenue Foch, à Paris, qui centralisait les renseignements concernant les détenus, les Terroristes comme il les nommait. C’est lui qui les rangeait dans une des trois Klassen qu’il avait créées, ordonnait leur déportation et les exécutions.
Mais dans l’ignorance du numéro matricule les recherches des détenus étaient difficiles dans le cahier des effectifs du Sonderführer car les homonymes étaient fréquents parmi les 53 787 internes venus des villes et des campagnes.
Toutes nos provinces sont représentées par les noms de détenus que j’ai recueillis au cours de mes recherches laborieuses ou relevés dans les quelques archives, les listes ou les fiches du camp que j’ai pu rassembler. Il est impossible de les citer tous. Mais d’Abel à Zwilling, comme ils sont nombreux les Allard, Andrieu, Barbier, Baudry, Bernard, Bloch, Bonnet, Boucher, Brun, Caron, Carpentier, Chevallier, Coudert, Deschamps, Dreyfus, Dubois. Dupont. Durand (!), Flamand, Fonbonne, Fournier, Fraysse, Guillemin. Hervé, Lacombe, Lambert, Laporte, Leclere, Lefèbvre, Le Goff, Levasseur, Lévy, Marin, Marty, Michaud, Morel, Nédelec, Normand, Olivier, Paoli, Perrin, Petit, Renard, Roussel, Sauvage, Savignac, Terrier, Thévenin, Valade, Vandenberghe, Vasseur ou Wagner.
Les noms de nombreuses personnalités connues avant ou depuis la guerre retiennent l’attention:
Des ministres ou des sous-secrétaires d‘Etat: Biondi, Blalsot, Boulloche, Forcinal, André Marie, Me Masse, Mutter, Albert Sarraut, Marcel Paul, Sudreau, Me Henri Teitgen.
Des préfets et des sous-préfets: Bousquet, de Châlons, Brachard, de Nérac et, de 1954 à 1967, en activité à Compiègne, Bussière, des Bouches-du-Rhône, Chaigneau, des Alpes-Maritimes, Dupiech, de l’Aveyron. Durand, otage d’honneur comme la plupart de ses collègues, Faugère, de la Manche, Fouineau, de la Marne, Grimaud, des Basses-Pyrénées, Guérineau, de la Seine-Maritime, Kuntz, du Tarn, Lebillou, des Côtes-du-Nord, Picard, de Reims.
Des généraux: Bierre, Bonget. Bonneaud, Boucher, Challe et son fils Hubert, Dauphin, Didierjean, Duchemin, Durrmeyer, Escudier, Fontaine, Frère. Geyer de Pontivy, Gilson, Larbalétrier, de Nétunieres, Peller, Ployé, Poirel, Trinquand.
L’amiral Martin, âgé de 72 ans.
Des députés et des sénateurs: Hélène Solomon-Langevin, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Aubry, Vincent Badie, de Baudry d’Asson, Bessac, Boccagny, Charpentier, Christiaens, Georges Cogniot, Déohazeaux, Desjardins, Devemy, Dolze, Durand, Geffroy, Geslin, Heuillard, grand invalide de la déportation qui. avant de mourir, lançait de la tribune du Palais-Bourbon où il avait été transporté, une émouvante mise en garde contre le réarmement allemand, de Lagrange, Lambert, Lebas, Lenormand, Michaut, Mérigonde, Mondon, Neveu, Noël, Panico, Patria, Peytel, Quinet dévoré par les chiens à Hersbrück, Raymond, le docteur Renet-d’Estrées, Rochette, Rollin, Serre, Terrenoire, Tornay, Warusfel.
Des hauts fonctionnaires et personnalités: Baumgartner président du Crédit National; Flandrin et Perrin chanceliers; Brunet et Palack directeurs généraux, Boissard et de Carruy inspecteurs généraux, Cruchon rédacteur au ministère des Finances; Camille contrôleur général de l’Armée; Hacq directeur de la Police judiciaire, Hoen du ministère de l’Air, Lalande de Calan chef de Cabinet et Noguès secrétaire à la Production industrielle. Baron président de la Cour d’Appel. Dreyfus de la Cour de Cassation, Laemlé premier président de la Cour d’Appel de Paris, Eppel, Géry et Thomas professeurs à la Faculté de Droit de Strasbourg, Ancel, Jahan et Kahn en Sorbonne, Durand à Nancy. Farcy conservateur du Musée de Grenoble et Maurice celui du Cimetière du Père-Lachaise, Rousillon trésorier-payeur général de la Vienne.
Danielle Casanova, fondatrice de l’Union des Jeunes Filles de France, Geneviève de Gaulle, la nièce, et Pierre, le frère du général; les écrivains Louis Martin-Chauffier de l’institut, Charlotte Delbo, Arnyvelde, J.-J. Bernard, Chambon, R. Desnos, Pierre Durand, Max Jacob, Serge Miller, J. Semprun, Verdet; Goudeket le mari de Colette, Lebhar; les colonels Manhès et Frager, Ogée, Picot, Brutelle. A. Leroy, René le frère de Léon Blum, Michel le fils de Clémenceau, Jean et Pierre Sudreau, Rémy Roure, Mllienne, Maurice Bourdet et Georges Briquet journalistes à la Radio, les musiciens Berlinerblau. Bernstein, Garcia, Krawski premier prix du Conservatoire de Paris, Falk et Lattes compositeurs, Merville de Ricaud, Herdenberger sculpteur Grand Prix de Rome, Lynen - fusillé - et Mermoz cinéastes, Carruena champion de boxe et de hors-bord et Kid Francis de boxe, Melbosque aviateur, Villaplane international de football.
Des conseillers généraux: Gisèle Dujardin d’Amiens, Brézillon de Noyon, Desgroux de Beauvais, Gefiroy de Breteuil, Mureine de la Gironde. Des maires et des adjoints: Audibert de Senlis, marquis de Commarque d’Urval, Me Delarue de Bresles, Dutriévoz de Villeurbanne, Fourreau du Plessis-Trévise, Huon de Toulouse, Docteur Imbert d’Arles, Leca de Marseille, Mailhol de Sète, Mousseau de Foulily, Richard de Ribémont, Rollin de Saint-Dizier, Varagnat de Bondy, Vieiljeux de La Rochelle, âgé de 80 ans, Villiers de Lyon. Des ecclésiastiques: Mgr Théas évêque de Montauban, Mgr de Solages de l’Université catholique de Toulouse, le R.P. Riquet de Paris et le R.P. de la Perraudière de Tours, les abbés Bourgeois de Besançon, Brujeu d’Angoustine, Daguzau de Pau, Dubernet d’Ustaritz, Durtoil d’Orléans, Gay de Nantua, Hondet d’Hendaye, Massé de Lacroix près de Compiegne, Masure de Lille, de Maupou du Mans, Parquel de Montpellier, Renard de Fiévillers, Rosay de Duvaine, Stenger d’Ecrouves, Toulemonde de Nancy, Truffy d’Annecy.
Des pasteurs protestants: Heuzé et Roux de Marseille. Lemaire de Paris, Lobstein de Strasbourg.
Le Grand Rabbin de Bayonne Ernest Ginsburger, ancien Grand Rabbin de Genève et de Belgique.
Le protonotaire Mgr André Wrasky et les prêtres de l’Eglise orthodoxe Sobolev et Vilepine.
Des femmes et des jeunes filles: Mmes Audoul, Auffray, Aurély, sœur Baverey, Denise Bastide, Belrichard, Berthaud, Billard, Boillot, Jacqueline Cauzi, de Chabot, Chollet, Vittoria Daubeuf-Nenni fille du ministre italien Pietro Nenni, de Flamencourt, de Fiers, de Fleurieu, Fromageau, Georges, Gournet de Guise-la-Motte, Hamelot, duchesse d’Harcourt, Helma, Hervé, Jeudlin, Katz. Macault, Mauvais, de Mortimer, Muller, Patrigot, Peltier, Perrin, de Peyerimolf, Pican qui, libérée le 18 décembre 1941, revient le 23’ janvier 1943, Poirier, Mai’ Poiitzer, Pontremoli, Percheron, Racine, Reok, Richert, Richier avec ses deux filles et son fils, Salmson, Simone Sampaix, Spoerry, Thabut, Toude. Viéville, comtesse Viilardi de Montlaur, une Compiégnoise, Alice Viterbo, artiste lyrique italienne amputée d’une jambe, Wagner. Des colonels: Boissonnet, Bockler, Carlier, Duvernet, Fontaine, Glaise, Huret, Livage, Morme, Mossaz, Moussel, Miel, Quarez, Rinderknecht, de Sauveboeuf.
Les médecins qui firent des prodiges pour soigner les malades: Madame le docteur Don Zimet, les docteurs Andrieu, Bertrand, Bonneau, Brabander avec sa femme, sa fille et son fils, Breitman, Brion, Chartier, Chasseigne. Congy. Couronne, Denis, Ducios, Fuchs, Fructus, Gaiiuin. Gaudry, Gérard, Graux, Halpérine, Krewer, Le Basser, Lecaux, Lubanof,Lubliez, Mansart,Marsault, déporté volontaire en remplacement d’un malade, Maynadier, Nicolas, Parisot, Pincemin, Potez, Rodocamachi, Rohmer, Roos [de Noyonl, Segelle, Subert, Trocmé, Vaillant, Vilbert, Weil.
Les internés évadés en 1942: le sénateur Georges Cogniot et André Tollet, président du Comité Parisien de Libération; Le Gall et Louis, le frère de Maurice Thorez, repris et fusillés; Crapier, Désirat, Dudal, Gangnier Kesteman, Lambotte, Léonard, Leriquet, Renaud, Robert, Rossignol, Savenaud: Thouvenin, repris et déportés.
Des avocats: Me Arrighi, bâtonnier aux barreaux de Paris, Baron Baumel, Brascarrat, Chastaing, les deux frères Dreyfus, Fiquet, Hartweg, Lehmann, Pitard -fusillé-, Raynal, Ronilkas -fusillé -.
Des enseignants, des industriels, des ingénieurs, des policiers, des syndi- calistes, des résistants réputés: Agnans, Arjaliès, Aubert, Baleix, Bancal, Barba- zange, Baudouin, de Bernard, Bernstein marchand de biens, M" Blond commis- saire-priseur, Bocina, Boiron, Bouguet, Bouvier, de Bruc, Bureau, Callot, Chaussi- nand - qui aura le crâne fendu à Auschwitz -, Chauvel, Chérioux, Choquart, Cressot, Davesnes, Debord, Delfieu, Desbieys, Destouches, Donati, Duffaut, Dunois, Dutin, Escoffier, Evrard, Filhol, Fimbel, Flamencourt, Lucien Français, Gazzano. Gauthier ainsi que le comte de Marœil et Moët et Chandon des vins de Champagne, Girod, Goldfarb-Lévitan, Gossot, Gourdon, Guérineau, de Guillebon, Hablot, Hoppenot, Jacques, Jan-Py artiste peintre de la région de Compiègne, Jardel, Jattefaux, Kaufmann, Kleinpeter, Lalos, Laneuze, Lautissier, Lechevallier, Legros, otage libéré après l’exécution de son gendre, Lestrade, Luc, Magne, Malbos, Roger Mandon. Marchand, Michelin le père et le fils Jacques -des pneus-, Mijeat, Molinié, Montagne, Normann. Onfray, Papin, Parisot, Persane, Piette. Planchais, du Breuil de Pontbriand, Pornin, Poteau, Potez, Prunières et sa belle-sœur Paulette, Reboui, Reinier, Reville, Rogatiéri, Roger, Sommesous, Tamanini, Thierry d’Argenlieu, Thorel, Vauthier, Viroulet. Des officiers: Bonnal, Bousson, Desdois, Douce, Doudaucourt, Freumaux, Gougenheim sous le faux nom de Garnier, Graffin, Lavergne, Legrand. Limou- sin, Lledos, Mevel, Pierre, Rives -amputé d’une jambe-, de Rocquigny, d’Ussel.
Encore des personnalités: d’Ambert, Amyot d’inville, d’Andigné, Artaud de la Ferrière, de Bonnard, du Boÿs, Christian, Robert et Victor de Chabot, de la Chapelle, de Coëtnempan de Kersaint, Courtois de Vicose, de la Croix-Vauban, de Dampierre, de Dancourt, Jean et Louis de l’Estrade, Ferré de Bourgogne décédé à l’hôpital, du Fresne de Viral, marquis de la Guiche, de Guigny, de Haricourt, de Pimodan, de Lacoste de Laval, Ladan-Bockairy, de Lalande de Calas, de Lubersac, marquis de Lussac, de Mailly-Nesle otage d’honneur, de la Maison- neuve, de Marin des Bouillères, de Maupon, de Montalembert, de Moutiers, de Noailles duc d’Ayen, de Pourtalès, marquis de Prénouville, de Procheville, Pyrel de Poix, le comte Alaric et ses fils Maurice et Philibert de Rambuteau, Sauvage de Brantes, de la Vallée, Vínal du Boucher.
Et de nombreux autres personnages cités au cours de l’ouvrage.
Il y a des déserteurs de la Wehrmacht qui, inscrits sous de faux noms, ne seront jamais découverts, tels Leif de Montigny-les-Metz alias Leroy, Hirsch, un Autrichien, alias Kohn, le Roumain Alexandre Lazar, qui devient Etienne Mathais.
Les Belges, Espagnols, Hollandais dont l’ancien consul Bakbakker, Italiens, Luxembourgeois, Polonais, Russes, Suisses, sont très nombreux aussi bien que les Arabes, les Américains du Nord et quelques-uns du Sud, les Arméniens, les Asiatiques, notamment des Hindous, les Britanniques et des ressortissants de tous les pays du monde.
Le camp de Royallieu était une Tour de Babel.
Dignité
Pour éviter de sombrer dans la déchéance physique et morale, pour lutter contre le découragement, le cafard, l’avilissement que l’inaction pouvaient engendrer, des jeux de salon, du théâtre, des corridas, des compétitions sportives furent organisés. Les intellectuels traitaient les sujets les plus divers dans des conférences riches d’enseignement. Le poète Robert Desnos fit une piquante conférence sur l’inspiration poétique et des professeurs donnaient des leçons de français, d’histoire, de sciences ou de géographie, de langues étrangères et autres matières. L’interné Debieve, avec des outils de fortune, exécuta une statuette en plâtre symbolisant un déporté et, après l’avoir signée. l’enfouit dans le sol où elle fut découverte au cours de travaux ultérieurs.
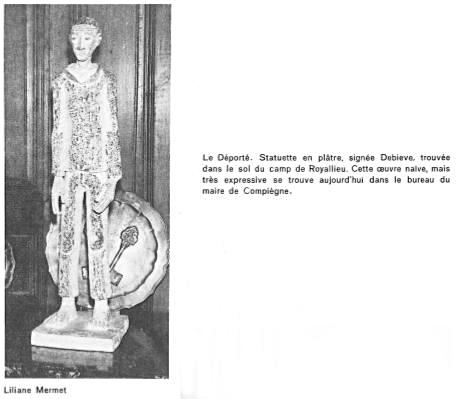
Il y eut même des concours de poésies, et j’ai eu la chance de relever le poème d’un ancien sous-officier de gendarmerie. François Quimerc’h. dont le nom trahit l’origine bretonne et qui habitait à Coudun près de Compiègne. Sexagénaire, affaibli, -il avait séjourné longtemps dans les colonies-, il fut interne seize mois au camp, sans motif valable. Son œuvre, que je reproduis. obtint un deuxième prix décerne le 1er septembre 1941 par un comité compose du professeur Jahan, de la Sorbonne, et de Georges Cognito, agrégé de l’Université, rédacteur au journal «l’Humanité».
Tenir coûte que coûte dans la dignité, tel est le mot d’ordre, et tous les moyens sont valables.
Un médecin-chef interné, le docteur Marsault, soignait un camarade pour une appendicite aiguë quand ce dernier fut désigné sur la liste de départ. «Le malade est intransportable» fait observer le docteur au commandant du camp, qui rétorque: «il me faut encore 150 hommes. J’en ai 149. Si vous vous opposez au départ de votre malade, prenez sa place dans le convoi». N’hésitant pas à sacrifier sa vie, le médecin partait le lendemain pour Dachau.
Les anniversaires patriotiques sont célébrés avec le plus grand faste possible. Celui du 14 juillet 1943 est le plus spectaculaire. Au réveil, de chambrée en chambrée. une puissante Marseillaise jaillit de toutes les poitrines, suivie de l’appel, auquel se rendent tous les internes y compris malades et invalides qui font, pour y assister, des efforts surhumains. Dans un garde-à-vous impeccable ils entonnent à nouveau notre chant national que l’écho répète aux alentours.
Puis, croyants et incroyants assistèrent alternativement aux divers offices: catholique, célébré par le R.P. Taschaud qui succombera dans le Train de la mort, orthodoxe, présidé par Mgr Wrasky, culte protestant au cours duquel le pasteur Heuzé, mort à Dora, pria comme les autres aumôniers pour la victoire de la France. Au cours de la journée les détenus possesseurs de leurs décorations les portèrent ostensiblement et répondirent à un ordre général d’appel inattendu. Une commission allemande composée de généraux et d’officiers supérieurs inspectait le camp ce jour-là. par hasard. Tous, dignitaires au premier rang, torses bombes, offraient aux regards, insignes de la Légion d’Honneur. Médailles Militaires, Croix de Guerre et autres distinctions, dans un alignement admirable. La commission allemande, surprise par tant de grandeur. passa devant eux sans détourner la tête; seul le dernier des officiers, troublé, salua gauchement.
Une manifestation d’un autre ordre se déroula le 12 août 1943. L’avant- veille une douzaine de généraux, un colonel, une dizaine de personnalités étaient venus renforcer le nombre déjà élevé des détenus. ils étaient tous des tenants du nouvel Etat Français, mais devant la tournure que prenaient les événements ils avaient changé de camp. Les égards des Allemands envers ces nouveaux venus dotés de chambres particulières attirèrent l’attention des internés moins favorisés et Michel Clémenceau, le fils du Tigre, interpellant un général qu’il reconnaissait, lui reprocha son attitude récente et sa soumission à Pétain qui, dit-il, est un traître. L’altercation faillit tourner mal mais reprit, lorsque ces personnages partirent pour l’Allemagne. hués au passage par les Américains et les Français qui les traitaient de vendus, traîtres, et autres termes similaires. Le double jeu ne payait pas3535 35 Cf. Frontstalag 122. J. Hoen. Bourg-Bourger. edit. Luxembourg..
Un sacré sacristain
Parmi les Marseillais arrivés en janvier 1943 se trouvait un individu inscrit sous le n matricule 12736 âgé de 40 ans prénommé Raoul, reconnu inapte pour l’Allemagne en raison d’une tuberculose osseuse dont il était affligé depuis plusieurs années. Son état de santé, sa grande piété. son extrême complaisance, l’avaient fait remarquer des ecclésiastiques internes comme lui. qui lui confièrent les fonctions de sacristain de la chapelle.
SOUS LE JOUG VICTORIEUX PRES DES LAURIERS
Dédié au bagne de Royallieu
Lorsqu’ici reviendrai, vous n’aurez plus besoin
D’enguirlander la porte
D’embellir les allées, ni d‘apprêter au loin
Une amicale escorte.
Je ne me perdrai pas sur les sentiers le soir
Ne me faites pas signe
Je m’assiérai dans l’ombre, où le bois sera plus noir
Et moins verte la vigne.
D’aucun hymne éclatant formidable et vainqueur
Ne trouble mon oreille
J’adore le silence accoudé dans mon cœur
Et perdu sous la treille.
Laissez la paix clore nos lèvres et nos yeux
Il ne faut rien entendre
Dans le recueillement l’instant sera plus tendre
Et plus délicieux.
Ne me demandez pas de récits de batailles
Ne me demandez rien
Un peu de nonchaloir sur ma bouche défaille
Taisons-nous tout est bien.
Comme il sera calme et pieux le stalag
Dans la nuit qui s’endort.
Entre mes doigts lassés penchera mon visage
Je songerai à nos morts.
Et si je ne puis alors sécher mes larmes
Ni taire mes regrets
Si pour moi Royallieu perd alors ses anciens charmes
Vous me pardonnerez.
1er septembre 1941. François QUIMERC’H.
N° matricule 1426.
Il se faisait fort de faire passer des lettres vers l’extérieur. demandant 100 francs pour leur acheminement y compris l’affranchissement de 1,50 franc pour une lettre ordinaire. Cependant, il s’avéra bientôt que les lettres n’arrivaient pas à destination, mais étaient détruites par le triste sire, qui encaissait bien l’argent. Il se trouva aussi qu’un camarade avait été victime d’un vol de 5000 francs, somme très importante à l’époque, mais le voleur n’avait pas été découvert.
Un autre incident vint s’ajouter aux précédents, et qui prit un caractère de gravité; deux internés liés par une solide amitié comme cela arrive souvent dans l’adversité, étaient désespérée au moment d’un départ, d’être séparés l’un de l’autre, le premier, Valuet, étant désigné, le deuxième, Bruno, ne l’étant pas. Ce dernier chercha, parmi les partants, un camarade susceptible de lui céder sa place et il insista tellement auprès de l’un deux, Wolfin, que ce dernier y consentit, de guerre lasse. La listé des déportés ayant été communiquée la veille il n’y avait donc plus de temps à perdre et les deux hommes échangèrent leurs plaques matricules, se confièrent réciproquement divers renseignements concernant leurs familles et d’autres, d’ordre général. Le lendemain le faux Wolfin accompagnait son camarade Valuet. Personne ne les avait trahis.
Un mois plus tard, après l’appel, un officier entra dans la chambrée et posa cette question à plusieurs détenus: «Comment vous appelez-vous?» À cette question, Wolfin répondit sans sourciller «Bueno!». Mais au terme d’un interrogatoire serré, Wolfin dut avouer la supercherie et fut mis en cellule pour deux mois. Tous se défendirent les uns après les autres de les avoir dénoncés, mais tous aussi furent unanimes à porter leurs soupçons sur le sacristain.
Celui-ci jura sur son chapelet qu’il n’était pour rien dans cette dénonciation, qu’il n’était pas non plus l’auteur des autres méfaits dont il était accuse, sans oublier la dénonciation du sous-officier allemand qui passait des lettres et qui fut fusillé. D’un commun accord, les détenus n’en parlèrent plus, mais surveillaient le sacristain, lequel se tenait sur ses gardes mais ne put résister à la tentation de renouveler ses exploits auprès des nouveaux internes. Pris sur le fait, en flagrant délit de vol, il reçut une bonne correction et fut puni de détention dans une chambre de discipline appliquée par le service de police des internés. Il fut également relevé de ses fonctions de sacristain modèle.
Quant à Wolfin, à l’issue de ses deux mois de prison nazie, punition de rigueur pour tout délit, suivie de déportation, il partit pour Buchenwald et mourut dans un kommando en Pologne3636 36 Récit de M. Michel, Otto et Prilssmann. Cf. Le Frontstalag 122. Page 157. Hoen..
Premier convoi de la déportation
Dès les premiers jours qui suivirent l’invasion de l’Union Soviétique, le 22 juin 1941, les Russes de toutes tendances sont arrêtés et conduits au camp où ils occupent les baraquements C4 et C8. Leur moral est admirable et leur confiance dans la victoire finale de leur pays est unanime. Soviétiques ou non, ils sont solidaires, fraternels, contrairement à ce que les nazis attendaient. À trois reprises la princesse Olga et un pope vinrent les visiter. En 1943, ils seront déportés soit en Allemagne, soit à Aurigny dans les îles anglo-normandes. Dans le même temps, des convois conduise rit au camp sous un déluge de vociférations et ’de coups des prisonniers politiques. communistes et sympathisants. Les arrivées se succèdent nuit et jour à un rythme accéléré dans les rues. Les compiégnois effrayés, restent tapis derrière leurs portes et leurs volets, qu’ils ont reçu l’ordre de fermer.
L’organisation est rationnelle parmi les Russes et les détenus politiques. les initiatives naissent de toutes parts, l’ordre, la discipline, la solidarité sont heureusement acceptés, les cuisines et les infirmeries fonctionnent avec les moyens du bord, le service médical est assuré avec difficulté par des médecins eux-mêmes internés comme les docteurs Breitman et Galluin, dévoués certes, mais dépourvus de produits pharmaceutiques.
Chaque semaine sinon chaque jour fournit son contingent. Les groupes sont plus ou moins importants mais celui du 3 août 1941, composé de communistes que la police française et la Gestapo ont arrêtés en zone occupée est particulièrement considérable.
Des milliers de détenus sont déjà au camp lorsque, le 15 décembre 1941, à 3 heures du matin, sous une pluie battante, un convoi de plus d’un millier de juifs vient grossir l’effectif, ils viennent pour la plupart de la région parisienne, les uns arrêtés depuis le mois d’août et détenus à Drancy, les autres raflés dans Paris l’avant-veille même. Il y a des médecins, des hommes de lettres et de sciences, des industriels, des commerçants, des personnalités du barreau, des employés, des ouvriers de tous âges, le plus vieux a 82 ans, un autre 78, une quinzaine a dépassé 70 ans. Huit avocats, parmi lesquels M Pierre Masse et Ulmo, transportés en autobus de Paris à Compiègne. viennent les rejoindre.
Dès le début la mortalité frappe durement les déficients et les malades, dont l’un agonise pendant plusieurs jours dans de terribles souffrances victime d’une hématurie et la solidarité est rare parmi ces malheureux juifs. Russes et Français des baraquements voisins s’efforcent de leur venir en aide et leur apportent des vivres alors qu’ils sont eux-mêmes livrés à la portion congrue et plus d’un juif leur devra la vie et un adoucissement de leur détention. Mais la Kommandantur, avertie de ces pratiques charitables, les interdit formellement et fait dresser une barrière autour de leurs baraquements. Cependant malgré ces nouvelles difficultés le soutien fraternel subsistera.
Parmi ces juifs, 300 d’entre eux, originaires d’Europe Centrale ou du bassin méditerranéen, dont le seul crime était d’être nés juifs, avaient déjà fui l’enfer nazi et se retrouvaient à Royallieu tenus au secret, privés de courrier, de colis et de tout contact avec l’extérieur. Cette année-là, l’hiver est précoce et dur, la mort fait des ravages parmi eux. Pour lutter contre l’inaction démoralisante, les intellectuels organisent des jeux, des cours, des conférences. des causeries sur des sujets les plus variés.
En janvier 1942, les lieutenants d’Eichmann, Danriecker et Brünner inspectent Royallieu; cette visite, ayant sans nul doute pour but d’appliquer à ce camp les méthodes d’extermination raffinées en usage dans ceux de l’Allemagne nazie, ne présageait rien de bon. L’ancien garçon de café Kuntz se distingue particulièrement, entre autres en prolongeant les appels sur le terre-plein en dépit des rigueurs de la température. Un jour qu’un homme manquait à l’appel, Kuntz refit le compte d’hommes cinq fois, fit sortir les malades et les infirmes. mais peine perdue. L’appel dura plus d’une heure par moins de 15° de froid. L’interné absent était à l’infirmerie, au Revier comme «Ils» disaient, mais à la suite d’un tel traitement trois malades mouraient dans les jours suivants.
Fin décembre 1941 une quinzaine de juifs de plus de 65 ans où grands malades avaient été libérés et une dizaine d’autres le furent également à titre de chefs d’entreprise jugés indispensables aux Allemands ou pour toute autre raison. Pour ceux qui restaient, les rations déjà insuffisantes s’amenuisèrent encore et leur distribution était l’objet de discussions animées. Au cours de l’une d’elles le soir du 10 février 1942 un interne juif rentra précipitamment le visage décomposé et s’écria: «Si vous saviez ce qui se passe en face en ce moment vous ne discuteriez pas de ces histoires de margarine! On vient de prendre trois otages à l’appel parmi les communistes et ils restent tous rassemblés, en chantant la Marseillaise!»3737 37 Le Camp de la Mort lente, page 179. J.-J. Bernard. Albin Michel.
Les nazis ne parvenaient pas à imposer le silence et le firent payer cher: mise au secret sans lettre ni colis pendant un mois et restrictions de toutes sortes. Dans le camp des juifs les discussions cessèrent. Quelques jours plus tard, les Allemands informèrent ceux qui étaient âgés de plus de 65 ans qu’ils seraient libérés à la date du 20 mars et qu’en conséquence ils pouvaient en aviser leurs familles. Celles-ci s’empressèrent de gagner Compiègne pour accueillir les leurs à la porte du camp. Elles apportaient des vêtements chauds et des douceurs. Après plusieurs heures d’attente, les portes s’ouvrirent enfin pour laisser passer un contingent de 178 malheureux israélites attachés deux à deux par des menottes, sous le regard cynique et railleur des soldats nazis masses à la sortie et qui hurlaient des vociférations assourdissantes en riant à gorge déployée. Comble de la honte et de l’infamie, cent gendarmes français, mis sur demande à la disposition des autorités allemandes3838 38 Rapport n 665 du commissaire de police au préfet de l’Oise., les encadraient et les dirigeaient vers la gare pour être transférés à Drancy. Des mères, des épouses, des jeunes filles, désespérées, s’écroulaient, d’autres criaient, pleuraient, les enfants, qui ne comprenaient pas, appelaient leurs pères tandis que la population compiégnoise, horrifiée, était refoulée dans ses demeures.
Le 27 mars 1942 un autre convoi de 1112 juifs, dénombrés par les S.S. au terme du voyage à Auschwitz, inaugurait la série de la déportation de France vers l’Allemagne. L’ordre était signé de von Stulpnagel, alors maître des destinées de notre pays et dont le chef d’état-major était Speidel, futur général commandant l’O.T.A.N. . Les Compiégnois, soulevés d’indignation, jetaient du pain à ces affamés, cependant que les plus valides transportaient dans des brouettes les moribonds que la mort allait bientôt délivrer. Au passage des femmes se signaient, les hommes se découvraient. De ce convoi quinze hommes seulement échappèrent par miracle de l’enfer d’Auschwitz où quatre millions d’hommes, de femmes et d’enfants furent exterminés dans les chambres à gaz et les krematoria.
La plaie était ouverte, l’hémorragie devait saigner la France selon le programme des nazis. L’inspection du camp par Dannecker et Brünner portait ses fruits.
Américains au Camp
Des ressortissants américains arrivèrent au camp dès la fin de décembre 1941. Les Japonais, qui venaient d’anéantir la flotte américaine à Pearl Harbor le 7 décembre sans déclaration de guerre, avaient déclenché automatiquement celle de l’Allemagne aux États-Unis.
Les Américains, dont les docteurs Roger Hays et De Barros, les femmes et les enfants étant séparés des hommes, furent incarcérés dans les bâtiments B de 5 à 8, dans lesquels se trouvaient déjà des sujets britanniques. Les internes de Jersey et de Guernesey occupèrent momentanément les C4 et C8. Leur détention était moins rigoureuse que celle des Russes et des communistes ou des juifs. la nourriture était plus substantielle et les Allemands leur manifestaient plus d’égards. Des sonneries de trompette à la française annonçaient les appels. la soupe et les différents services en usage dans l’armée. L’Américain Schliessmann, immatriculé sous le numéro 2162. assumait les fonctions de chef de camp.
Au cours d’une des visites largement autorisées eut lieu une évasion qui mystifia les geôliers nazis. Une Française, après s’être longuement entretenue avec un Américain, s’en revenait vers la sortie lorsqu’un interné politique l’empoigna par le bras et, en sa compagnie (elle était muette de saisissement), lançait comme à regret des signes d’adieu à son ami Américain, franchissant sans plus de façon la grande porte à la barbe des gardes et à la grande hilarité des internés. Cette familiarité fut de courte durée, notre homme disparut rapidement dans la nature, mais les Allemands élevèrent des grillages et des réseaux de fils de fer barbelés autour du camp américain afin d’éviter à l’avenir toute relation. Ce qui n’empêcha pas Anglais, Américains, Russes et Français d’échanger des signes d’amitié. C’est tout ce qu’ils pouvaient faire mais de chaque côté ils réaffirmaient leur conviction en la victoire commune.
Les Américains furent les témoins des douloureux événements qui assombrirent leur détention: appels interminables, désignation des otages, tueries des hommes sans défense, transports des morts dans un chariot bâché en direction du cimetière voisin, malheureuses victimes que seule honorera la sonnerie «Aux Morts» lancée par le trompette américain à ses camarades français.
Des avions inconnus (chacun était convaincu qu’ils étaient allemands et usaient de représailles au lendemain de la fameuse évasion des 19 communistes), larguèrent dans ce secteur anglo-saxon, dans la nuit du 23 juin 1942, vers 2 heures du matin, plusieurs bombes qui endommagèrent les baraquements B5 et B6, dans lesquels deux Américains trouvèrent la mort3939 39 J’ai relevé les noms de deux décédés: William Johnson et Edward Nitting.. Le soir du 31 juillet 1943, un autre avion inconnu lâcha quatre bombes dont une seule éclata. Le point d’impact principal se trouvait sur le terre-plein, non loin des bâtiments B1 et B2 qui abritaient les services administratifs et de triage et furent en partie détruits.
Enfin le 23 novembre 1943 une vingtaine de femmes de nationalité anglaise ou américaine furent acheminées sur Vittel où elles furent logées dans un hôtel, régime de faveur réservé aux seuls ressortissants anglo-saxons.
Femmes Françaises
Nombreuses sont les femmes, certaines avec leurs enfants, qui séjournèrent au Frontstalag 122 avant d’être déportées en Allemagne, pour la plupart à Ravensbrück. Toutefois le convoi du 24 janvier 1943 partit pour Birkenau-Auschwitz II. Il transportait 230 femmes venant de Romainville. Danielle Casanova, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Charlotte Delbo, Maï Politzer étaient du nombre ainsi que Olga Mélin-Moru de Pont-Sainte-Maxence et Hélène Castera-Vervin, native de Chiry-Ourscamp près de Compiègne, qui mourront en déportation. Les deux fils René et Gabriel Castera avaient été fusillés en 1942 et, en 1944, le mari Albert Castera disparaîtra à Mauthausen. À la libération du camp d’Auschwitz on dénombrait 181 disparues parmi lesquelles on relevait les noms de nombreuses mères avec leurs filles, comme Emma Bolleau avec Hélène, Charlotte Douillot avec Rolande et Henriette, Sophie Gigand avec Andrée, Marie-Louise Morin avec Madeleine, Marie Richier avec Odette et Armande4040 40 «Le Convoi du 24 janvier» dans lequel Charlotte Delbo relate le calvaire de ces malheureuses qui sont nommées. Editions de Minuit.. Le fils, André Richier, et Albert Moru, le frère d’Olga Melin, se trouvaient dans le même train parmi les hommes qui partaient pour Oranienbourg.
Plus récalcitrantes et plus audacieuses que les hommes, les femmes en imposaient à leurs geôliers. Deux jours plus tard, le 26 janvier, les Marseillaises et leurs enfants les remplaçaient dans les baraquements C1 et C5. Originaires du Midi, d’Afrique Centrale ou du Maghreb, ces malheureuses, qui affrontaient brusquement les rigueurs d’un hiver auquel elles n’étaient pas habituées, tombaient les unes après les autres et mouraient de faim, de froid, d’épuisement.
Le 26 avril 1943, un convoi de 213 femmes venant de Romainville arrivait au camp vers 20 heures. Transportées de la gare en camions et en tombereaux, leur arrivée fit sensation. Un brin de muguet au corsage, elles chantaient la Marseillaise devant les nazis furieux et impuissants à obtenir le silence. il y avait là des gaullistes et des communistes, des patriotes toutes solidaires. Conduites au baraquement C8, elles adressaient des signes d’amitié aux hommes qui cherchaient anxieusement à reconnaître un visage ami ou même une parente.
Le C8 était masqué par de hautes palissades devant lesquelles se tenait une sentinelle interdisant toute communication avec les nouvelles détenues. Montés sur les rebords de leurs fenêtres, hommes et femmes se reconnaissaient, les questions fusaient de toutes parts, faisant connaître identité et résidence. Des époux se retrouvaient et des parents qui ne pouvaient que s’envoyer des baisers et échanger seulement quelques paroles.
Les jeunes du baraquement A8 situé à l’autre extrémité, montés eux aussi sur leurs fenêtres, interpellaient joyeusement les jeunes filles, lesquelles, naturellement, n’étaient pas en reste, formaient des grappes aux fenêtres et se racontaient des bêtises qui engendraient la bonne humeur, lorsque survint le S.S. Jaeger tenant en laisse son chien Prado, un effrayant molosse, qu’il lâcha aussitôt dans la chambres. L’animal bondit sur plusieurs internes en les mordant cruellement: l’un d’eux avait un bras déchiqueté et dut être transporte à l’hôpital où il resta deux mois.
La même tragédie faillit se renouveler le 27 avril 1943 vers 18 heures. Une internée fit appeler son mari et son frère par un détenu, mais lorsque ceux-ci s’approchèrent du baraquement des femmes, l’Homme aux Chiens apparut avec Prado, qu’il lança sur eux. Effrayés, les détenus rentrèrent précipitamment et un retardataire ne dut son salut qu’à l’aide de deux camarades, dont Hoen4141 41 Frontstalag 122, par J. Hosn. Bourg-Bourger, édit. Luxembourg., qui le hissèrent en toute hâte par la fenêtre.
Le lendemain matin, il y eut deux départs, au petit jour celui des hommes et dans la matinée celui des femmes, mais celles-ci refusèrent de marcher, et certaines crachaient aux visages des Allemands. il fallut les transporter en camions et, toujours le brin de muguet au corsage, elles chantaient à tue-tête «Allons au-devant de la Vie», la «Marseillaise», «l’Internationale», «le Chant des Girondins», ameutant la population. Tous ces chants étaient repris par les internes, qui saluaient et acclamaient des femmes héroïques. Parmi elles se trouvaient Henriette Carré, de Monceaux non loin de Compiègne, et son amie Rose-Marie Lecoutey-Dorange. Elles partaient pour Ravensbrück.
En juillet 1943, 70 femmes, juives ou étrangères, se trouvaient encore au camp.
Il me souvient avoir vu au cours d’un de ces trajets entre la gare et le camp une pauvre femme qui, malgré sa forte corpulence, ne pouvait plus porter sa valise devenue pour elle trop pesante. Dans la montée de la petite rue de Paris je m’approchai d’elle et lui pris la valise, mais une centaine de mètres plus loin un soldat de l’escorte se rendit compte de mon aide. il me fit remettre la valise à la malheureuse et m’entraîna dans le groupe. Cinq minutes plus tard, il me fit déguerpir violemment, en me menaçant de sa mitraillette. La pauvre femme faisait pitié.
Le 25 janvier 1944 un contingent de 958 femmes vint grossir le nombre des internées. Elles étaient de toutes opinions et de tous âges: des grand-mamans de 86 ans, des jeunes filles de 16 ans. Parmi ces femmes on reconnaissait celles de la haute société, celles du peuple. Des registres incomplets, nous relevons les noms de Mmes Sardin chef de camp, Georgette Bach, sœur Baverey (de Besançon), du Buisson de Courson -arrêtée comme otage à la place de ses fils disparus-, Charlotte Cavelier de Cuverville Jacquelige Francis-Bœuf, Rose Gaillot, Geneviève de Gaulle nièce du général, Stéphanie Kuder, Renée Lascroux, Dora Rivière, Irene Terza, Jacqueline Weill. Cauzi. Quatre Compiégnoises sont du nombre: Marguerite Blanc-Lemonnier Adrienne Blanchard, Rolande Cottard-Strippe et Madeleine Dubois. Elles chantaient des chants patriotiques, criant leur foi en la France immortelle. Cette fois encore, les Allemands ne purent les dompter et la veille de leur départ ils les enfermèrent au C4 à raison de plusieurs centaines par local, serrées les unes contre les autres à un point tel qu’elles furent dans l’impossibilité de se baisser et restèrent debout toute la nuit. Le lendemain 31 janvier 1944 elles étaient embarquées à destination de Ravensbrück.
En Allemagne, la plupart d’entre elles, étant restées sourdes aux avantages du travail volontaire (seules deux condamnées de droit commun acceptèrent), elles furent conduites à la poudrerie de Holleischeim où leur entrée fit sensation. Au pas, encadrées par des S.S. ahuris, elles entrèrent, très dignes, chantant une vibrante Marseillaise, ce qui fit sortir de leurs blocks les prisonniers de guerre, qui se découvrirent et acclamèrent ces courageuses Femmes Françaises 4242 42 Souvenirs d’Holleischeim. Georgette Bach. Bulletin de l’Amicale des Anciennes Déportées de Ravensbrürk. Septembre 1960..
Les Marseillais
Immédiatement après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, en novembre 1942. Les Allemands occupèrent la France entière sans rencontrer de résistance militaire. Il n’en fut pas de même avec la population civile de la zone dite libre. Marseille le quartier du Vieux-Port, considéré comme un refuge de terroristes et de résistants fut cerné dans la nuit du 22 au 28 janvier 1943 par 5000 soldats nazis renforcés par des gardes mobiles français.
Les habitants de ce vieux quartier furent expulsés et autorisés à n’emporter que des bagages à la main. Quelques privilégiés purent cependant en prendre davantage. 15 000 d’entre eux furent dirigés au camp de Fréjus pour y être rassembles et après triage, les Méridionaux pouvant justifier d’un hébergement dans l’agglomération phocéenne furent libérés. Plus nombreux, les autres Méridionaux, les indigènes d’Afrique du Nord et Centrale, les étrangers de toutes confessions furent transférés à Compiègne le 26 janvier 1943. Pendant ce temps les Allemands avaient entrepris un dynamitage en règle du quartier situe au nord du Vieux-Port, de l’Hôtel de Ville à la cathédrale, tous deux endommagés. Cette joie de détruire, cette Schadenfreude bien allemande, dura trois semaines et immeubles et le mobilier compris, ne furent plus que ruines.
À Compiègne, l’arrivée de ce cortège de gueux comme sortis des cartons de Callot, était pénible à voir: deux mille hommes, femmes et enfants, des bébés à peine vêtus, arrivaient sans transition en plein hiver dans notre région peu clémente, après avoir quitté le beau soleil du Midi. Aussi la mort fit-elle des ravages terribles parmi ces infortunés, on compta une quarantaine de décès par mois de janvier à mars, une soixantaine les trois mois suivants. Le cimetière proche atteste l’importance de cette mortalité.
Femmes et enfants occupèrent les C1 et C5, les hommes les C2, C3, C6, C7. De nombreux indigènes partirent dans l’Organisation Todt, dans les camps de travail du «Mur de l’atlantique» et dans le Midi dès le printemps, cependant que 48 Marseillais vinrent les remplacer fin mars et un autre groupe le 26 août. 1642 Méridionaux seront voués à la déportation à Orianenbourg. Il n’en revint que 200.
Au cours de ce séjour un Sénégalais fut abattu un dimanche matin par une sentinelle. L’interné s’était approché des clôtures et une balle par ricochet l’avait atteint à la cuisse, occasionnant une blessure béante qui le conduisit à l’hôpital.
Otages et martyrs
On compte 29660 otages fusillés en France de 1941 à 1944. Mais les otages prélevés au camp de Royallieu et fusillés en forêt de Compiègne, dans les environs, au Mont-Valérien, 45000 fusillés, ou autres lieux de supplice inconnus, internés abattus par les sentinelles ou déchiquetés par les chiens. tués dans les bombardements, morts d’inanition ou faute de soins, forment un total impressionnant de 2700 victimes que les autorités nazies se sont bien gardées de publier.
Dès sa création, le camp fut un réservoir dans lequel les nazis ont prélevé a loisir les otages qu’ils fusillèrent pour «frapper l’opinion française». Les noms de ces malheureux figuraient sur une liste divulguée au cours d’un redoutable appel général. À l’énoncé de cette terrible sentence l’attitude courageuse des otages était l’expression la plus haute de la dignité française devant la mort. Tous restaient au garde-à-vous et chantaient une Marseillaise enflammée. C’est ce qui eut lieu en septembre 1941, lorsque les nazis désignèrent Me Pitard, l’avocat du Syndicat des Métaux, Haaj et Ronilkas qui furent fusillés au Mont-Valérien le 20 septembre.
Fin mars 1942, D. Durville de Soissons, C. Gariou, conseiller municipal de Paris, A. Lefèbvre de Rouen, E. Michaud de Livry-Gargan, L. Rechossière d’Aubervilliers, P. Rigault4343 43 Dans son dernier message, Rigault exprimait l’ambition d’être un peu de sang qui fertilisera la terre de France. d’Ivry furent un matin transportés dans un camion bâche, assis sur leurs cercueils de bois blanc. À huit heures et quart. dans une clairière, à l’écart de Carlepont, liés à trois bouleaux, ils furent fusilles par un peloton de feldgendarmen. Leurs corps furent remis au maire. qui reçut l’ordre de les inhumer dans le plus bref délai dans leurs bières ensanglantées, sans aucune pièce d’identité. Après la guerre, grâce à quelques indices recueillis sur le lieu du supplice, à 20 kilomètres de Compiègne, ils furent identifiés par le maire Jean Lerouge, qui fut lui-même déporté.
Le 31 mars 1942. Gustave Delarue, de Le Houlme près de Rouen, Levasseur, et dix autres victimes non identifiées, qui avaient été libérés, du camp de Royallieu peu de temps auparavant et repris la veille de leur exécution, furent assassinés près des Beaux-Monts, au carrefour des routes de l’Armistice et Eugénie. remis au maire de Vieux-Moulin dans les mêmes conditions, mais la municipalité réussira à replacer les corps dans des bières de chêne. Le 10 mai 1946, en présence des familles. J’ai pu moi-même identifier deux suppliciés parmi les dix autres inconnus 4444 44 Une plaque du souvenir, placée par mes soins le 14 août 1946 sur les lieux du supplice, a été bientôt subtilisée..
Jean Delattre, 18 ans, et Scheid furent fusillés le 9 mai 1942 à 21H15 au carrefour des routes des Beaux-Monts et de la Faisanderie et inhumes au cimetière du Nord, à Compiègne. Le même jour le gardien de celui du Sud recevait l’ordre de la Kommandantur de faire creuser trois tombes et d enterrer immédiatement, entre 21 et 22 heures, trois autres cercueils contenant des fusillés inconnus.
Le 11 août 1942 les nazis s’emparèrent de 93 otages qui furent fusillés dans des lieux restés secrets. Au cimetière proche du camp, celui du Sud parmi les 260 tombes d’internés inhumés, on y relève les noms de dix otages dont on sait avec certitude qu’ils ont été exécutés, ce sont: Arsoni Joseph, Boulet Maurice, Dedame Maurice, Denhauten Victor, Demarcq Fiené, Giraudon André, Guidicelli Charles, Lecomte Gustave, Léger André, Vinckbrooms Maurice, auxquels s’ajoute le nom de Gaston Dewulder, tué au combat près de Noyon en 1944, et qui eut la tête écrasée pour empêcher l’identification.
Tout ce qui aurait pu témoigner de leurs crimes était falsifié par les nazis, ainsi, par exemple, on trouve dans le cahier des effectifs du Sonderführer, dans la colonne -Motif de Départ-, au nom de Giraudon André, le mot -évadé- en date du 13 juin 1944; or, son corps exhumé et identifié lors de son transfert dans son pays d’origine était percé de balles, preuve de son assassinat.
Que sont-ils devenus les Lecole, Portay, Vert, Brion, Hem, Cassagnes, Hulot, Drouhay, Colombert, Vaurs, Nicolas, et tant d’autres, portés évadés, et dont on N’a jamais retrouvé la trace? Sur d’autres pages, Findel, 24 ans, matricule 46.664, de Chartres, Gaumonolie, 21 ans, 46.666, de Limoges, Gehrmann, 26 ans, 46.667, dont la femme était déportée, sont portés transférés4545 45 Leurs camarades ne les virent plus après l’appel du soir du 13 août 1944.. Leurs corps ont été découverts en forêt de Compiègne le 18 janvier 1946 par deux concitoyens, Monteil et son fils Roger qui, tous deux intrigues par un terrier de renard, s’en approchèrent et virent, avec effroi, un membre décharné, élargissant l’ouverture, le père comprit le drame et prévint la gendarmerie qui fit dégager les trois corps. L’un avait le crâne fendu, les deux autres avaient été tués d’une balle dans la nuque.
Le 30 août 1944, deux scouts parisiens, Alain Demeurisse, 20 ans, et Francis Prieur, 21 ans, sont arrêtes dans la côte du Murget, près de Verberie, et fusillés le même jour par les S.S. à la Faisanderie, sur la route de Pierrefonds.
Plusieurs cadavres enterrés depuis trois ou quatre ans ont été mis à jour en 1947 entre la route de Soissons et le passage à niveau du Buissonnet, sous 0,60 mètre d’humus et il est probable que la forêt n’a pas encore livré tous ses secrets et que de nombreux martyrs, toujours ignorés, y reposent encore. Dans le camp même, s’il faut en croire l’ancien interne Ropagnol, d’Aulnay-sous-Bois, les corps d’un médecin de Sotteville et de sa fille, tous deux fusillés, auraient été jetés dans une tranchée que Ropagnol et d’autres détenus avaient été contraints de creuser.
Certains ont perdu la raison, d’autres ont préféré mourir sur le sol de leur patrie, comme ce désespéré qui, le 26 juin 1943, s’échappant du convoi qui le menait à la déportation, se jeta dans l’Oise après avoir enjambé le parapet du pont. Les Allemands déchaînes et hurlant, mitraillèrent le malheureux emporté par le courant rougi. Au cimetière du Sud, parmi les autres tombes, repose encore un autre noyé inconnu.
Fréquemment des internés s’approchaient des fils barbelés sans s’en rendre bien compte, malgré les nombreux panneaux et les menaces’ d’une sentinelle. Ce n’était pas des avertissements pour la forme. Un détenu fut tué net, un dimanche matin, pour avoir enfreint la consigne. D’autres camarades affamés subirent le même sort en cherchant de quoi manger parmi les immondices. Une nuit de juin 1943, un Hollandais, profitant de l’obscurité pour se ravitailler de la sorte, se trouva pris sous le feu d’une sentinelle d’un mirador, fit le mort, se releva d’un bond et s’élança vers son baraquement, le A1. La sentinelle reprit son tir, sans l’atteindre, mais les vitres de l’infirmerie volèrent en éclats.
Un détenu qui faisait sécher son linge, voit son mouchoir s’envoler par un coup de vent inattendu et se poser sur les barbelés, il y court pour le récupérer mais un coup de feu tiré sans sommation lui fracasse la jambe. Par un beau clair de lune, dans la nuit du 14 avril 1943, vers deux heures du matin, un avion survole le camp tandis que la sentinelle du mirador voisin du bâtiment D le mitraille. L’avion fait demi-tour, lui envoie à son tour une rafale sans succès, mais un interné du A6 est grièvement blessé à la tête et, transporté à l’hôpital, il y succombe quelques jours plus tard. Avec le débarquement des Alliés, les alertes sont de plus en plus fréquentes à la grande satisfaction des détenus qui croient à une prochaine libération et viennent contempler le spectacle réconfortant des impressionnantes forteresses volantes. Pour calmer leur enthousiasme, les nazis furieux leur dépêchent quelques rafales de mitrailleuses, blessant ou tuant certains d’entre eux.
Le 9 août 1944, à la suite d’un sévère bombardement aérien qui avait gravement endommagé le trafic ferroviaire et dont je reparlerai, deux cents internés s’affairaient à la réfection des voies, lorsqu’ils furent pris eux-mêmes sous un plus violent bombardement de la R.A.F. Cherchant un refuge, mitraillés par leurs gardiens, les malheureux durent subir l’effroyable déluge de fer et de feu qui s’abattait sur eux. Plus de soixante cadavres furent recueillis cependant qu’une vingtaine de blessés transportés à l’hôpital échappèrent de ce fait à la déportation. Une vingtaine d’internés purent s’évader et trouvèrent un accueil bienveillant par les habitants de Compiègne et des communes voisines. On ignore le nombre des disparus car, fidèles à leur habitude, les Allemands ne donnèrent aucun renseignement quant au nombre et aux noms des victimes dont une trentaine furent identifiées par la police et la Croix-Rouge.
Jaeger, l’homme aux chiens
Le plus ignoble, le plus barbare des gardiens du camp fut bien le S.S. Erich Jaeger4646 46 S.S.: Schutzstaffeln, Echelons de protection du Parti Nazi.. De petite taille, ivrogne invétéré, cette brute fut la terreur des internes qui le désignerait sous le sobriquet de l’Homme aux Chiens. Sa tâche consistait principalement à veiller la nuit sur le camp. Son adjoint, prénommé Andreas, était un boxeur qui n’avait de cesse de s’entraîner avec un adversaire imaginaire ou réel. En 1943, Andréas tua d’une balle dans la tête un blessé qui tentait de s’évader et qui avait été- pris dans les barbelés. Le malheureux avait eu l’innocence de donner de l’argent à Andreas comme prix de sa complicité. Jaeger avait à sa disposition deux redoutables molosses, Klodo, berger allemand d’une force terrible, l’autre, le plus féroce, Prado, un mâtiné de bull-dog.
Un soir, une ambulance vint chercher cinq malades dont l’état nécessitait le transport immédiat à l’hôpital, mais comme il n’y avait que quatre brancards dans la voiture, le cinquième malade dut attendre près de la porte du camp, qu’on vienne le chercher. Pris d’une soudaine folie furieuse, Jaeger lâcha ses chiens sur le malheureux qui, en quelques instants, fut mis en pièces. il arriva un jour qu’au cours d’une corvée effectuée à l’extérieur du camp, un interne s’é¿:happa et se réfugia derrière une meule de blé dressée dans un champ de la rue Saint-Germain, face à la rue du Mouton. Il eut la malencontreuse idée de ne pas fuir immédiatement. Mal lui en prit, Jaeger survint avec ses chiens qui découvrirent l’homme. Excités par la brute, ils s’acharnèrent sur le malheureux et arrachèrent des lambeaux de chair de son pauvre corps ensanglanté. Il ne resta bientôt plus qu’une loque humaine qui hurlait de douleur et déjà agonisait devant les gens du quartier figés d’épouvante. Nul ne sut jamais son nom.
Le 9 février 1943, un groupe d’internés méridionaux résolut de s’évader et, pour mettre toutes les chances de leur côté, imagina de soudoyer les gardiens. Ces derniers, y compris Jaeger, conclurent le marché pour une somme de 300000 francs à verser en espèces, en or et en bijoux qui fut effectivement remise. L’évasion fut fixée à minuit, les fugitifs devaient se frayer un passage à travers le réseau de barbelés, non loin du baraquement A1, et s’enfuir par la route de Paris.
À minuit, après des heures d’attente, Jaeger coupa le courant, plongeant le camp dans l’obscurité totale. Deux Corses sortirent les premiers et munis de cisailles s’apprêtaient à couper les fils barbelés, tandis que quatre détenus attendaient près d’une fenêtre du A1, le cœur battant, et deux autres à l’extérieur étaient prêts à les rejoindre. Brusquement Jaeger rétablit le courant, les mitrailleuses et mitraillettes entrèrent en action dans les faisceaux des projecteurs braqués sur les malheureux. Deux hommes tombèrent aussitôt, un troisième à genoux implorait le pardon et criait: «Maman, maman». En vain, il fut abattu. Dans une épouvantable chasse à l’homme les nazis se ruaient sur les fuyards et les abattaient sans pitié à bout portant. Quatre s’affaissèrent sans vie, un cinquième, blessé, mourut le lendemain à l’hôpital, un sixième, blessé lui aussi, évanoui, fut épargné: le revolver du nazi s’étant enrayé, il ne put lui donner le coup de grâce.
En quelques instants l’ordre était rétabli. l’ordre hitlérien s’entend. Le lendemain, après l’appel du soir, les détenus ensevelissaient leurs pauvres camarades et, en dépit des ordres de rompre les rangs hurlés furieusement, figés au garde-à-vous, ils regardaient charger les dépouilles des malheureuses victimes conduites au cimetière. Du camp américain une sonnerie lugubre retentit, dernier hommage «Aux Morts» de cette tragédie. À peine guéri, le survivant de ce drame dut subir les 28 jours de prison réglementaires pour tentative d’évasion.
Quant à Jaeger, l’Homme aux Chiens, il n’a jamais été inquiété.
Évasions
Si toutes les évasions ne sont pas couronnées de succès, les tentatives sont nombreuses. Les internés usent de tous les stratagèmes pour s’évader. Marcel Paul, futur ministre de la Production, simule une appendicite aiguë, aussi est-il dirigé à l’hôpital afin d’y être opéré. Il y reste deux mois, mais il est veillé avec tant de sollicitude qu’il lui est impossible de s’échapper et revient au camp. À peine rentré ii entreprend, avec quelques camarades, la percée d’un souterrain partant d’un petit local du bâtiment qu’ils occupent. Ils découpent une dalle dans le ciment avec tant d’art que personne ne s’en était aperçu, jusqu’au jour où Marcel Paul revint, le 18 juin 1946, en qualité de représentant du gouvernement, présider une Manifestation du Souvenir.
Ce jour-là, il souleva la plaque insoupçonnée et il découvrit l’entrée d’un souterrain dont la poursuite des travaux avait dû être abandonnée en raison du départ pour Buchenwald. La terre et les gravois, provenant des travaux, se trouvaient toujours dans les combles où ils avaient été transportés et disséminés sur toute la surface du plancher pour en équilibrer la charge. Le ministre, que j’accompagnai ce jour-là, tint aussi à revoir sa chambre d’hôpital et remercier l’infirmière, Mlle Colinet, qui lui avait prodigué les soins et qu’il reconnut.
En 1942, plusieurs évadés réussirent à tromper la surveillance de leurs gardiens. L’un d’eux, un audacieux, quitta brusquement la corvée qui descendait la grande rue Saint-Germain et se glissa dans un convoi funèbre qui se rendait à l’église voisine en se mêlant aux invités complices qui le dissimulèrent de leur mieux. Arrivés près de l’église, le curé et les assistants le réconfortèrent. lui donnèrent argent et vêtements et le conduisirent en voiture a la gare et l’inconnu disparut dans le train qui l’emportait vers une vie meilleure. Le soir, un homme manquait à l’appel et Jaeger fut chargé de le rechercher. Ses chiens le dirigèrent à l’église et là ils tournèrent en rond à l’endroit d’où la voiture était partie. Jaeger furieux dut se rendre compte que l’interné était perdu pour lui.
Une autre fois, c’est à la file des clients qui viennent chercher leur lait à la ferme Delahoche, que se joint un autre détenu qui partait en corvée. À l’insu des propriétaires il monta au premier étage où le fermier enfin prévenu le découvrit. Dans la crainte de voir apparaître Jaeger et ses chiens, le propriétaire lui indiqua le bon chemin par lequel le fugitif disparut.
Une autre évasion qui ne manqua pas de saveur fut celle d’un petit homme que ses camarades appelaient le jockey et qui provoqua une hilarité générale tant au camp que dans la ville, sauf, bien entendu, parmi les Allemands. Cet interne n’avait pas été sans remarquer qu’une voiture-citerne de vidanges venait opérer fréquemment au camp. Peu loquace, taciturne, il résolut de profiter de cette circonstance pour s’évader, à l’insu de ses camarades. Aussi, lorsque la citerne revint, s’intéressa-t-il aux diverses manœuvres de la curieuse machine, autour de laquelle le vide s’était fait rapidement. Se montrant d’une complaisance sans égale il aida l’employé dans toutes les opérations et lorsque, celles-ci terminées, le conducteur reprit le volant, son assistant désintéressé prit place à |’arrière, s’ingéniant è maintenir les tuyaux en équilibre. À la vue du véhicule, les sentinelles s’empressèrent d’ouvrir la grande porte et de la refermer promptement. L’interné complaisant n’en demandait pas plus. Mais à l’avenir deux soldats accompagnèrent sans entrain la citerne dans tous ses déplacements à l’intérieur de l’enclos.
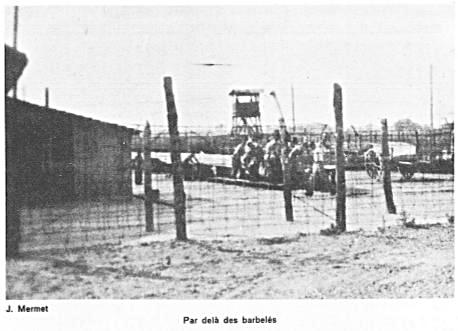
Au cours d’une corvée de bois en forêt un audacieux s’enfuit à travers les futaies et les ronces. Le gardien surpris courut après le fugitif, mais seul. impuissant, craignant que les autres n’en fassent autant, il tira sur l’évadé, lequel jouant à cache-cache s’abritait d’arbre en arbre et retrouva la liberté.
D’un convoi qui se dirigeait vers la gare et profitant de l’éloignement temporaire du serre-file, un risque-tout sortit du dernier rang, bouscula un commis charcutier, le rassura, prit le guidon de sa bicyclette en mains, regarda ses camarades s’éloigner, remit le vélo à son propriétaire ébahi et disparut.
Un moniteur de gymnastique de l’école de Joinville ne put résister à la tentation d’effectuer une performance gymnique. S’aidant d’une planche découverte dans le camp il exécuta un saut à la perche en largeur d’une haute tenue, franchit le réseau de barbelés ainsi que la palissade et se retrouva rue du Mouton auprès d’un habitant qui lui remit argent et vêtements que le fugitif lui renvoya dès son retour en lieu sûr.
Une autre évasion impromptue celle-là, s’était produite en février 1942. Avant d’être autorisé à repartir, le camion d’un fournisseur venait d’être inspecté par les sentinelles et s’engageait dans un virage proche de la sortie. C’est alors que. profitant du dit virage qui les dissimulait à la vue de leurs gardiens, Georges Cogniot empoigna un camarade et le fit monter précipitamment dans le véhicule qui franchit la grande porte emportant le chanceux. La plus spectaculaire des évasions et la plus réussie se déroula le 22 juin 1942 et fut relatée par Cogniot et Désirat qui y prirent part4747 47 L’évasion. G. Cogniot. E.F.R., edit. Nous nous sommes évadés de Compiègne. Ch. Désirat. S.P.F., édit.. Elle avait été menée de façon magistrale dans le plus grand secret puisque certains bénéficiaires n’en furent avertis qu’au dernier moment.
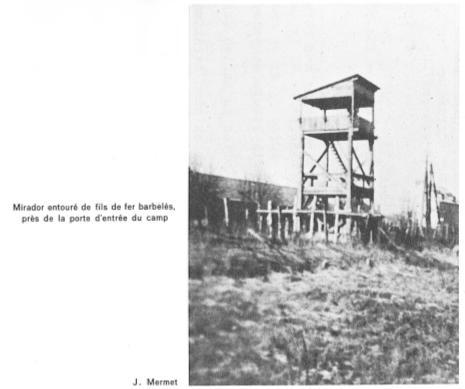
Les auteurs du projet avaient réussi à mystifier le feldwebel en lui faisant admettre que le puisard voisin de la cuisine était engorgé (ils l’avaient bouché à la surface) et que l’infection qui s’en dégageait et l’écoulement des eaux sales non seulement incommodaient grandement les cuisiniers. mis dans le secret, mais menaçaient de provoquer des épidémies. Le feldwebel, persuadé qu’un nouveau puisard était devenu nécessaire par mesure d’hygiène. ordonna à quatre hommes de faire le forage d’urgence. Un puits fut creusé à trois mètres de distance du puisard incriminé, par deux mineurs de Briey et de Neuves-Maisons lesquels. secrètement, amorcèrent un tunnel en direction du mur d’enceinte. Ce nouveau tunnel recoupait l’ancien puisard qui devenait ainsi une décharge naturelle. Un gros tisonnier transformé en un ciseau à froid de trente centimètres forgé sur le fourneau de cuisine, une truelle dérobée. un piochon de maçon fabriqué grossièrement constituaient un outillage de fortune. Deux hommes seulement travaillaient à la fois dans le nouveau puits, au ralenti, et cette lenteur des travaux n’était pas sans inquiéter le feldwebel qui venait fréquemment constater |’avancement des travaux. Son apparition était annoncée par des coups au sol et des chansons (convenus) et les mineurs affairés dans le tunnel cessaient immédiatement leurs travaux. L’Allemand ne voyait dans le fond du puisard que deux hommes épuisés mais qui s’arrangeaient bien pour masquer l’entrée du souterrain.
Afin de ne pas compromettre le projet d’évasion par une durée des travaux trop longue, il fallut se résoudre à terminer ceux du puisard dont la mise en service réjouit énormément le feldwebel et les cuisiniers qui ne tarissaient pas d’éloges. Les travaux reprirent à l’intérieur du bâtiment E2 dans un très petit local à l’Est de leur chambrée dans lequel les hommes découpèrent dans les règles de l’art une dalle de 0,700,50 m dans le ciment du sol. Ils ouvriront une trappe dans le plafond pour le passage d’un camarade chargé de disperser les 20 tonnes de terre provenant des nouveaux travaux. Après des semaines de dur labeur, suffoqués par le manque d’air et la chaleur dégagée par les lampes électriques dérobées au matériel, des hommes exténués arrivaient à l’air libre à la sortie d’un souterrain de 48 mètres de long et de 0.60 à 0,70 de section dont une quinzaine de mètres avaient été creuses en même temps que le puisard.
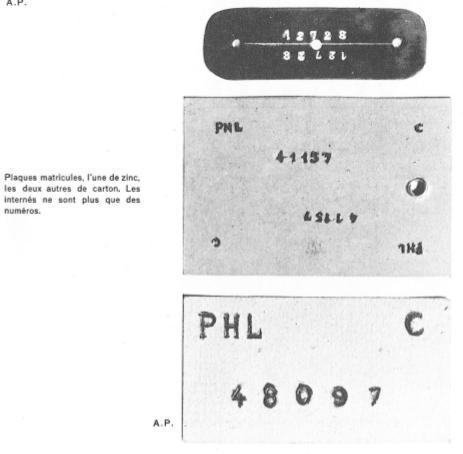
Restait à établir la liste des bénéficiaires. Ce fut l’occasion d’une douloureuse délibération. Tout le monde admettait qu’un choix s’imposait, une évasion massive pouvait être fatale.
À l’extérieur du camp, les F.T.P. prévenus montèrent la garde auprès de la sortie du souterrain afin de piloter et d’aider les fugitifs. La date d’évasion était fixée au 18 juin. En cas d’accident, ma femme et moi, nous devions héberger les fuyards et, le cas échéant, les blessés. Jacques Bourgeois, Robert Georgelin, Leroy le père et son fils Claude, Marcel Letort se relayèrent en vain trois nuits de suite, à peu de distance des sentinelles allemandes.
Leroy nous fit part de ses inquiétudes et de ses craintes quant à l’issue de l’aventure. mais le surlendemain il nous annonçait que les évadés avaient choisi le moment le plus favorable pour s’échapper, et personne ne les attendait plus. En effet le lundi 22 juin 1942 alors que les nazis se remettaient de leurs libations du dimanche, les internés avaient organisé une grande fête au camp: on jouait Clochemerle ce soir-là et dans la journée il y avait eu même une corrida, un jeu d’échec vivant, du sport mais le soir, des perturbations malencontreuses dans le courant électrique génèrent les spectateurs, internes et gardes-chiourmes. Cependant elles furent mises à profit par dix-neuf hommes qui s’enfuirent, accueillis à leur sortie du souterrain par un immense bouquet de blé vert qui s’agitait en attendant le dernier faucheur. Livrés à la liberté.ils se séparèrent, les uns partant vers Meaux à travers la forêt, huit autres prenant le train à Le Meux à 10 kilomètres de Compiègne, sans plus de façons.

Le lendemain Jaeger déchaîne lança ses chiens sur la piste des fuyards, sans succès. Des généraux dont von Stulpnagel et un état-major d’officiers nazis vinrent enquêter sur place étant donné la personnalité des évadés et furent stupéfaits par le magnifique travail accompli. Le Kommandant Pelzer et le feidwebel jurèrent qu’on ne les y prendrait plus et infligèrent des sanctions rigoureuses à l’ensemble des internes considérés comme complices: trois heures de marche par jour dans le camp, mise au secret, brimades de toutes sortes furent leur lot pendant plus d’un mois. La nuit suivante, un avion inconnu larguait à basse altitude ses bombes sur le camp qui endommagèrent les bâtiments B1 et B2. Les internes ne bougèrent pas. Par expérience, ils s’étaient persuadés qu’il s’agissait de représailles et que des gardes-chiourmes les attendaient à la sortie pour les massacrer, vraisemblablement.
Dès le surlendemain, les décombres furent chargés dans un camion B-45 que conduisait le chauffeur Colinet qui fut singulièrement surpris, en stoppant sur le chantier, de voir « se dénicher » du châssis du véhicule, un évadé, ancien mécanicien de chez Citroën. Réconforté, revêtu de nouveaux vêtements, pourvu d’argent et conduit à la gare de Le Meux-LaCroix-Saint-Ouen, l’audacieux regagnait Paris.
Dans le même temps les évadés reprenaient leurs places dans le combat clandestin, mais quinze jours plus tard Louis Thorez, le frère de Maurice secrétaire général du Parti Communiste Français, et Le Gall étaient repris et fusillés à Romainville. Quinze autres retomberont dans les mains de l’ennemi et seront déportés. Georges Cogniot, sénateur, et André Tollet, futur président du Comité Parisien de Libération, restaient à leurs postes de combat.
Le 2 novembre 1942. trois autres détenus s’évadaient de la gare de Compiègne au cours d’une corvée. Le succès de la fameuse évasion des communistes hanta les esprits, mais nombreuses furent les tentatives qui échouèrent : celle du 6 février 1943 par exemple, ainsi que celle qui avait son point de départ de la chapelle en direction de la route de Paris, alors que sous l’autel, le tunnel était déjà ébauché.
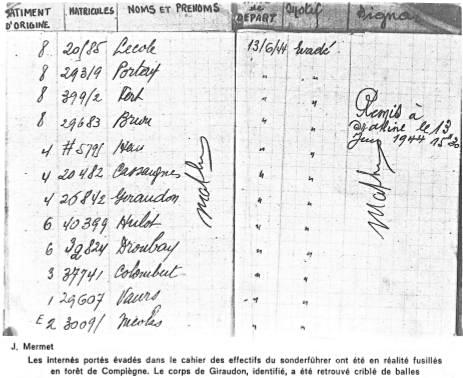
Par contre. Chimaud, de Persan-Beaumont, réussit à s’évader à sa deuxième tentative.
Une autre évasion tentée par cinq Bordelais et Marseillais en partant du A1 échoua également.
Plusieurs détenus parmi lesquels Mailhol, le maire et Tamhon un commerçant de Sète et le cheminot Leif de Montigny-les-Metz, avaient prévu une évasion massive de 300 internés au rythme de cinq hommes toutes les 10 minutes. Un tunnel de 25 mètres de longueur ayant 80 centimètres de diamètre était déjà creusé lorsque Jaeger et ses chiens se dirigèrent vers les deux couchettes qui dissimulaient l’entrée. Un traitre avait vendu ses «camarades». Les 58 coupables furent, pendant un mois, mis au secret, sans couchettes ni colis et le baraquement fut consigné.
Le 26 juin 1943 un convoi de déportés sortait du camp en chantant la Marseillaise. Ils étaient encadrés par des vieux réservistes que des gendarmes français devaient renforcer. Massés sur les trottoirs, Compiégnois et parents éplorés assistaient au départ lorsque le lieutenant commandant le détache- ment hurla : «Arrêtez ! pas chanter! Verboten ! C’est minable, c’est minable!» répétait-il. Le convoi s’arrêta brusquement provoquant une confusion inespérée. Familles et passants se précipitèrent et recueillirent des lettres. Les soldats débordés et visiblement indifférents ne réagissaient pas, cependant que les gendarmes français en attente dans la rue du Mouton, ne manifestaient aucune hâte à prêter main-forte. Un détenu, puis un deuxième s’engouffraient au Bar du Sud où les propriétaires Dufresne s’empressaient de les cacher. Dix-huit autres trouvaient refuge dans le voisinage. En passant sur le pont, un vingt-et-unième se jetait dans l’Oise. Les mitraillettes crépitèrent et mirent fin à son désespoir.
Le lendemain la Kommandantur faisait connaître que la présence de la population serait à l’avenir sévèrement réprimée.
Trois semaines plus tard, le 18 juillet 1943, deux autres détenus. Pruneau et Peretti s’évadaient encore d’un convoi et disparaissaient dans le couloir du café tenu rue de Harley, par Mme Fourdrinier qui les hébergea dans son grenier. Le groupe Résistance leur procura les faux papiers nécessaires.
La trahison, la malchance, le détail stupide auquel on n’a pas pensé ou le départ imprévu vers le bagne furent en général la raison des trop nombreux échecs. Et. pour contrecarrer toute aide extérieure, un ordre du capitaine Kehrenberg de la Bezirkskommandantur, en date du 20 novembre 1943, interdisait -à partir de maintenant, de louer des chambres à des étrangers, indifféremment allemands ou français, (les membres de la Wehrmacht inclus)-. Cette interdiction concernait les habitants des rues de Paris, du Mouton et du Chemin de St-Germain. Plus péremptoire, la Feldkommandantur 638 réquisitionnait les 15 et 28 janvier 1944 -pour les besoins de l’armée allemande- toutes les maisons qui avaient vue sur le camp.
L’heure de la déportation
On conçoit aisément que la pensée de la déportation ait été pour les internés une obsession douloureuse. Les convois, les transports comme disent les nazis, sont fréquents, groupant les uns cent à cent cinquante déportés, d’autres plus importants de 1500 à 3000 malheureux.
À l’heure de la soupe de midi tous les internés étaient prévenus qu’un appel général aurait lieu dans la cour centrale à 14 heures. À l’heure dite, le chef de la police du camp sifflait devant chaque baraquement et 3000 internés s’alignaient par rangs de cinq. En présence du Sonderfûhrer, des sous-officiers et des soldats allemands, le doyen du camp informait les déportés désignés qu’ils devaient se présenter devant les tables installées sur la pelouse, munis de leurs plaques matricules. Les malheureux recevaient l’ordre de retourner dans leurs chambres pour faire un paquet des objets qu’il était interdit d’emporter et qui devait être expédié aux familles le lendemain à neuf heures.
Le jour suivant, les déportés désignés pour le départ, remettaient argent. pièces d’identité, couteaux, papier à lettres, tabac, cigarettes, allumettes, vivres. Une dernière carte brune imprimée mise à leur disposition et postée beaucoup plus tard ne portait que ces simples mots: «Je serai transféré dans un autre camp, ne m’envoyez plus de colis: attendez ma nouvelle adresse». C’était en fait l’annonce officieuse de la déportation.
Des bobards invraisemblables couraient parmi les futurs déportés après cet appel fatidique, toujours entremêlé d’erreurs et de répétitions fastidieuses. Les uns assuraient que les partants deviendraient travailleurs libres, bien payés, auraient droit au courrier, aux permissions et bien d’autres avantages. Des lettres étaient lancées à la hâte sur les chaussées et que les habitants recueillaient et faisaient parvenir aussitôt à leurs destinataires. L’heure était émouvante, ceux qui allaient partir serraient avec effusion les mains de ceux qui restaient, les embrassaient et par groupes de cent se massaient sur le terre-plein. Un sous-officier et une douzaine e soldats opéraient une dernière fouille et prélevaient les objets interdits. Par dix, les partants se présentaient déshabillés et déchaussés. puis reprenant leur place dans les rangs étaient conduits au camp C pour y passer la dernière nuit sur la paille épandue sur le sol. Près des tables, les objets confisqués remplissaient des caisses prévues à cet effet.

Dans le baraquement C5, dernier dortoir obligatoire, les uns étaient muets, les Autres, et particulièrement les jeunes, chantaient à tue-tête des chansons souvent obscènes comme une révolte de leurs corps insoumis. Le lendemain après une dernière distribution de vivres de route composés de 1200 grammes de pain. d’un morceau de saucisson savamment épicé qui les fera terriblement souffrir de la soif et d’un beau colis confectionné par la Croix-Rouge que les Allemands volaient la plupart du temps, les déportés encadrés de soldats, fusils ou mitraillettes aux poings quittaient le dernier coin de France. De toutes parts éclatait une puissante Marseillaise dont les paroles n’avaient jamais été aussi chargées de signification et que les hurlements gutturaux des nazis n’arrivaient pas à étouffer.
Par la rue de Paris, parfois par la grande rue Saint-Germain et celles de l’Oise ou de Bon-Secours, les déportés passaient au pied de la Tour du Beauregard, dont les onze siècles d’existence furent les témoins de ces pitoyables marches aux enfers capables d’émouvoir ses vieilles pierres. Parfois au passage, des infortunés avaient l’ultime consolation d’entrevoir une femme, un parent, un ami, avertis en hâte par un courrier clandestin, cependant que la population malmenée. refoulée. tentait d’escorter ces pauvres gens et adressait des signes d’espoir et d’affection.
49 860 internes, hommes, femmes et enfants firent ce trajet. Pour beaucoup ce fut celui du dernier voyage.
Le 27 mars 1942, un convoi de 1112 juifs ouvrait la triste série de la déportation, il partait pour Auschwitz, il n’y eut que quinze survivants. Le 5 juin 1942, un autre convoi d’un millier d’hommes les rejoignait; le 6 juillet un autre de 1034 déportés, un autre encore fort de 911 déportés, le 29 octobre 1943. Celui du 27 avril 1944 comprend 2254 déportés, dont deux médecins qui avaient répondu à l’appel de leur nom commun « Docteur Denis» et qui pour éviter tout malentendu, partent ensemble. En quatre groupes, ils se rendent à la gare en passant par des itinéraires différents pour ne pas exaspérer l’hostilité des Compiégnois, il y a parmi eux de nombreuses personnalités, les futurs ministres, Boulloche, Marcel Paul, Sudreau, les poètes Robert Desnos et André Verdet. Le 12 mai, le convoi repartait d‘Auschwitz pour Buchenwald où n’arrivaient que 1 680 déportés. Le 25 mai. Desnos était transféré à Flossenbourg et le 2 juin à Flöha avec 185 camarades. Sous la poussée soviétique, le 14 avril 1945, le camp était évacué par les S.S. qui, dans les environs de Reitzenhain, exécutèrent 57 déportés parmi lesquels 23 Français dont Hodel, ami du grand poète. Arrivé enfin à Térézin, Desnos, atteint du typhus, mourait le 8 mai 1945 auprès de son camarade Lechevallier qui fit le même périple. Le jour-même, le camp était libéré et l’Allemagne capitulait.
Le 23 septembre 1942, un convoi partait pour Brunswick.
Les départs pour Buchenwald sont particulièrement nombreux et importants : le 13 janvier et en février 1943, les 22 mars, 6 et 9 avril, le 8 mai, le 25 juin, 962 hommes, les 7 et 12 août des petits groupes, le 2 septembre 900 hommes, le 17 septembre 1100 hommes dont plus de 60 meurent étouffés en cours de route, les 23 septembre et 20 octobre, encore des petits groupes, le 28 octobre 911 hommes, le 15 décembre 930 hommes, le 17 janvier 1944, un convoi de 1928 hommes, le 22 janvier 1803 hommes, le 27 janvier 1580 hommes dans un train qui démarre après six heures d’attente en gare, le 12 mai 2055 hommes, le 11 août 1650 hommes et le 16 août 1246 autres déportés.
D’autres convois partent pour Ravensbrück : celui du 24 janvier 1943 transporte 230 femmes dont Danielle Casanova et Charlotte Delbo, qui seront transférées à Birkenau, camp d’extermination d’Auschwitz II. Seules 49 survivantes rentreront en France. Le 28 avril, ce sont 213 femmes qui sont transportées dans des tombereaux à la gare, puis le 31 janvier 1944, 958 autres femmes, le 17 avril un autre convoi ainsi que les 8 et 18 juillet. Enfin, le 17 août 1944, cent femmes venues de Romainville dans quatre autobus repartaient dans les mêmes voitures pour Ravensbrück.
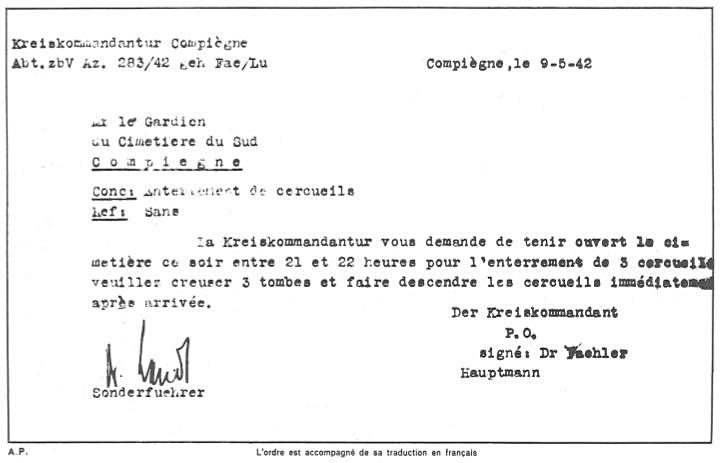
Les transports vers Mauthausen partent le 16 avril 1943 avec 1200 détenus. le 20 avril avec 1500 autres parmi lesquels on remarque des marins de Toulon: ce jour-là, les déportés furent entassés dans les wagons de voyageurs d’un train qui repartait pour l’Allemagne après avoir rapatrié des prisonniers de guerre libérés. Le 2 mars 1944 et pendant les mois de mars et avril 1944, des petits groupes de S0 déportés se succèdent et atteignent Mauthausen après un court séjour à Sarrebruck. Le 22 mars 1500 hommes, le 5 avril 1500 autres, le 27 mai 2500 déportés parmi lesquels le R. P. Riquet, Picot et le doyen de la Faculté Zemansky.
Deux convois partent du camp, l’un le soir du 23 janvier 1943, composé de 1000 hommes qui passent la nuit froide dans leurs wagons demeurés près du quai, et qui seront déportés à Oranienbourg, l’autre de 230 femmes qui les rejoignaient le lendemain matin et prenaient le même train, à destination d’Auschwitz.
Le 3 septembre 1943, 293 détenues partaient pour Flossenbourg. Au milieu du Groups, la haute stature de Pierre de Gaulle attirait les regards. Le frère du général devait rejoindre le Kommando du Schloss Elsenberg. Des contingents suivaient le 21 mai 1944 vraisemblablement.
1200 hommes étaient embarqués le 6 juin 1944 à destination de Neuengamme. Le sous-préfet de Nérac, Brachard, était du nombre. La veille, au cours de l’appel redoutable. un sous-officier allemand lança : -Jean Brachard- deux hommes répondirent «Présent», l’oncle et le neveu, qui ignoraient être dans le même camp. Le problème fut vite résolu: au lieu d’un seul ils partiront tous les deux. Le 15 juillet. 1000 autres suivaient dont le Compiégnois, Marcel Mérigonde, puis un autre millier le 28 juillet.
Une longue colonne de 2140 déportés partit pour Dachau le 18 juin 1944. Des personnalités fort connues en faisaient partie : les parlementaires Vincent Badie, Blaisot, Lambert et Neveu, le préfet Picard, l’abbé Schumacher, le général Friesse, les colonels de la Chapelle et Dutaret, Georges Briquet. Louis Terrenoire, Arjaliès, Prunières et le brave docteur Marsault qui, volontaire, remplaçait un malade. Le 2 juillet, le tragique train de la mort les rejoignait avec ses 984 cadavres.
Dès le début de 1944, le Haut Commandement allemand ordonna de liquider tous les camps et les prisons de France sans exception et d’acheminer dorénavant les détenus vers Compiègne, désormais seul grand centre de rassemblement où arrivées et départs se poursuivirent à un rythme accéléré.

Le 22 janvier 1944, l’important convoi de 1808 déportés, parmi lesquels le ministre Albert Forcinal, Julien Cain, administrateur général de la Bibliothèque Nationale, Roger Heim, directeur du Muséum d’Histoire Naturelle, les industriels Michelin, le père et le fils, notre ami Charles Bossi, en partance pour Buchenwald passait devant notre porte chantant le Chœur des Girondins. Les strophes «Mourir pour la Patrie» prenaient tout leur sens en un tel instant. Au premier rang, cheveux argentée au vent, le colonel Frédéric Manhès de sa voix puissante encourageait ses camarades et n’était pas le moins ardent. Sur le trottoir, l’ancien cheminot Lacroix manifestait ouvertement sa sympathie. Rejeté dans le convoi, il fut refoulé à coups de crosse, 200 mètres plus loin. Prenant en hâte un chemin détourne, je me postais près de la grosse Tour, et découvert, raidi dans un respectueux garde-à-vous, je saluai au passage ceux qui allaient mourir.
Ceux du bataillon d’Eysses
Le 30 mai 1944, 1200 hommes partaient du centre de détention d’Eysses pour être embarqués à la gare de Penne d’Agennais à destination de Compiègne. Le trajet fut interminable, rendu plus pénible encore par la chaleur implacable qui transformait les wagons en étuve. Les sabotages des résistants firent que le train venant du Lot-et-Garonne et de la Garonne se retrouva à Tours, au Mans, contourna Paris pour parvenir à Compiègne enfin, le 3 juin. Les hommes étaient à bout de force et mouraient de soif.
En cours de route, les nazis avaient tué un Espagnol, Huergas. Un homme, Edouin eut un bras arraché à la suite d’un sabotage du train, un autre fut blessé par les S.S. qui tiraient sans raison sur le convoi, un troisième, le Polonais Mendrok fut blessé d’une balle dans les reins. Ces trois blessés demeurèrent sans soins jusqu’à Compiègne, leurs camarades n’ayant pu faire qu’un garrot de fortune au bras d’Edouin4848 48 Le Bataillon d’Eysses. J.-G. Modin. Amicale d’Eysses. Paris..
Éblouis par la lumière qu’ils n’avaient pas vue depuis trois jours, barbus, les yeux et les lèvres sanguinolents, en haillons, les détenus noircis comme des ramoneurs descendaient des wagons et ne se reconnaissaient plus. Encadrés par des automitrailleuses et des soldats armes, par la rue de Paris, ils gagnèrent le camp. De la plaie béante du grand blessé s’exhalait la repoussante odeur d’infection, qui précède la gangrène. Le malheureux conduit a l’hôpital fut amputé et échappa à la mort et à la déportation.
Cruelle ironie du sort, parmi ces nouveaux prisonniers, il y avait une dizaine de nos amis : Chevallier le père, Marcel et le fils, Jacques et Thaye de LaCroix-Saint-Ouen, Bourgeois, Langelez, Lesne, Letort de Compiègne, Biette de Creil, Lemaire de Cuise-la-Motte, Morel de Ribécourt, ils passèrent devant nous le crâne rasé, en costume de bure, mais personne ne les reconnut. Ils vinrent occuper les baraquements du camp C et furent mis au secret. Le 16 juin, 36 otages venus de Blois et d’Eysses vinrent les rejoindre et séjournèrent une quinzaine de jours, pendant lesquels les nouvelles du débarquement et le spectacle quotidien des forteresses volantes américaines partant déverser leurs cargaisons sur l’Allemagne, leur apportaient l’espoir d’échapper à la déportation. Mais le 17 juin, 2140 internés, parmi lesquels le pharmacien compiégnois Pierre Liénard, devenu le numéro 40593, furent avisés de leur départ prévu pour le lendemain. À cette annonce les Espagnols qui formaient un important contingent se rassemblèrent. entonnèrent l’émouvant hymne républicain de Riego et d’admirables flamencos dont les accents ajoutèrent au pathétisme.

Après une fouille impitoyable, le 18, de bon matin, le pitoyable troupeau humain regagnait la gare par la rue Saint-Germain et là, Marcel Letort passant devant la maison paternelle adressait à sa famille désespérée des signes d’adieu.
Avant de monter dans les ignobles wagons, 40 hommes et 8 chevaux, dans lesquels ils allaient être entassés par cent, un lieutenant S.S. leur adressait les recommandations qu’il jugeait nécessaires: «Pour une tentative d’évasion, nous vous tasserons à raison de deux cents par voiture, pour un évadé, dix seront fusillés, pour deux tout le wagon.» Les S.S. hurlent «Los, los, schnell !», les coups s’abattent. Le train part, il est sept heures4949 49 Georges Ambre, de Lyon. lança sur le ballast, à Guise-la-Motte, un billet qui tut recueilli par une inconnue qui le renvoya à la famille avec des mots d’encouragement. Vingt- deux ans plus tard, en 1966, Ambre, aidé du Conseiller général du canton. Marcel Merigonde, ancien de Neuengamme, identifie l’expéditrice, Mme Caron, aujourd’hui à Chantilly, et qu’il put remercier..
Sans eau, sans air et sans lumière, asphyxiés dans des wagons clos et plombés comme des cercueils, ils arrivaient le 20 juin à 14 heures au terme du long voyage à Dachau. Abandonnant leurs morts dont le nombre ne sera jamais révélé ils découvraient un univers inconnu.
Convoi de la mort
Le long du bâtiment de la gare des marchandises, point de départ de tant de déportés, un train, en stationnement sur les lignes qui mènent à l’infini, attend toutes portes ouvertes sa cargaison humaine. C’est dimanche, il bruine, et les Compiégnois qui se rendent à la première messe en l’église Saint-Germain, croisent avec tristesse un convoi de déportés.
Encore un! Deux autres convois vont suivre dans la matinée, escortés par les mêmes S.S. qui font la navette de la gare au camp. Le Kommandant s’est montré prévenant, les malades et les invalides sont transportés en voitures. Les nazis sont-ils devenus plus humains?
Le temps est orageux en ce 2 juillet 1944 et à coups de crosses les S.S. casqués, mitraillette au poing, grenades à la ceinture et dans les hottes, sous les ordres des bourreaux de la Gestapo de Paris, activent l’embarquement des 2521 déportés dans des wagons transformés bientôt en cabanons pour quelques-uns, en cercueils pour d’autres. Ce sont des détenus extradés de toutes les prisons de France, ouvriers et paysans en grand nombre, de commerçants et des intellectuels, des personnages connus, tels le député Michaut, le colonel J.M. Mercier, le préfet Ernst, le sous-préfet Sirvent, les R.P. de la Perraudière et Alexia, les docteurs Fully, Helluy, Hickel, Leccia, Mazel, Segelle et tant d’autres.
Ils ignorent le but de leur voyage qui est Dachau, tristement célèbre. Sur ordre du Sicherheitsdienst, ils sont cent ou cent-vingt par voiture, parfois plus et la Marseillaise éclate de toutes les poitrines. Deux adversaires lyonnais, Edouard Aubert, militant syndicaliste, et Georges Villiers président du C.N.P.F. et maire de Lyon se retrouvent face à face. Les 36 détenus de Blois et d’Eysses sont du convoi qui démarre à 9 heures 45 et le soleil qui a succédé maintenant à la bruine, darde tous ses rayons sur les wagons plombés, bardés de fers, surchauffes. Les malheureux ruissellent de sueur et meurent de soif lorsqu’ils arrivent à Soissons à 34 km du départ. Le train roule, les hommes deviennent fous et s’entretuent à deux jeunes amis : Blattes et Person s’étranglent mutuellement jusqu’à ce que mort s’ensuive et retombent sur les corps de leurs camarades déjà raidis5050 50 Le Bataillon d’Eysses. J.-G. Modin. Amicale d’Eysses. Paris..

André et Beaudiffier, 18 ans, comme tant d’autres s’affaissent épuisés. D’autres encore hurlent jusqu’au dernier souffle qu’ils ne veulent pas mourir. Dans le même temps, il arrive que les S.S. mitraillent les voitures du convoi pour faire taire les cris ou sur tout être humain qui s’en approche. Les morts s’amoncellent sur les agonisants dans une atmosphère de putréfaction. Le capitaine Mouy, de Compiègne, est au nombre des victimes.
Les chiffres sont éloquents : à Reims, on compte 110 morts, à Hevigny 50 de plus, à Novéant 450 nouveaux. À cette station, la Gestapo ayant fait charger les cadavres dans quatre wagons, était relevée par la Landespolizei et les officiers passaient la consigne au kommandant Dietrich de la Schutzpolizei. Cette consigne sera respectée. À Sarrebourg, on dénombre 50 fusillés ; au Terminus, à Dachau après trois jours de voyage, le 5 juillet à 13 heures 22, le Total des martyrs s’élevait à 984 morts. Quinze cent trente-sept survivants qui ont échappé par miracle à cette véritable hécatombe, se retrouvent au camp mais un grand nombre d’entre eux va sombrer dans la démence.
Après la libération des camps, quatre cents rescapés seulement de ce train de la mort reviendront de cette hallucinante tragédie et parmi ces derniers, notre ami, le Compiégnois Marcel Guérin. À Compiègne, officiers et soldats reçurent des ordres formels du Sicherheitsdienst de ne pas évoquer ce génocide auprès des Français. Plus tard, en 1950, devant le tribunal de Metz, le kommandant Friedrich Dietrich allèguera pour sa défense : «Nous avions l’ordre de plomber les portes des wagons de transport».
Ultimes convois de la déportation
En dépit des ordres de liquidation du camp, les arrivées de détenus se succèdent, les départs également. Des convois partent, le 8, le 15, le 18 et le 28 juillet 1944 où le nombre des déportés est très important. Le 11 août un convoi emporte 1650 hommes vers Buchenwald.
Le 13 août, on dénombre encore 1772 détenus au camp. Par suite d’un accord conclu entre le major Huhm pour les autorités allemandes et le consul général de Suède à Paris, Raoul Nordling, une convention mettait fin à l’envoi de nouveaux contingents pour la déportation et à la libération des prisonniers civils, mais les Allemands violent une fois de plus leur engagement et s’empressent de former un nouveau convoi à Vieux-Moulin en forêt de Compiègne. Le 14 août, les maquisards du réseau Résistance, Fleury et Robert, de Pierrefonds, mettant à profit les renseignements recueillis par Mme Louis, mettaient le feu aux wagons.

Lors du bombardement du 9 août, l’aviation alliée ayant détruit le pont sur la ligne du chemin de fer qui va à Soissons, pont emprunté par la plupart des trains de déportés, les nazis reformèrent un convoi à l’orée de la forêt, non loin du carrefour Bellicart près de la Route Tournante du Grand Parc, à 1300 mètres de la rive gauche de l’Oise.
Le 15 août 1944, les S.S. du camp de Royallieu, furieux, activant à coups de crosses l’embarquement dans des camions de 1251 internes dont 200 arrivent de Romainville et, par les hurlements, ils excitent leurs chiens sur tous les retardataires qui sont mordus cruellement. C’est un hallali général. Le chargement terminé, une longue colonne d’une trentaine de camions traverse la ville au milieu d’une population terrorisée et gagne le carrefour Bellicart. L’émotion est vive parmi les Compiégnois. Au Centre de Rapatriement des Prisonniers, le sous-officier Philippe, chargé de la sonorisation, poussant le volume de l’amplificateur au maximum, fait retentir le Chant du Départ dont les strophes sont entendues à plus de trois kilomètres à la ronde. Les Allemands enferment Philippe pendant 48 heures au Camp de Royallieu.

Les déportés sont entassés sous les coups dans des wagons à bestiaux, cependant une quinzaine d’entre eux bénéficient de matelas et de wagons particuliers avec la complicité des S.S. Ceux-là sont les hommes de confiance, des kapos, des agents doubles recrutés parmi les gangsters, les souteneurs, les voyous plus barbares que leurs maîtres; ce sont les privilégiés.
Bien que l’embarquement soit terminé, le train demeure en stationnement du 15 août, 15 heures, au 16 août à cinq heures, gardé seulement par un détachement de 25 S.S. bien armés. On peut se demander qu’elle en fût la raison, il est probable que les S.S., sachant que de nombreux résistants du secteur faisaient partie du convoi, prévoyaient un coup de main de la part de leurs camarades et qu’en conséquence, ils avaient prémédité un guet-apens qui aurait dégénéré en une véritable tuerie.
Cependant les déportés espéraient une délivrance, convaincus qu’ils étaient que leur traversée de Compiègne n’était pas passée inaperçue. Dans ce convoi se trouvaient entre autres le commandant F.N. du Secteur, le capitaine Norbert Hilger, devenu le n° 48097, Brézillon le père et le fils, Max, Mercier, Philippon et le docteur Roos de Noyon, Poulain le maire de Crisolles, douze agents de police de Compiègne avec Defoor, l’adjudant Hocquart, Laffite et les deux jeunes frères Salgues ainsi que Robert, de Vaumoise.
En cours de route, deux wagons qui contenaient les bagages des déportés furent incendiés, les S.S. en rendirent responsables les terroristes. mais selon toute vraisemblance, ils en étaient les auteurs. À Reims, les Allemands volaient les repas confectionnés par la Croix-Rouge pour les déportés.
Malgré les ordres des S.S. cinq déportés déclouèrent de leur wagon une planche et réussirent à s’enfuir. En représailles, cinq infortunés pris au hasard furent fusillés au petit jour dans un trou de bombe le long de la voie ferrée. C’était le dernier convoi important de la déportation. Il partait pour Buchenwald.
Le lendemain 17 août, après une courte halte, cent femmes partaient pour Ravensbrück dans les quatre autobus qui les avaient transportées de Paris à Compiègne.
Le 20, une vingtaine de détenus parvenaient à s’évader et le 25 août, les gardiens demeurés au camp libéraient 25 internes dont les cas étaient jugés sans gravité et parmi ces derniers Mgr Théas, évêque de Montauban, coupable d’avoir pris la défense des juifs. Le lendemain 26, les Allemands qui brûlaient des papiers depuis plusieurs jours emportaient de nombreux documents et partaient avec les derniers détenus pour tenter de regagner leur pays. L’itinéraire prévu passait par Saint-Quentin, Liège et Aix-la-Chapelle, mais mettant à profit l’avance des alliés qui progressaient vers le Nord, les cheminots de la S.N.C.F. dirigèrent le convoi dans leurs lignes à Péronne où les Allemands se retrouvèrent au milieu des troupes anglo-américaines. Les rescapés de cette ruse, dont Caille marié à une jeune fille de la ville, Mlle Pinson, revinrent à Compiègne mais au camp de Royallieu qu’ils connaissaient bien, où les Allemands d’abord conduits à Lille vinrent les rejoindre le mois suivant.
Une des dernières victimes des nazis fut la femme d’un déporté qui, pré- venue clandestinement du départ de son mari, attendait devant la gare le passage du troupeau. Apercevant le malheureux dans les rangs, la pauvre femme, en pleurs, s’élança vers lui. Les mitraillettes crépitèrent à bout portant, et les criminels traînèrent le corps resté anonyme dans la gare.
La carrière tragique du Camp de Royallieu était enfin terminée. Elle avait duré 1162 Jours, du 21 juin 1941 au 26 août 1944, dernière étape en France d’un calvaire qui devait être plus dur encore.
Le premier départ qui comprenait 1112 déportés avait eu lieu le 27 mars 1942. à la fin de cette même année on comptait 8000 déportés. Fin 1943, on en comptait 23000; au dernier convoi le total était de 49860 déportés, chiffre officiel communiqué par les sous-officiers Prüssmann et Volkmann à M. Michel. délégué de la Croix-Rouge helvétique.
En décembre 1947, puis en 1949 et en 1951, l’adjudant Prüssmann, cité comme témoin, remit une liste des criminels de guerre du camp de Royallieu au Tribunal de Karlsruhe, lequel n’a jamais donné suite à l’affaira. En 1955. l’ancien sous-officier, souffrant de l’estomac, mourait après une intervention chirurgicale.
Il n’est pas inutile d’établir de la manière suivante le nombre des internés ayant séjoumé au camp :
| Déportés vers l’Allemagne | 49 860 |
| Fusillés, massacrés et disaprus | 2300 |
| Malades | 300 |
| Victimes des bombardements | 75 |
| Transférés vers autres prisons ou Organisation Todt | 600 |
| Évadés | 120 |
| Libérés pour causes diverses et dans le train de Péronne | 430 |
| Hospitalisés à la liquidation du camp | 100 |
| Total | 53 785 |
À la libération, le chiffre exact de 53787 détenus immatriculés me fut confirmé par l’entrepreneur Bourdon et mon ami le journaliste regretté Jean Mermet, qui l’avaient eux-mêmes relevé dans les registres du Camp.
| 1942 | |
| 20 mars | 178 détenus juifs partent pour Drancy. |
| 27 mars | Premier convoi de la Déportation: 1112 juifs dénombrés à Auschwitz. |
| 5 juin | Un millier d’hommes environ partent pour Auschwitz. |
| 6 juillet | 1034 hommes dénombrés à Auschwitz. |
| 23 septembre | Un groupe de déportés part pour Brunswick. |
| 1943 | |
| 13 janvier | Des centaines d’hommes partent pour Buchenwald. |
| 23 janvier | Un convoi d’un millier d’hommes environ embarque le soir à destination |
| d’Oranienbourg. Le train ne part que le lendemain 24 janvier après l’embarquement | |
| de 230 femmes qui seront déportées à Birkenau-Auschwitz II. | |
| En février | Des groupes partent pour Buchenwald. |
| Vers le 15 mars | 300 Africains raflés à Marseille, partent pour l’organisation Todt. |
| 22 mars, 6, 9 avril | Des groupes partent pour Buchenwald. |
| 16 avril | 1200 hommes environ partent pour Mauthausen. |
| 20 avril | 1 500 autres les rejoignent. |
| 28 avril | Un petit convoi d’hommes part au petit jour suivi de 213 femmes qui |
| partent pour Ravensbruck. | |
| 8 mai | Départ d’un autre groupe pour Flossenbourg. |
| 25 juin | 962 hommes dénombrés à Buchenwald. |
| 18 juillet | Départ d’un autre convoi. |
| 7 et 12 août | Des groupes partent pour Buchenwald. |
| 2 septembre | 898 hommes dénombrés à Buchenwald. |
| 3 septembre | 293 hommes dénombrés à Flossenbourg. |
| 11 septembre | 1200 détenus partent pour l’Allemagne. |
| 17 septembre | 1100 hommes partent pour Buchenwald. |
| 23 septembre | Départ d’un groupe. |
| 20 octobre | Un convoi part pour Buchenwald. |
| 29 octobre | Quatre convois se rejoignent à la gare dans la matinée. 911 déportés |
| seront dénombrés à Buchenwald. | |
| 21 novembre | Départ d’un groupe important. |
| 23 novembre | 30 Anglaises ou Américaines partent pour Vittel où elles sont transférées. |
| 9 décembre | Départ d’un groupe de déportés. |
| 15 décembre | 921 déportés dénombrés à Buchenwald. |
| 1944 | |
| 17 janvier | 1928 déportés dénombrés à Buchenwald. |
| 22 janvier | 1803 autres dénombrés dans le même camp. |
| 24 janvier | 121 femmes partent pour Ravensbruck. |
| 27 janvier | 1580 hommes partent pour Buchenwald. |
| 31 janvier | 958 femmes partent pour Ravensbruck. Le camp a été liquidé, il n’y a plus de détenus au 122. |
| 17 et 22 février | Départs de plusieurs petits groupes qui se succèderont jusqu’en mai, |
| la plupart à destination de Neuengamme. | |
| 2-15 mars | Des détachements de 50 déportés partent pour Sarrebrück puis Mauthausen. |
| 22 mars | 1500 hommes environ partent pour Mauthausen. |
| 27 mars | 90 détenus traversent la ville par petits groupes et partent pour une destination inconnue. |
| 5 avril | 1 500 hommes environ partent pour Mauthausen. |
| 17 avril | Un convoi de femmes part pour Ravensbrück. |
| 27 avril | 2254 déportés dénombrés à Auschwitz et qui repartent le 12 mai pour Buchenwald |
| où ils n’arrivent que 1680 hommes seulement. | |
| 12 mai | 2055 déportés dénombrés à Buchenwald. |
| 21 mai | Un groupe part, vraisemblablement pour Flossenbourg. |
| 27 mai | 1500 déportés partent pour Mauthausen. |
| 6 juin | 1200 autres partent pour Neuengamme. |
| 18 juin | 2140 déportés dénombrés à Dachau. |
| 2 juillet | 2521 hommes embarquent dans le Train de la Mort à destination de Dachau. |
| 984 déportés meurent asphyxiés ou tués au cours du trajet. Le soir, à l’appel, | |
| il n’y a plus que 300 détenus au camp de Royallieu. | |
| 8 juillet | Un groupe de femmes part pour Ravensbrück. |
| 15 juillet | 1000 hommes environ partent pour Neuengamme. |
| 18 juillet | Un nouveau groupe de femmes part pour Ravensbrück. |
| 28 juillet | 1000 hommes environ partent pour Neuengamme .Le train passe par Rethel et Charleville. |
| 11 août | 1650 détenus partent pour Buchenwald. On dénombre 1772 internés demeurés au 122. |
| 16 août | 1251 déportés embarquent en forêt de Compiègne, près du Carrefour Bellicart, |
| et partent par le dernier train de la Déportation pour Buchenwald. | |
| 17 août | 100 femmes qui arrivent de Paris dans quatre autobus repartent du camp pour |
| Ravensbrück dans les mêmes voitures. | |
| 26 août | 300 hommes partent pour l’Allemagne, mais le convoi est libéré à Péronne. |
| Les cheminots de la S.N.C.F. avaient conduit le train dans les lignes alliées. |
Certains internés, dont des Anglais et des Américains, ont été transférés vers d’autres lieux de détention de France et des Russes ont été déportés dans les iles Anglo-normandes à des dates diverses.
Au départ de Compiègne, les autorités du camp de Royallieu ignoraient les destinations des convois qui étaient souvent scindés en plusieurs tronçons en Allemagne, selon les disponibilités des Camps de Concentration.
Quant aux chiffres mentionnés à l’arrivée, ce sont ceux portés par les S.S. dans les registres des camps, non compris les morts et les évadés, l’importance et les dates de départ des convois n’ayant pu être vérifiées dans les archives de la S.N.C.F., celles-ci étant brûlées tous les cinq ans.
Libération
Mouvement Ouvrier international
Revenu à la vie privée après un séjour dans les prisons de Compiègne et de Saint-Quentin, je repris mon activité au sein du M.O.I., le mouvement ouvrier international, ou main-d’œuvre immigrée, fondé par Manouchian et rattache aux F.T.P., dans lequel j’avais été muté en raison de ma connaissance des langues étrangères.
Cette activité consistait à entrer en relation avec les étrangers, connaitre leur opinion et si possible les recruter et combattre la propagande ennemie. Il fallait aussi récupérer les nombreux prisonniers soviétiques évacués lors des bombardements massifs aériens sur Saint-Leger, sur Creil et les installations des bases de lancement de V1 et de V2 de Saint-Leu-d’Ésserent, d’où s’envolaient les monstrueuses fusées téléguidées qui fonçaient en hurlant comme des loups vers l’Angleterre.
À Senlis, le regretté André Folliot, qui fut inspecteur de la Jeunesse et des Sports à Compiègne et qui avait longtemps vécu en Russie où il était né, était chargé de la même mission et en raison de son activité dans la résistance ses amis le chargèrent des fonctions de maire à la libération de la ville.
Belges, espagnols, italiens, polonais, à l’exception de quelques ignobles délateurs, étaient favorables aux Alliés. Il en était de même parmi les Russes émigrés : l’ancien ambassadeur du tzar à Bruxelles, le comte Rehbinder, m’assura être derrière Staline comme tous les Russes et souhaiter la victoire de la Russie soviétique qu’il ne voulait pas voir démembrée conformément au «Drang nach Osten». Un artiste peintre, Stalitski, auteur des magnifiques fresques qui ornent l’église russe de la rue Daru la Paris, brûlait du désir d’aller combattre dans son pays qu’il avait quitté en 1913.
Au C.R.T.P.G., en juin 1944, l’infortuné commandant de Préval, qui devait mourir si tragiquement deux mois plus tard, mis au courant de nos activités par un sous-officier de mes amis d’origine russo-polonaise, Redziock, vint me voir pour obtenir de plus amples informations et se montra satisfait d’apprendre que je faisais rejoindre le maquis aux Russes, par l’intermédiaire des agents de liaison.
Nombreux étaient les prisonniers évadés recueillis dans les fermes, les usines, les maquis et chez des particuliers. Nikolaï Kharitonov, de Pouchkine près de Léningrad, fut contacté par ma femme à Francières. Avec verve il me raconta comment il avait pris la mitraillette et le pistolet qu’il détenait, pour combattre dans le maquis, combat qui a sérieusement altéré sa santé. Hébergé et recueilli par mes excellents cousins Paul et Marie Dervillé, il repartit vers son pays à la libération. Par la suite il m’écrivit sa foi pour une Paix durable dans le monde.
Il y avait des cosaques comme ce grand diable de Sergueï Beleoukomou, originaire du Don et de nombreux Arméniens disséminés dans la région. Je vis un jour près de chez moi, au 85 de la rue de Paris, un groupe d’une soixantaine de gaillards de type asiatique portant une tenue bleuâtre et coiffés d’un bonnet gris et, les prenant pour des prisonniers, je m’empressai de les aborder. Aucun ne parlait le russe, ni l’allemand et le soldat nazi qui les accompagnait m’apprit que c’étaient des membres de l’armée de Vlassov, ce général russe passé à l’ennemi. Je n’insistai pas.
En octobre 1942, huit prisonniers de guerre soviétiques évadés d’un camp de Douai se réfugiaient chez des mineurs dans le coron de Salenoble. Ils avaient à leur tête un Arménien, le lieutenant Alexandre Stamboulian pseudo Stambo, et le sergent Anatoli Stépanov, aujourd’hui professeur à Moscou. Des partisans les conduisirent à Reims. Stambo et Stépanov étaient hébergés chez un habitant d’origine biélorusse lorsque des policiers français firent irruption. Au lieu de les arrêter, ils leurs donnèrent à chacun cent francs et leur dirent : «Pas un mot, vous ne nous avez pas vus !». Après avoir fait évader de nombreux civils et prisonniers soviétiques, Stamboulian et Stepanov furent affectés au détachement Liberté du M.O.I. commandé par le pseudo Michel avec lequel ils participèrent à d’audacieuses actions dans la forêt de Nouvion. Chargés de mission dans la région de Lens en juillet 1944, les deux Soviétiques furent arrêtés par des gendarmes allemands qui les conduisirent à la prison de Saint-Quentin avant de les transférer immédiatement au camp de Royallieu.
Leurs frères d’armes apprirent un jour que Stambo avait été fusillé à Compiègne et, en 1945, ils publièrent son portrait sur une carte postale émise en souvenir des combattants morts pour la France. Mais les deux soviétiques n’étaient pas morts, ils étaient déportés à Neuengamme5151 51 Dans son block, Stambo, devenu le numéro 102206, avait comme voisin un curé français que, dans le dessein de le ridiculiser, les S.S. avaient coiffé d’un casque soviétique orné de l’étoile rouge. Les S.S. partis, le lieutenant Stambo lui offrit son béret en échange de sa coiffure, mais le prêtre, très digne, protesta: « Jeune homme, ce couvre-chef ne me gêne pas, ils viennent libérer l’Europe». Stambo le fusillé de Compiègne, par Oleg Dohrovoiskl. Revue France-U.R.S.S. n° 169. Janvier 1960.
et, évadés, repris, évadés de nouveau, ils furent recueillis par les troupes britanniques à Brême. Regagnant la France, ils retrouvèrent quelques-uns de leurs camarades du maquis, stupéfaits de voir un «ressuscité». À Moscou où il est inspecteur des finances, Stamboulian, le fusillé de Compiègne, comme on le nomme là-bas, se porte bien.
Près de Creil, un Russe tendit un jour un fil de fer en travers de la route et qu’un motocycliste allemand vint heurter. Le Russe se précipita sur l’homme coincé sous sa machine, le tua avec l’arme qu’il lui avait prise et l’enfouit avec la moto. Des habitants auxquels il confia le drame découvriront effectivement et l’Allemand et la moto, plus tard, à l’endroit indiqué.
Quatre Soviétiques, Vassili Mechkov, Anatoli Ababkov, Mikhaïl Mikhelson et Fedor Nevedomski s’évadèrent d’un camp de prisonniers dans la nuit du 27 au 28 mai 1944 et. selon le plan prévu, se rendirent chez Serge Lubanoff qui habitait à Mouy. Ce dernier les conduisit au responsable F.T.P. Legrand dit Édouard qui les incorpora dans son groupe comprenant outre des Français, des Espagnols, des Estoniens, des Polonais, des Russes et même des Allemands.
Plusieurs détachements furent formés dont l’un, Jaguar, fut placé sous les ordres du commandant Mechkov assisté du capitaine Sorokine et du sous-lieutenant Ababkov. Un soir, après cinq heures de marche, les 42 hommes de ce détachement armes de mitraillettes, de grenades, de couteaux et de plastic sabotèrent les communications avec l’extérieur d’une station de téléguidage de VI et de Vil installée près de Clermont. Supprimant les sentinelles, puis le corps de garde qui occupait les blockaus, les Soviétiques partant à l’assaut franchirent un énorme remblai, pénétrèrent à l’intérieur de l’immeuble mais se heurtèrent aux chiens qui donnèrent l’alarme et les mordirent cruellement. Les Allemands surpris dans leur sommeil, cherchèrent le salut en sautant par les fenêtres et tombèrent parmi les assaillants. Au cours d’un sanglant corps à corps, la plupart des Allemands furent tués par balle ou à l’arme blanche, le couteau et le rasoir, et la station complètement anéantie. Au mois d’août. trois jours avant l’arrivée des troupes alliées, le même groupe libérait Mouy et le camp d’où les quatre Soviétiques s’étaient évadés5252 52 Les Nouvelles de Moscou. Août 1964. Un Compiégnois. M. Achille Verlay, qui effectuait un voyage d’études et de tourisme en U.R.S.S., lut ce récit qu’il fit publier dans la presse locale. Anatoil Ababirov, qui habite à Narva, en Estonie, désirait retrouver ses camarades français et put ainsi reprendre contact avec Serge Lubanoff de Bury..
La conduite des Soviétiques récupérés fut admirable et leurs pertes furent lourdes au cours des combats de la libération. Le 31 août 1944, le lieutenant Alexis Derevenski, âgé de 28 ans. affecte à un groupe de F.T.P., tomba à Saint-Sauveur. Deux Arméniens découverts sans armes chez des habitants. furent pourtant horriblement martyrisés et fusillés par les Allemands à Bienville et à Clairoix.
Du château de Marquéglise dont le propriétaire était Arménien, un détachement de prisonniers évadés soviétiques également Arméniens, dont Alexandre Pachinian, harcelèrent l’ennemi et livrèrent de furieux combats au cours desquels les pertes furent sensibles de part et d’autre. Huit de ces héros Soviétiques anonymes, dont les corps ont été recouverts de chaux par leurs adversaires, sont ainsi tombés loin de leur patrie et reposent aujourd’hui en un lieu, dont la plus grande beauté est l’oubli.
Répression et guérillas intensifiées
Le débarquement ayant réussi, qui était la hantise des occupants, ceux-ci s’affolent et c’est durant leurs derniers mois de séjour en France qu’ils commettent le plus d’horreurs.
Partie de Compiègne le 14 mai 1940 dans la fièvre de l’évacuation, une famille disparait tragiquement. Le 10 juin. Mme Augustine Legros, veuve depuis 1935, meurt à Château-du-Loir dans la Sarthe. Apprenant que les officiers nazis occupent leur villa de la rue de Gramont, la fis Robert s’installe avec sa sœur Germaine dans un hôtel de Limoges non loin d’Oradour-sur-Glane. charmante bourgade de la Haute-Vienne, où ils comptent des amis. Le samedi 10 juin 1944, les deux Compiégnois vont les voir car les premières communions doivent avoir lieu le lendemain. À 13 heures 30, les SS., de la division Das Reich que commande le général Lammerding, font irruption dans la localité après avoir croisé sur la route Robert Legros qui, grâce à sa connaissance de la langue allemande, échappe à la tuerie qui va suivre. Sa sœur Germaine réussit à s’enfuir avec l’aine des enfants de leurs amis tandis que les S.S. refoulent le plus jeune dans l’église sur le portail de laquelle un Sonderfûhrer à cloué, d’un coup de baïonnette, un bambin de deux ans5353 53 Paris brûle-t-il? page 109. Dominique Lapierre et Larry Collins. Robert Laffont, éditeur.. Les bourreaux déchaînés fusillent les hommes et livrent aux flammes 210 femmes et 230 enfants enfermés dans l’église qu’ils ont incendiée dans le même temps que les habitations de la localité. On dénombrera plus de 700 innocentes victimes. Les deux Compiégnois s’enfuient vers Tulle où les corps de 99 réfractaires pendus par les S.S. hitlériens sont figés aux balcons. Plus loin, des enfants sont pendus par la gorge à des crocs de boucher. Le choc est trop rude et lorsque le frère et la sœur trouvent à Compiègne leur villa dévastée, ils perdent la raison et entrent à l’hôpital. Robert meurt le 17 septembre 1949 âgé de 54 ans et Germaine, ruinée par les soins, disparaît à son tour le 7 novembre 1964 dans le plus grand dénuement. Au cimetière du Nord, sur le caveau de famille, une plaque de marbre blanc rappelait la mémoire du petit martyr5454 54 Récit de Mme Debeaupuis, amie de la famille.. Des mains sacrilèges ont fait disparaître ce souvenir accablant pour les bourreaux.
À Agnetz, au cours de la nuit du 16 au 17 juin 1944, les Allemands cernent le hameau de Boulincourt. Dès cinq heures ils rassemblent les vingt hommes sur la place et les accusent d’avoir créé un dépôt d’armes dans la forêt voisine. À 10 heures, un camion les conduit au camp de Royallieu, le plus jeune à 16 ans, le plus âgé 60 ans. Déportés au camp de Neuengamme, trois d’entre eux seulement reviendront.
Le 25 juillet 1914, la population de Compiègne apprend la mort du propriétaire d’un établissement de bains, Jean Choron, victime des nazis, décédé après six mois de souffrances. Le 31 décembre 1943, une trentaine de soldats allemands avaient fait irruption dans son établissement du cours Guynemer et, dans le couloir bordé de cabines, exigés d’être servis sur le champ. Poliment Choron les prie d’attendre quelques instants ou de revenir plus tard, puisque d’ordre de la Kommandantur c’est l’heure réservée à la clientèle française et de plus les baignoires sont occupées par des femmes et des jeunes filles.
Raison de plus pour les Allemands rendus furieux par le refus de Choron d’ouvrir les portes, de les forcer, de les défoncer et d’en faire sortir les clientes surprises au bain. Choron courageusement s’y oppose, barrant la route aux brutes qui se ruent sur lui, le labourent de coups de crosses devant sa femme, elle aussi frappée, ses quatre enfants et les clientes terrifiées qui n’ont pu encore se rhabiller.
La tête enflée et ensanglantée, Choron est jeté en prison et reste quinze jours durant sans soins, interrogé quotidiennement à la Kommandantur, il est enfin relâché, mais il lui est interdit de paraitre dans son établissement. Epuisé, le brave homme qui n’a plus la force de se tenir debout n’a plus que six mois à vivre dans d’atroces souffrances. Il était âgé de 32 ans. Vingt ans après, l’infortuné Jean Choron n’était pas encore reconnu comme une victime des nazis.
Dans les bois de Parisifontaine à Berthecourt, le 9 août, les S.S. et la Gestapo fusillent cinq soldats parachutistes anglais, faits prisonniers, auxquels ils ont fait endosser des habits civils à la place de leurs uniformes, pour mieux cacher leurs crimes.
Le 27 août, à la suite de l’évasion d’un soldat S.S. fait prisonnier par les Résistants, les Allemands massacrent 17 hommes sur la place d’Andeville. A Châteaurouge, 21 habitants, âgés de 17 à 60 ans sont fusillés.
À la Ferme des Khroumirs, les nazis brûlent la ferme ainsi que son propriétaire sous les yeux de la femme et des enfants terrifiés.
Le 31 août, les Allemands s’emparent de René Eveloy, 24 ans, de Saint-Sauveur, qui sort de la maison de ses beaux-parents à Béthisy et le fusillent sans motif.
Mais les crimes de l’occupant ont révolté la population qui réagit isolément. En juillet 1944, Roland Delahaye et son ami Pélisson scient sept poteaux téléphoniques et deux arbres qui obstruent la circulation sur la route de Pierrefonds où Delahaye surpris par une patrouille lui envoie une rafale de son revolver 6/35. Dans la nuit du 28 juillet, il dérobe des grenades au mess des officiers et qu’il distribue aux amis. Dans le Parc du Château National, Delahaye, toujours audacieux, en tranchant les courroies, s’empare d’une mitraillette suspendue au cou d’un ennemi endormi sur la pelouse et s’enfuit en courant. Le buraliste Jouanique5555 55 Qui sera tué le 11 août au cours du dynamitage des munitions allemandes stockées près de la gare. et sa femme, qui se trouvaient là par hasard, sont stupéfaits. À la Libération. Delahaye partira avec la 2 DB.5656 56 Division blindée. qui le conduira à Berchtersgaden, au repaire d’Hitler.
Dans le même temps, l’aviation alliée mitraille et bombarde continuellement les dépôts de la S.N.C.F., détruit le matériel roulant, paralyse le trafic ferroviaire et routier.
Les sabotages des F.F.I. se multiplient sous l’impulsion du commandant Bouquerel et de ses adjoints: Astoux, récemment directeur-adioint de L’O.R.T.F., Barriquand.,Forest, Martin de l’O.C.M. qui opèrent avec succès à l’usine Englebert notamment. Les groupes de Résistance du capitaine Lefèvre, de Louis et de tous les réseaux se retrouvent parfois dans des opérations communes.
Autour de Compiègne des combats sévères se déroulent, au cours desquels nous déplorons la perte de nombreux camarades. Le 11 juin, le Compiégnois Cottin tombe à Soissons la tête criblée de balles par une rafale de mitraillette. Il était le frère d’Henri tombé à Huelva en Espagne aux côtés des républicains lors de la guerre civile et qui était aussi l’auteur de l’attentat contre Clémenceau en 1919. Le lieutenant Leger est tué le 11 juin à Attichy au cours d’une action.
À Crisolles, le 23 juin, un détachement de Feldgendarmen et de la Gestapo attaque au Bois des Usages le maquis Résistance du capitaine Fourrier qui, inférieur en nombre, subit de lourdes pertes. À l’issue d’un dur combat les maquisards réussissent à décrocher et emmènent leurs blessés ainsi qu’une partie de l’armement.
Le 27 juin, des membres du SRA., Service de Renseignements de l’Armée, et qui travaillent au C.R.T.P.G., font dérailler le train dit Robert près du Buissonnet. On compte 47 morts et 60 blessés, Allemands et collaborateurs pour la plupart, et les dégâts sont considérables.
Le même jour, les F.T.P. assaillent un camion allemand près de Goumay-sur-Aronde, tuant deux soldats, en blessant un troisième, font dérailler un train à Rémy. Le 4 juillet, nouveau déraillement à Rémy et le 6 celui du convoi de tanks de la Division Adolf Hitler qui se rendait en hâte à Caen, pour arrêter la progression des troupes alliées.
Dans la nuit du 15 au 16 juillet, des commandos composés de 40 et de 200 hommes opèrent une rafle monstrueuse de Compiègne à Noyon. De nombreux résistants sont arrêtés, incarcérés à la Maison d’Arrêt de Compiègne et transférés le lendemain au camp de Royallieu. L’arrestation de Hilger désorganise quelque peu le F.N. dont il était le commandant pour le secteur. Herman et sa femme, à Thourotte, prennent la relève par intérim en attendant que le cheminot Leclercq accepte d’en prendre les responsabilités.
Un officier canadien parachuté au Moulin Fondu à Annel est en liaison constante par radio avec l’armée alliée. La transmission des renseignements réciproques avec l’État-major des F.F.I. est assurée par l’agent de liaison Carbonnier de l’O.C.M.
Sur la route nationale n17 les F.T.P. interceptent une voiture allemande faisant un tué et deux blessés; le 11 juillet, sabotage des lignes de haute tension à Verberie; le 1er août, sur la nationale 35, trois Allemands sont tués et un autre est blessé au cours de l’attaque de deux motos et d’une auto qui précèdent un convoi militaire. Le 18, dans le secteur d’Élincourt les F.T.P. tuent cinq Allemands et s’emparent de leurs armes. Le 23, ils détruisent le stock de gazogène de LaCroix-Saint-Ouen et le 24, font un prisonnier. Le 26, quatre ennemis sont tués à Monchy et le 27 les F.T.P. font dérailler un train d’artillerie à Estrées-Saint-Denis. Entre le 21 et le 26, ils ont fait 40 prisonniers et tué deux autres soldats. Le 31 août, ils font dix nouveaux prisonniers dans le secteur de Chevincourt-Vignemont et onze autres le 1er septembre à Rémy, où ils tuent un Allemand.
Des résistants sont encore tombés au cours des derniers combats : à Saint-Sauveur, le 29 août Calabre, et le 31, Dumont et Neudorf, à Verberie le même jour, Dameron et Marval; un instituteur, le lieutenant Poussot, au nord de Compiègne et Trannoy, à Monchy-Humières; le 1er septembre Louis Boilet à Remy; le 2 septembre, Dehier et Delaval à Lonqueil-Annel et Lepère à Plessier-de-Roye et le 3 septembre, Hauet, à Mareuil-la-Motte.
Veillée d’armes
Compiègne attend ses libérateurs et l’on n’entend plus les soldats de la Wehrmacht chanter à quatre voix les orgueilleux chants du III Reich, ponctués par les bruits de bottes sur les vieux pavés de la ville.
Un parachutage a été largué à la Faisanderie, mais dans l’obscurité les participants ne se reconnaissent plus et, pris de panique se croyant entourés d’ennemis s’enfuient, abandonnant un important stock d’armes et de munitions que les Allemands récupèrent le lendemain.
En l’église Saint-Jacques, le 25 juin 1944, le Conseil Municipal uni au clergé de la ville avait fait le vœu pour obtenir l’heureuse libération de Compiègne et éviter de nouveaux bombardements meurtriers, que les trois paroisses se rendraient le 15 août de chaque année en action de grâces au sanctuaire local de N.-D. de Bon-Secours.
Pourtant, l’agglomération compiégnoise est l’objet de bombardements faisant de nombreuses victimes qui viennent s’ajouter aux précédentes. Déjà le 11 juin le dépôt des machines et le 21, la cité des cheminots avaient été touchés.
Le 5 août les sirènes annoncent le début de l’alerte à 10 heures 30 et la fin à 11 heures 40, mais une demi-heure plus tard à 12 h 10, sans alerte cette fois, 24 bombardiers américains volant d’est en ouest en quatre vagues surgissent et déversent leur chargement sur le quartier de la gare dans un épouvantable fracas. On compte 87 points de chute. La ville est plongée dans un océan d’obscurité chargé de fumée épaisse, de terre et de cendres qui s’élève à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Des décombres d’une chocolaterie, on dégage les corps d’une grand-mère, Mme Féret, de son fils et de sa belle-fille et de deux petits enfants qu’elle serre dans ses bras; à la gare on compte six cheminots tués; dans les maisons voisines 37 tués et 101 blessés grièvement.
Le 8 août à 13 h 40, trois vagues de 6 bombardiers, soit 18 appareils, attaquent le terrain d’aviation ennemi, les dégâts sont purement militaires. Mais le 9 août pendant que 200 internés du camp de Royallieu réparent les voies ferrées détruites quatre jours auparavant, de six vagues 36 appareils en formation larguent à haute altitude une centaine de bombes de gros calibres sur le pont de la ligne de Soissons, les deux berges de l’Oise avoisinantes et le chantier des voies en réfection. Ce fut un terrible massacre, les internés, prévoyant le bombardement, s’apprêtaient à fuir, les nazis les mitraillèrent et en tuèrent une dizaine. Une vingtaine de citadins et une soixantaine de ces malheureux internés succombèrent sous le déluge5757 57 On sait que le gouvernement refusa d’assimiler aux «internés et massacrés», ces internes dont le décès n’a pas été causé par une action délibérée de l’ennemi.. Dans le voisinage rasé on recherchera des habitants qu’on ne retrouvera jamais5858 58 Des camarades de ma jeunesse sont douloureusement éprouvés: Tassin, ne retrouvera qu’un bras de sa femme et aucune trace de sa jeune fille. Legay ne découvrira jamais le corps de son beau-père dans les ruines de sa blanchisserie pulvérisée et Jean, un fils de Maurice Sudel, est tué.. Vingt-sept Allemands avaient été tués. Les blessés étaient nombreux, quatorze prisonniers soignés à l’hôpital seront réintégrés, une vingtaine de rescapés s’enfuirent et se réfugièrent chez l’habitant. Deux furent pourtant refoulés du C.R.T.P.G. par le colonel français auquel ils demandaient asile.
Le pont formé de trois travées en treillis mécanique était en partie détruit et la travée centrale projetée dans l’Oise.
Le 10 août à 18 h 05, quatre avions bombardèrent le dépôt des machines. Le 13 vers 10 heures, un avion isolé fit peu de dégâts. Le 26 août vers midi, deux ou trois escadrilles s’en prirent aux postes d’essence de la route de Choisy qui flambèrent aussitôt. Il y eut deux blessés. Enfin le 31, ce sont des convois qui circulaient dans Margny-lès-Compiègne qui furent mitraillés.
Chacun rivalise de zèle : des tessons de bouteilles, des clous-poussahs et de tous genres jonchent le sol et crèvent les pneus. Les flèches de direction sont inversées et les fuyards désorientés tourneront en rond dans la nature. Les Allemands s’affalent dans les fils de fer tendus en travers des routes et les employés de l’Usine élévatoire des Eaux de la Ville, qui utilisent ce système le long de l’Oise, s’amusent follement au spectacle des baigneurs en uniformes.
Les transports par voie ferrée sont paralysés par les avions de chasse qui s’attaquent aux locomotives dont les chaudières crevées laissent échapper un immense jet de vapeur tel un serpent monstrueux, dans un hurlement d’effroi et d’agonie.
À Clairoix, Mme Desjardins qui cachait des évadés et des aviateurs anglais est grièvement blessée et trépanée.
Le 26 août, dans les environs de Compiègne, le Feldmarschall Model inspectait ses troupes dont une unité motorisée, venant de Paris, qui avait participé à la bataille de Normandie, traverse la ville dans la nuit du 26 au 27 août et fait halte à Choisy-au-Bac. Elle est commandée par le capitaine Guderian, fils du général commandant l’État-major d’Hitler, depuis l’attentat du 20 juillet contre le Führer.
Les troupes qui occupaient Compiègne filent vers Soissons; le camp d’aviation est de nouveau bombardé le 27 août, des tonneaux d’essence de 100 litres explosent et brulent avec un hangar.
De plus en plus nerveux les Allemands raflent toutes les bicyclettes qu’ils rencontrent. Un mot d’ordre circule de bouche à oreilles : «Planquez vos vélos, ils vont vous les voler». Ce n’est pas une plaisanterie. Dans la fièvre et la peur, jour et nuit depuis une semaine, ils fuient. Dans leur précipitation ils démolissent un mur rue de la Madeleine, arrachent des lampadaires rue Saint-Lazare, la grille du monument de Guynemer et les bordures de trottoirs et pillent encore, par la force de l’habitude. Les gourgandines, les ’horizontales’ de la collaboration pleurent le départ de leurs amants: l’une d’elles, inconsolable de la fuite de son Karl, part pour Paris, laissant le soin du magasin à un mari complaisant.
La Kommandantur dans le but de réquisitionner les véhicules à moteur avait ordonné au service des Ponts-et-Chaussées de procéder jour après jour à leur recensement avec leurs caractéristiques exactes et à celui de leurs propriétaires, qui étaient tenus de posséder une autorisation de circulation. En ce mois d’août, la Kommandantur exige que ce service s’installe à l’étage supérieur de son local avec tous les documents relatifs à la circulation. Mais à l’insu de ses chefs de bureau, le jeune Pierre Lambert enferme le tout dans un placard que nui ne soupçonne, emporte la clé et prévient ses parents qu’il prend le maquis. Le directeur du service, affolé, adjure les parents de faire revenir leur fils lequel y consent, non sans peine, mais opposera la force d’inertie. Un matin, Pierre arrivé le premier à son bureau se trouvera seul dans un silence impressionnant. Les âtres des cheminées étaient encombrés de papiers brûlés. Personne. La Kommandantur de sinistre mémoire avait vécu.
Nombreux sont les habitants qui dans la crainte des bombardements gagnent chaque soir les souterrains, en particulier ceux du château pourvus de quatre issues et à l’intérieur desquels fonctionne un groupe électrogène qui dispense l’éclairage dans le vaste labyrinthe. Mais l’air y est bientôt irrespirable et surchauffe à un point tel que les malaises sont nombreux.
Le 28 août, des Compiégnois parmi lesquels Léon Terqueux, revenu après un «camouflage» de plus d’un an, récupèrent des fusils et des grenades au camp des Sablons et le lendemain font 22 prisonniers qu’ils remettent aux Américains a LaCroix-Saint-Ouen. Parmi les Allemands, deux avaient enterré leurs uniformes et s’étaient camouflés en civils, mais leur accoutrement disparate avait intrigué l’un des récupérateurs, Jean Pioche.
À LaCroix-Saint-Ouen, le 29 août, les Allemands s’emparent d’une ambulance de l’hôpital de Compiègne, dont ils évacuent le malade qu’ils laissent mourir sur le trottoir, et à Compiègne l’économe Navarre, utilisant la dernière ambulance pour emporter les instruments sanitaires et les médicaments entreposés par la Croix-Rouge au Palais, est arrêté par quatre nazis que la défaite et l’alcool ont surexcités et qui tentent de s’emparer du véhicule. L’économe s’y oppose fermement et tente de parlementer pendant que le chauffeur Colosio bloque le moteur et disparaît rapidement. Sous les yeux du personnel épouvanté, la soldatesque furieuse met en loue l’économe dont la vie est sauvée par l’arrivée de la Feldgendarmerie.
Le 30 août à 15 heures les Allemands font sauter des véhicules, des immeubles aux Sablons et près de la gare où se trouvent des munitions. Les explosions se succèdent de toutes parts, des habitants sont tues, d’autres gagnent les abris.
Encore des sabotages ennemis: à la poste, au barrage et à la gare. Les Allemands tirent la nuit sur les passants, mais l’un d’eux riposte et abat son agresseur. Ce n’est plus la belle armée allemande, ses soldats circulent sur des bicyclettes sans pneus, dans des carrioles attelées à des ânes ou à des bœufs que les chasseurs de la Royal Air Force mitraillent à loisir. Retranché à la Centrale électrique un soldat allemand vide ses munitions sur les civils qu’il aperçoit et se fait sauter la cervelle avec sa dernière balle. Le grand transformateur de la S.N.C.F. est endommagé au cours d’un raid aérien; il n’y a plus d’eau, ni d’électricité dans la ville.
Deux Compiégnois impulsifs accomplissent un exploit tardif et irréfléchi. L’un tue, le 31 août, les deux derniers fuyards qui sont à portée de sa cible. rue N.-D. de Bon Secours, et le 1er septembre, Compiègne vient d’être libéré. l’autre, un hôtelier, emprunte le fusil d’un Américain pour abattre un Allemand demeuré près du pont. Bien que choquante, c’est là, une réaction inévitable après quatre années d’occupation inhumaine.
Huit tanks lourds marqués de la croix noire, venant de la forêt, tentent de s’échapper par Choisy, mais devant l’impossibilité de franchir le pont de bois de 16 tonnes, ils font demi-tour et filent vers Soissons.
Le même jour, le 31, à 14 heures, un convoi est sévèrement mitraillé, près du pont et sur la route de Noyon, par une petite escadrille de chasseurs. Quelques-uns regrettent et critiquent que le sabotage de la route nationale n’ait pas été effectué par les F.F.I., ce qui aurait gêné considérablement l’ennemi.
Les rues sont désertes, le trafic est suspendu en ce jour du 31 août 1944.
Les munitions accumulées dans les hangars en béton de l’aérostation sautent vers 17 heures. De nombreuses vitres n’y résistent pas et les explosions se poursuivent à intervalles de une à deux minutes tard dans la nuit. On ne dort plus. On attend.
La tragédie de Rimberlieu
Le 26 août 1944 les groupes mobiles F.F.I. ont reçu leur ordre de mobilisation et d’entrée en action. Le 29 août le capitaine Martin de l’État-major F.F.I. était informé qu’un accrochage avait eu lieu la veille entre l’échelon du maquis de Rimberlieu et un détachement ennemi et que six hommes étaient portés manquants.
L’inquiétude est grande lorsque le lendemain 30 août au cours d’une fouille faite dans le local évacué par la Gestapo de Compiègne, on découvre le brouillon d’un rapport de l’action menée contre des ’terroristes’ par un détachement allemand. Six de ces terroristes ont été tués et leurs corps déposés dans deux fosses. Le détachement, fort de 21 membres du Mouvement résistance et O.C.M. s’était installé sur la terrasse des ruines du magnifique château de Rimberlieu détruit pendant la guerre de 1914-18 et situé au milieu des bois à peu de distance de la route qui mène de Villers-sur-Coudun à Élincourt. Il faisait chaud, très chaud même plus qu’un maquisard n’était vêtu que d’une culotte courte qui ne le préserva guère des ronces, dans sa fuite à travers bois.
Le secteur avait été calme au cours de la nuit du 27 au 28 août. Vers 6 heures, le lieutenant Leroy-Sainte-Marie5959 59 Il sera tué devant Dunkerque. faisait connaître au groupe la présence dans les bois d’une cinquantaine d’Allemands, dont deux officiers. guidés par un indicateur. Avant de passer à l’action, les hommes qui venaient de transporter des caisses de munitions non loin de la route prenaient un peu de repos dans les ruines du château. Un homme montait la garde.
Sans aucun doute, les Allemands furent prévenus par des cyclistes, des traîtres à jamais identifiés. Ils revinrent à Rimberlieu en ordre de combat et, opérant un vaste mouvement tournant, encerclèrent le château par la route et sous bois. Les Allemands interrogèrent le garde-chasse Villain , qui affirma que les maquisards ne se trouvaient pas dans la propriété. Une perquisition dans la maison avérait sa déclaration mais, en sortant les soldats ennemis virent l’homme de garde sur lequel ils se précipitèrent. Les maquisards en minorité, surpris, dans l’impossibilité de réagir, cherchèrent le salut dans un repli précipité parmi les ronces inextricables qui zébraient les fuyards. Cie fut un sauve-qui-peut général, chacun abandonnant armes et munitions aux mains de l’ennemi qui engagea une chasse à l’homme dont la mitraillade se répercute à l’entour. Tandis que le garde-chasse s’enfuyait, trois hommes étaient tués à bout portant. Trois autres étaient emmenés dans la loge pour une confrontation et, devant la femme du garde terrorisée, les Allemands les abattaient furieusement.
On devait retrouver les corps atrocement blessés de six maquisards de toutes les couches de la société: le commandant Séguileau de Préval, le lieutenant Forest, chef de dépôt à la S.N.C.F., Lagny. Lescot, Marié, Plonquet, des ouvriers.
Les Allemands incendièrent l’armement abandonné, qui fut entièrement calciné; rien n’avait été sauvé.
Les martyrs de Clairoix
L’ancien sous-officier de gendarmerie Quimerc’h marié à une jeune fille de Coudun près de Compiègne, s’était retiré dans cette localité après une longue carrière et, bien que sexagénaire, avait été interne au camp de Royallieu pendant seize mois.
Le 31 août 1944 vers 17 heures, il s’en revenait par la petite route qui après Coudun longe le Mont Ganelon, lorsqu’il vit brusquement devant lui une compagnie de cyclistes allemands faire halte pour se mettre en position dans un champ voisin. Des avions alliés en reconnaissance piquèrent et mitraillèrent les troupes ennemies. L’ancien gendarme se mettait à l’abri sous le pont de la Montagne à la sortie de Clairoix lorsque apparurent deux jeunes gens, Marcel Bagnaudez et Eugène Bonnard, qu’il connaissait bien. Ces derniers. F.T.P. du groupe de Clairoix, demanderont à Quimerc’h de les accompagner jusqu’à Coudun, ce qu’il refusa, mais il leur conseilla la prudence étant donné la présence des cyclistes ennemis et du mitraillage possible des avions de chasse.
Brusquement ce fut le drame. Les Allemands terrés dans les buissons du Marais surgirent et arrêtèrent les jeunes gens, les interrogèrent et fouillèrent. Bagnaudez portait une grenade, Bonnard, un pistolet automatique. Les soldats les jetèrent à terre, les frappèrent, les défigurèrent à coups de crosse et les obligèrent à creuser leurs tombes à quelques mètres de là. Malgré leurs blessures, Bagnaudez et Bonnard trouvèrent encore la force de piocher, subissant le martyre avec courage. Deux rafales de pistolets-mitrailleurs crépitèrent. résonnant douloureusement aux oreilles du seul témoin, Químerc’h.
Quelques heures plus tard, un habitant de Coudun, Derocquencourt. découvrait les corps des supplicies à peine recouverts d’une mince couche d’humus.
Libération
31 août 1944, les troupes allemandes n’ont pas encore fait sauter le pont de l’Oise et à la mairie, des papiers sont brûlés qu’il aurait été intéressant de compulser. Au siège du journal local, la Gazette de l’Oise qui paraissait sous l’occupation, un groupe d’individus est venu pour le brûler et rafler le stock de journaux. Cependant la lecture de ceux qui existent encore dans les biblio- thèques est édifiante quant au comportement de certains personnages.
Sur Compiègne, désert, plane un silence de mort; les habitants retranchés dans leurs demeures préparent les drapeaux pour le grand jour et attendent des événements espérés depuis longtemps. La radio de Londres annonce prématurément la libération de la ville. Dans la nuit, le vent souffle par rafales accompagnées de giboulées, puis le temps devient plus clément.
Des 16 heures 30, alors que les derniers trainards quittaient lamentablement la ville dans une débâcle incroyable, l’officier de police auxiliaire Marin et des agents de police renforcés de gendarmes occupaient la poste. Ils surveillent le central téléphonique dont le service assuré par les contrôleurs des P.T.T. Demouchy et Maufut, permet la liaison de l’E.M. des F.F.I. avec les divers groupes de LaCroix avec Cramer en particulier qui le renseignent sur les opérations en cours.
Vers quatre heures du matin, un coup de téléphone met en émoi policiers et postiers :
- Allo! la poste ? Que se passe-t-il à Compiègne ?
- Qui êtes-vous ?
- Un officier américain. Je vous parle de LaCroix-Saint-Ouen.
- Ah! Très bien. La plupart des Allemands sont partis depuis hier après-midi.
À l’instant, les derniers ont fait sauter le pont sur l’Oise.
- OK., merci. À bientôt.
À peine remis de leur émotion, une demi-heure plus tard nouveau coup de téléphone :
- Allo, la poste? Quoi de nouveau?
- Qui est à l’appareil ?
- Commandant Grégoire.
- Euh ? Connais pas!
- Bouquerel.
- Ah! Bien ! Les Américains nous ont appelés de LaCroix et nous les attendons d’un moment à l’autre.
- Merci, j’arrive.
Quelques instants après, trois officiers F.F.I. s’installaient à la poste et rédigeaient l’ordre de la libération de Compiègne.
Dans le même temps un char ennemi traversait la ville et, dans la rue Saint-Corneille au droit de la place Saint-Clément, braquait son canon sur l’Hôtel de Ville. Heureusement les Allemands se ravisent et, comme s’ils avaient le feu dans les fondements, se replient en vitesse pour échapper aux Américains qui les talonnent. Finalement le char sautera sur la route de Choisy, non loin du confluent de l’Aisne à l’Oise.
Alors qu’on s’attendait à voir les troupes alliées arriver par la rive Droite, le vendredi 1er septembre 1944 à 4 heures 45, les avant-postes de la 28e Division Américaine venus par la forêt, faisaient leur entrée dans la ville par le boulevard Gambetta, appelé depuis boulevard des États-Unis.
Des chars lourds descendent l’avenue Royale se dirigeant vers la Porte-Chapelle. C’est à peine si les Compiégnois entendent marcher les fantassins aux chaussures caoutchoutées qui longent les murs, à quelques mètres les uns des autres. Quel contraste avec les bruits de bottes entendus pendant quatre ans.
Les drapeaux français pour la plupart, sortent comme par enchantement. Nous déployons rapidement les nôtres confectionnés depuis huit jours : ce sont les pavillons des quatre puissances alliées : américain, anglais, français et soviétique. Ce dernier, le premier et le seul qui flotte à Compiègne obtient un gros succès de curiosité populaire. Personne ne paraît le connaître : ainsi le président de la délégation provisoire demandera à l’ambassadeur de l’U.R.S.S. de le lui faire connaître ainsi que l’hymne national soviétique en même temps que l’adresse d’un fournisseur de la musique instrumentale.
Dans l’allégresse générale, les cloches sonnent leur plus beau carillon. Le temps est beau. De porte à porte les citadins éveillent leurs voisins : «ils sont la !». Chacun sort et acclame les libérateurs.
Comme convenu avec mes camarades qui patrouillaient en forêt sous le commandement de Châtillon et de Leroy, je me rendis auprès du pont au moment même où un jeune officier américain venait de le franchir les pieds dans l’eau, en passant sur les décombres immergés. Après une vigoureuse et reconnaissante poignée de mains et un chaleureux «Welcome to you», je me mis à sa disposition et il me demanda de quérir du matériel et une quarantaine de volontaires, afin d’établir une passerelle provisoire que pourraient emprunter ses hommes restés sur l’autre rive. Je traduisis la requête aux spectateurs mais chacun trouva une excuse spécieuse.
Pensant être plus heureux, je filais à la mairie où stationnaient des résistants de la dernière semaine de l’occupation, ils portaient un beau brassard. En hâte, je montai à l’étage supérieur dans l’espoir de trouver auprès des autorités l’appui nécessaire : deux personnages brassard au bras, qu’on ne se serait jamais attendu à voir en un tel lieu et en un tel jour s’entretenaient dans le vestibule, le maire, reconduit dans ses fonctions par Pétain, et un commandant qui pendant deux ans au C.R.T.P.G. avait fait nombre de conférences édifiantes sur l’ordre nouveau mais qui, réflexion faite, avait enfin compris et changé de camp. Tous deux prétextèrent le double jeu. Il est vrai que les deux fils du maire, sous-officiers, avaient été faits prisonniers et si le premier fut libéré en 1942, le deuxième fut déporté au camp de Kobierczyn pour refus de travailler pour l’ennemi.
L’heure n’était pas aux étonnements; j’étais là pour chercher des volontaires et du matériel. Je mis ces « autorités» au courant, mais aucun n’était capable de me satisfaire. Découragé, j’allai retrouver l’officier américain et lui avouai mon échec, il me montra en souriant ses hommes qui traversaient a leur tour l’Oise, les pieds dans l’eau. Enfin. une équipe de soldats alliés établit la passerelle indispensable, cependant que le plan d’eau était abaissé au barrage de Venette et que les Allemands occupaient encore Margny-lès-Compiègne sur la rive droite qu’ils évacueront l’après-midi.
Tout à coup, des coups de feu éclatèrent au centre de la ville. La foule qui fraternisait dans l’allégresse s’enfuit de toutes parts, telle une envolée de moineaux, prise de panique. Des gendarmes français et américains, des F.F.I. patrouillent et ramènent des prisonniers. Ces derniers conduits aux casernes et à la prison sont quelque peu houspillés par la population surexcitée. Un jeune soldat ne cesse de crier : «Ich bin ein Pole! Je suis Polonais!» À ma question, il me répond qu’il est originaire de la région de Grodno et parle le russe, ce qui confirme ses dires, et le prenant sous ma protection. Je l’accompagne avec un gendarme à la prison.
On épingle sur le corsage ou le veston des petits drapeaux tricolores confectionnés avec des perles, et offerts par des passants, cependant que des hommes et des femmes, jeunes pour la plupart, font la chasse aux collaborateurs des deux sexes dont un grand nombre s’est enfui; des femmes et des filles, elles allaient avec les Allemands, disait-on, sont arrêtées sous les huées de la foule qui les insulte, les gifle, leur arrache les cheveux et les fait défiler dans les rues sous les quolibets du public. Parmi elles, il y a des filles et des femmes de commerçants et du peuple, une héroïne qui eut son heure de célébrité populaire, mais les femmes de la haute société, pas très rassurées, ne sont pas trop inquiétées. Pourtant, la femme d’un général des Forces Françaises Libres, en dépit de son beau brassard F.F.I., sera incarcérée. Le crâne tondu, dédaigneuses, les horizontales sont promenées à travers la ville pendant quelques jours; cela amuse la galerie, le peuple qui en oublie les gros «kollabos», lesquels se sont enrichis honteusement dans le marché noir et le trafic avec la Wehrmacht. À Longueil-Annel les filles coupables d’avoir trop collaboré sont déshabillées et tondues des pieds à la tête si l’on peut dire, rossées, goudronnées, promenées dans les rues. À Coudun, elles sont tatouées. L’une d’elles, à Choisy, demande naïvement le prix de sa coupe de cheveux.

En une heure et demie le génie militaire construit, en amont du pont Détruit, un pont pneumatique muni d’un tablier qui permet aux chars lourds de circuler entre deux rails sur des bateaux qui s’enfoncent à peine.
Les forces américaines, qui ont contourné la ville par la forêt dans la nuit du 31 août au 1" septembre, attaquent une formation de la Wehrmacht en position au carrefour des chemins du Buissonnet et de Choisy, sur la route de Soissons. Les Allemands, des jeunes, résistent farouchement et laisseront 260 des leurs sur le terrain tandis que les Alliés subissent de légères pertes. Le combat se poursuit toute la matinée, puis vers onze heures des bombardiers larguent leur lourde cargaison et mitraillent les nids de résistance ennemis. les réduisant au silence.
Dans Vallée des Beaux-Monts des soldats américains disposent sur le gazon des panneaux en plastic fluorescent qui permettent aux observateurs alliés de situer la nouvelle ligne du front au fur et à mesure de sa progression.
À Choisy-au-Bac, le grand et le petit pont sautent vers 5 heures et quart, on entend partout des fusillades; au carrefour d’Aumont, au Francport a Berneuil. À 10 heures, une escadrille de chasseurs, en 25 vols piqués, mitraille par balles lumineuses les colonnes de fuyards ennemis. L’artillerie américaine. à cause d’un tir trop court dirigé sur les lignes allemandes, bombarde, à 14 heures, Choisy et le confluent de l’Aisne à l’Oise sans toutefois faire de victimes parmi les habitants qui tout à la joie d’être libérés, sont sortis de leurs demeures.
À Compiègne, les pontonniers établissent un deuxième pont sur bateaux en aval du pneumatique qu’ils démontent aussitôt, puis un troisième sur pontons, enfin le 11 septembre, un quatrième avec passe navigable cette fois, face à la gare, d’une force de 60 tonnes avec trottoirs réservés aux piétons.

Le travail et le ravitaillement perturbés depuis plusieurs jours reprennent leur cours, l’électricité est rétablie, la vie renaît.
Le 5 septembre, le maire destitué, est gardé à vue à la sous-préfecture pendant 24 heures, des bruits courent sur son compte. Des collaborateurs sont arrêtés, une jeune fille tondue qui plaide non coupable, retenue avec ses compagnes à la Maison d’Arrêt se jette la tête la première dans l’escalier de la prison, il faut l’emmener à l’hôpital, grièvement blessée.
À Royallieu, un cultivateur, personnage important du Comité du Ravitaillement qui se chargeait surtout de ravitailler la Wehrmacht et persécutait ses confrères de la culture moins complaisants, est arrêté et frappé d’une amende d’un million de francs que le fisc lui aurait remboursés. Ce trop zélé collaborateur avait aussi dénoncé le cultivateur René Soiron pour avoir recueilli un container chargé de tracts largué dans son champ par un avion allié. Des bombes ayant explosé devant sa porte, le collaborateur avait accusé de connivence avec un brigadier de gendarmerie, le secrétaire de mairie de LaCroix-Saint-Ouen, Boisseau. Le gendarme, arrêté par ses collègues et les F.F.I. est exposé pendu par les pieds par les habitants, puis muté dans la Marne, sanction jugée suffisante.

Un spectacle devenu familier nous est offert, celui des forteresses volantes accompagnées de chasseurs qui vont bombarder l’Allemagne et l’Italie. Près de 500 appareils en formations impeccables nous survolent un jour en plein midi. La maitrise de l’air alliée est incontestable, toutefois, au retour d’Allemagne après plusieurs heures de vol, on observe les vides laissés par des avions abattus. Le 5 octobre 1944 à Rethondes, une de ces forteresses s’écrasera avec ses quatre occupants dans un fracas terrifiant.
Le 7 septembre, les prisonniers allemands sont transférés à Royallieu. Avec une sorte de férocité comique, sur leur passage, des femmes leur montrent le poing, certaines d’entre elles, pourtant, un mois auparavant, leur montraient généreusement plus que de la sympathie. Les moins heureuses qui ont été tondues et incarcérées, vident les tinettes des latrines généreusement remplies par les F.F.I. cantonnés aux casernes. D’autres conjuguent le verbe aimer en anglais d’Amérique, entre deux coupes de champaigne qui coule à flots. La vie est belle, pas pour tout le monde pourtant.

Le 13 on s’arrache les grands quotidiens de Paris qu’on revoit pour la première fois et le courrier suspendu depuis huit jours est rétabli le 15 septembre à l’intérieur du département. Le marché noir persiste. Le département est déclaré excédentaire bien que la disette y soit grande, tout le ravitaillement est dirigé sur Paris. La population s’insurge contre cet état de choses et demande de prendre comme exemple la «mairesse» de Soissons. Cette première femme maire de France est très active et fait de sa ville un grand centre de ravitaillement où l’on court faire des emplettes. Il est vrai que cette femme est énergique. Membre du F.N., partie en mission à Londres pendant l’occupation, cette femme avait été arrêtée à son retour et s’était évadée. sous un uniforme d’agent de police, de l’hôpital où elle était en traitement.
Le 23 septembre un curieux spectacle réjouissait les Compiégnois : la traversée de l’Oise par 26 chars amphibies américains.
La S.N.C.F. et le génie américain, pourvu d’un impressionnant matériel et auprès duquel je suis attaché à titre d’interprète, activant la reconstruction des ponts et des voies de chemins de fer.

Dans le secteur d’Estrées-Saint-Denis, des jeunes soldats allemands pris au piège, cachés dans les bois, pliaient les jardins. Le curé de Francières l’abbé Le Pévédic. suivi de volontaires F.F.I., de son groupe, dont Eugene Brunel, organise une chasse à l’homme et, à la lisière d’un champ non loin de L’église, tua quatre ennemis. Poursuivant son ’action de nettoyage’, le groupe se dirigea vers le bois de Mareuil à 200 m de là, lorsqu’un autre Allemand à l’affût dans les fourrés, tua à son tour d’une rafale de mitraillette. Maurice Plessier, l’un des F.F.I. .
Les jours suivants, avant de se rendre aux Américains, le même Allemand, eut encore le temps d’abattre un paisible habitant Léon Thierry, 40 ans, qui avait épouse une de mes cousines et laissait quatre orphelins.
Il était le onzième tué de ma famille pendant les deux guerres.
Inquiétudes et vicissitudes
Le 16 juillet 1944, à 21 heures, le capitaine Hilger, responsable du Secteur F.N. était arrêté à Chevincourt à la suite d’une dénonciation. Un lieutenant du groupe. le cheminot Leclerq, lui succède et réussit, après de nombreuses recherches, à s’entretenir avec le commandant des F.F.I. Bouquerel, qu’il met au courant des derniers événements. Il lui demande en vain des armes pour ses F.T.P., il n’y en a pas…
Leclercq dispose d’un effectif de 850 F.T.P. qu’un lieutenant prétend prendre sous son commandement en éliminant Leclercq qui refuse de se soumettre et demande qu’on lui confie un secteur pour lui et ses hommes. En dépit des promesses faites, il attend plus d’une semaine. Leclercq s’impatiente, sollicite trois fois encore une entrevue et est enfin reçu par un officier adjoint qui lui déclare qu’il doit obéir, sans les discuter, aux ordres qui lui ont été donnés et les exécuter, et, d’ailleurs, les hommes du F.N. et les F.T.P.F., ces résistants chevronnés, ne sont pas homologués parmi les F.F.I. . En conséquence, leurs brassards ne peuvent pas être estampillée officiellement, ce qui est en contradiction flagrante avec les directives de l’État-Major départemental reçues par Leclercq.
Le 1er septembre, jour de la libération, Leclercq reçoit l’ordre de se rendre au Haras avec ses hommes afin de les équiper et de les répartir en groupes. Du Haras où il est adjoint au sous-directeur, le capitaine de Laurens de Saint-Martin. Leclercq se rend au bureau de la Place pour y faire estampiller les brassards des F.T.P.F. du Front National. Après de vives discussions, 90 seulement sur 250 reçoivent le cachet officiel, mais les 160 F.T.P. éliminés se fâchent à l’idée D’être devenus des irréguliers. De violents incidents éclatent à Choisy-au-Bac, à Élincourt et dans tout le Secteur. Les F.T.P. qui avaient largement combattu. bien avant la libération se voyaient éliminés et sommés de rendre leurs armes aux V.O.P., Volontaires Ouvriers et Paysans, formation récente non reconnue par le Comite National de Libération et qui, de ce fait, le 3 septembre, est intégrée à l’O.C.M.

Étant donné que seuls les F.F.I. porteurs de leurs certificats étaient admis sans difficultés dans les casernes pour s’enrôler dans l’armée, les F.T.P. sont refoulés sur le bureau de la place où ils se heurtent toujours au même argument : F.N.? Connaissons pas. Leurs chefs sont rétrogradés, indésirables. En ce qui concerne les propositions de récompenses déposées en temps voulu, aucune suite ne sera donnée au dossier impressionnant bien qu’incomplet du F.N. et qui devient introuvable. Dans les autres groupes, il règne aussi un malaise, des résistants critiquent publiquement les attributions accordées à certains des leurs. D’autres, sortant de leur léthargie, s’empressent de s’attribuer des grades sur leurs cartes F.F.I. . Quand on prend du galon, on ne saurait trop prendre. Un trésorier-payeur, qui a le sens de l’humour, raconte partout que c’est une armée de gradés.
Le 5 septembre la formation du Comité Local de Libération soulève des difficultés, seuls les membres de l’O.C.M. et de Résistance en font partie. Certains sont censés représenter les organisations Libération, M.L.N., M.R.P., Radicaux-Socialistes. Le vice-président d’honneur du Comité Départemental de Libération, M. Wallon, venu de Beauvais, refuse de présider la réunion en l’absence des représentants du F.N. et de leur chef. Leclercq. Dès la présence de ces derniers, le commandant Bouquerel explique qu’il y a eu malentendu, que lui et ses amis n’ont pas été complètement instruits des décisions du C.D.L. et ils admettent volontiers l’entrée au sein du Comité Local de Libération de sept délégués, Rémy, de la C.F.T.C., Traverse, de la C.G.T., Van der Kerken et moi-même du F.N., Leroy et Marquet. du P.C.F., et Boisseau, de la S.F.I.O. Ce C.L.L., qui compte 23 membres, est présidé par le général de Joybert.
La désignation d’Osset, le lieutenant Léonard de l’E.M. du F.N., au poste de sous-préfet par le C.D.L. en accord avec le nouveau préfet, un mois auparavant, est remise en cause en dépit de Leclercq. Se considérant offensé, Osset se retire avec dignité devant l’hostilité qui lui avait été manifestée par les autres groupes qui lui préfèrent leur propre élu. Après un appel du président Wallon à la conciliation et à l’union et auquel se rallie Morgeaux, un des responsables du F.N., on passe au vote. L’unique candidat, de Passilié, est élu sous-préfet de Compiègne à l’unanimité moins une abstention, celle de Leclercq à qui Bouquerel conseillait : «il faut arranger les choses, sans quoi cela va faire un scandale !».

De son côté, le capitaine Lefèvre, entré dans le mouvement Résistance en 1942 et qui, succédant à Baduel, massacré, avait pris le commandement de son groupe, se considère évince et frustré du poste qui devait lui être dévolu et exprime à qui veut l’entendre, sa surprise et son étonnement.
Le 11 septembre, un nouveau Conseil municipal, dont les membres ont été désignés par le préfet, se réunit pour la première fois mais son existence est de courte durée: des documents, jugés graves par le C.D.L., mettent en cause des membres de l’ancienne municipalité qui sont restés en place. Une délégation spéciale provisoire présidée par Forest lui succède. La commission d’épuration composée du docteur Hammel, de Boisseau et de Terqueux, engage des poursuites envers quelques gros profiteurs notoires. Les tenants de la collaboration ne sont pas très inquiétés. Le commandant repenti, «Suivons le Maréchal», se fait remarquer par son activité et, en dépit des trois dossiers successifs qui l’accusent et disparaissent, monte en grade. Un clerc de la basoche qui, prisonnier de guerre, avait exprimé à Hitler son admiration et ses encouragements dans une lettre reproduite par tous les journaux, ne se montre pas. Les doriotistes et les miliciens non plus. Il faut être juste, l’éponge a été bien employée et nombreux sont ceux qui respirent enfin librement. Quant aux malchanceuses tondues, libérées, elles porteront longtemps des perruques avantageuses.
Les relations postales avec les autres départements ne sont rétablies que le 10 octobre, à dix exceptions près, et l’utilisation des enveloppes et des cartes-postales illustrées reste interdite.
Les Américains pratiquent un business illicite sur une grande échelle et vendent uniformes, linge de corps, chaussures, savon et toutes choses introuvables depuis plus de quatre ans. L’opinion qu’ils se font des Français n’est pas flatteuse: les hommes sont traités de paresseux. La plupart des gens étaient à la portion congrue et avaient maigri de 10 à 30 kilos, les gosses sont des voleurs et les femmes, très volages, et même qualifiées d’un terme plus péjoratif, bien qu’elles n’aient rien à apprendre de leurs sœurs d’Amérique, où, comme chacun sait, la vertu des femmes et des filles n’est pas moins fragile qu’ailleurs.
Dans un dancing de la ville, les Américains organisent des bals auxquels seules les dames et les jeunes filles sont admises sur invitations. La réaction est immédiate. Des bagarres surgissent et par voie d’affiches, les civils informent ces femmes qu’elles seront tondues à leur tour si, à l’avenir, elles fréquentent ces bals que l’autorité militaire américaine interdit sagement.
Le 1er bataillon du 67e R.I., composé de volontaires sous les ordres de Bouquerel, de Barriquand, de Leroy et de Martin se prépare à partir devant Dunkerque encore occupé, lorsque le 21 octobre, après deux heures d’attente, le général Koenig et le colonel Rol-Tanguy passent en revue deux bataillons de jeunes recrues pleins d’ardeur. Ce sont pour la plupart des résistants, mais on manque d’uniformes et leur tenue est disparate. La veille de Noël, l’un d’eux, un Compiégnois, Roger Lefel, du 132/24, monté sur une moto, n’entend pas les sommations des Américains, qui l’abattent non loin de son domicile.
L’hiver est précoce et il n’y a pas de charbon. L’administration des Eaux-et-Forêts accorde des coupes de bois et les enfants apportent leur bûche à l’école comme au temps jadis. L’Union des Femmes Françaises organise et distribue des secours aux vieillards et aux nécessiteux.
L’inquiétude renaît: la Wehrmacht a bousculé les armées alliées sur un front de 80 km et progresse de 30 à 40 km dans les Ardennes, faisant des milliers de prisonniers. L’armée de von Rundstedt a lancé une contre-offensive devant Bastogne pendant que les soldats américains, en fête, dansent dans le cloître des religieuses qu’ils ont transformé en salle de bal. Les Allemands foncent vers Bruxelles et la France sans s’attarder à réduire les unités encerclées et les S.S. massacrent les hommes des localités qu’ils réoccupent. A Compiègne les résistants se préparent à reprendre un combat qui s’annonce meurtrier.
Déjà les collaborateurs jubilent, et le 28 décembre 1944, près de Beauvais, la Luftwaffe largue des armes à des fascistes heureusement noyautés par des officiers du 2e Bureau qui les mettent en état d’arrestation avant le parachutage. Ces officiers reçoivent eux-mêmes 25 mitraillettes, 3 fusils-lance-grenades, des pistolets et de nombreuses munitions destinés à libérer le chef royaliste pro-nazi, Maurras, interné à Lyon. Mais l’identité des ultras n’est pas révélée.
Sollicité par Churchill, Staline déclenche une formidable offensive de l’armée soviétique sur le front oriental, qui contraint les Allemands à dégarnir celui de l’Ouest et permet aux Alliés de colmater la brèche ouverte par la Wehrmacht. On respire mieux.
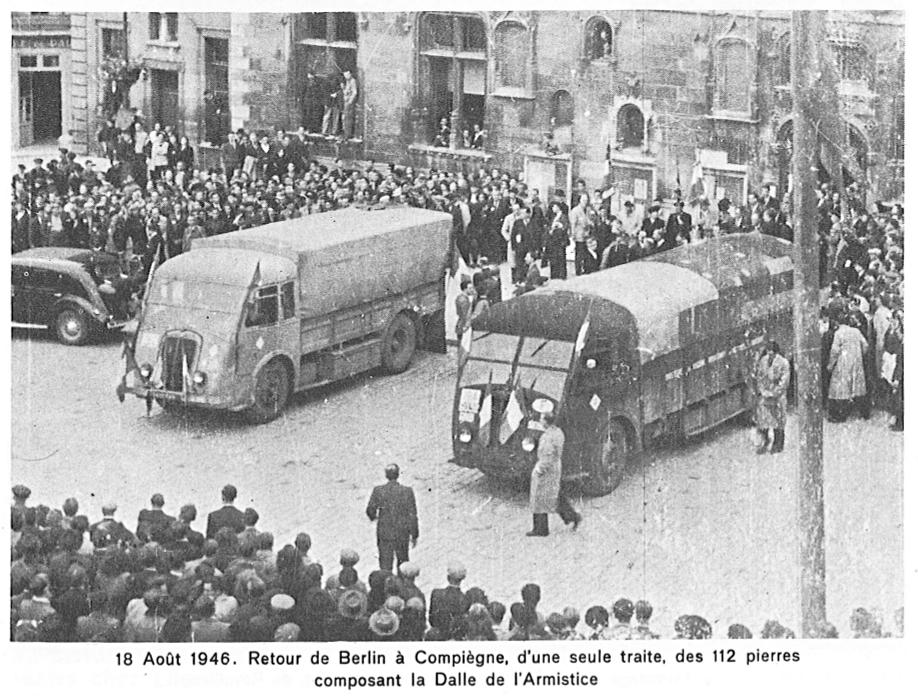
Pétain et sa femme, partis avec les nazis, s’installent à Sigmaringen, sur le Danube, à 80 kilomètres au sud de Stuttgart.
Un camp de rescapés Soviétiques
Dès octobre 1944, un grand Centre de Rassemblement pour les Soviétiques Libérés, prisonniers de guerre, déportés du travail, hommes, femmes et enfants, maquisards et évadés, était constitué au quartier Bourcier à Compiègne. Les hommes assuraient la garde du bureau de la Place et pendant plusieurs mois, deux à trois mille Soviétiques furent placés sous l’autorité du commandant Saproulov, assisté de plusieurs officiers.
Depuis les derniers jours de décembre, je leur rendais visite presque quotidiennement, m’efforçant de leur venir en aide dans la mesure du possible. Un certain nombre d’entre eux avaient combattu dans les rangs des partisans et quelques-uns venaient à la maison écouter les émissions de Moscou relatant la marche victorieuse de leurs armées à travers la Prusse-Orientale, nouvelles qu’ils étaient heureux de rapporter à leurs camarades.

Comme ceux qui n’entendaient pas ces nouvelles restaient sceptiques, afin de les convaincre et de leur faire plaisir, on leur devait bien cela, je leur confiai l’appareil qu’ils gardèrent jusqu’à leur départ. Sans argent. démunis de tout, mal nourris, à la demande du sous-préfet et de la Mission militaire française détachée auprès d’eux, leurs rations de viande réglementaires déjà modestes leur avaient été réduites de moitié, ils organisèrent, en vue d’améliorer l’ordinaire, des séances récréatives de théâtre, de danses et de chœurs au Théâtre de la rue Vivenel.
Mais les spectateurs ne furent pas nombreux à assister à ces représentations. Pourtant les artistes étaient de grande valeur et les programmes de haute qualité; une jeune ballerine, en particulier, était éblouissante de grâce et de souplesse et remportait un succès mérité, mais, c’étaient des Russes!
Ils répétaient leurs numéros dans une baraque Adrian du quartier et au cours d’une répétition, je fus l’objet d’une émouvante manifestation. N’ayant pas vu mes amis habituels dans leur chambrée, je cherchai à les retrouver: ils sont au théâtre, me dit-on. J’y entrai par la porte du fond sans faire de bruit. Une douzaine d’entre eux évoluaient sur le plateau, une dizaine d’autres les regardaient. Dès qu’ils me virent, tous se figèrent au garde-à-vous et entonnèrent notre Marseillaise dont ils chantèrent deux couplets en notre langue.
J’étais ému, jamais notre chant national ne m’avait produit une telle émotion. Je les remerciai de l’hommage qu’ils rendaient à ma patrie et de leur délicate attention, regrettant de ne pouvoir leur rendre la politesse en leur chantant leur Novyl Gymn que le les priai de chanter, ce qu’ils firent gentiment.
Avant qu’ils ne regagnent leur pays, j’allai les saluer une dernière fois au départ du train, lequel pour la circonstance, avait été formé, on ne sait pourquoi, à 1500 mètres de la gare entre les deux passages à niveau de Clairoix, à la limite de Margny-lès-Compiègne.
Quelques mois plus tard, à la France menacée de disette, la Russie envoyait son blé.
Paix dans le Souvenir
Le 8 mai 1945, l’Armistice mettait fin à 2075 jours de cauchemars d’une guerre que l’Allemagne nous avait imposée. La veille, à Compiègne, à 18 heures, les cloches et les sirènes fonctionneront prématurément pour annoncer l’heureux événement et durent renouveler leur office le lendemain.
Plus tard, on apprendra avec douleur la disparition de 197 Compiégnois.
Pour la France entière, les morts se comptaient par milliers6060 60 Les estimations en 2018 sont plutôt de l’ordre de 570000 dont 220000 combattants.:
| Civils tués | 250000 |
|---|---|
| Déportés | 200000 |
| Combattants | 120000 |
| Service du Travail Obligatoire | 60000 |
| Prisonniers de guerre | 38000 |
| Fusillés et massacrés | 30000 |
| Forces Françaises de l’intérieur | 25000 |
| Total | 723000 |
À ce total tragique, il fallait ajouter des milliers de blessés, mutilés et grands malades. Des 38000 survivants de la déportation qui connurent la douce joie de la Victoire, 20000 devaient bientôt succomber, 1500000 prisonniers de guerre, 550000 déportés du travail allaient retrouver le sol de la Patrie après de dures années d’exil, dans l’espoir de lendemains qui chantent, dans l’Union et dans la Paix.
Cinq mois plus tard, au début d’octobre 1945, la Ville de Compiègne recevait la lettre suivante:
| Zeldler und Wimmel gegründet 1776, Steinbruch |
| Berlin O’17. den 28. September 1945, 15-17. Mühlenstrasse |
| Wir geben hiermit die Firma eidesstattliche Erklãrung ab. dass wir wlssen. dass die Firma Zeldler und Wimmel auf ihrem Werkplatz in Berlin 0-17, Mühlenstrasse 1547. auf Welsung der verwaltenden deutschen Behörde seiner- zelt das Denkmal von Compiegne einlagerte. Stücke des Denkmals liegén noch heute auf diesem Platz. einige Teile sind jedcch vor einige Monaten bei dem Brand eines Schuppens vernichtet werden. |
| Emma Johanna Rudel Rudolf Franz |
| Prokuristin der Firma Zeidler u. Wimmel |
| Prokurist der Firma Zeidler u. Wimmel. |
| Carrière de pierres Zeidler et Wimmel, Maison fondée en 1776 |
| Berlin 0-17 le 28 septembre 1945, 1547, rue du Moulin |
| Nous déclarons, sous la foi du serment, savoir que le Monument de Compiègne a été déposé sur le chantier de la Maison Zeidler et Wimmel, 15 et 17, rue du Moulin à Berlin Est-17, selon les ordres des autorités allemandes de l’époque. Les éléments de ce Monument s’y trouvent encore aujourd’hui, mais cependant quelques-uns ont été détruits lors de l’incendie d’un hangar il y a quelques mois. |
| Emma Johanna Hudel Rudolf Franz Mandataire |
| de la Firme Zeidler et Wimmel Mandataire |
Compiègne dans la joie attendait ses monuments que l’on croyait anéantis comme l’avait été le fameux wagon historique6161 61 À Berlin, Je n’ai pu rencontrer aucun témoin de cette destruction., mais de grandes difficultés matérielles subsistaient: voies ferrées et routes défoncées, encombrées par les transports et le ravitaillement des troupes d’occupation alliées et l’accumulation des ruines dans les rues de Berlin.

À la suite des démarches entreprises auprès des autorités soviétiques par le ministre des A.C., Laurent Casanova, celles-ci en autorisèrent le transport par la route et voies ferrées. La dalle, composée de 112 pierres, elle-même chargée à bord de camions, parvint à Compiègne le 18 août 1946 en fin d’après-midi au cours des cérémonies du Rassemblement du Souvenir qui dura quatre jours6262 62 Les éléments du monument des Alsaciens-Lorrains revinrent par voie ferrée..
Ces manifestations furent grandioses, des dizaines de milliers de rescapés des Camps de la Mort et des prisons, des stalags et des oflags, des usines nazies, hommes et femmes qui eurent ä supporter les chaînes de l’ennemi en terre d’exil, jurèrent fidélité au testament des Martyrs et, unanimes, exprimèrent leur volonté de châtier les traîtres, dans l’Unité de la France et de la Résistance, convaincus que c’était ensemble que tous les patriotes pourraient faire reculer les forces de guerre en ne trahissant pas leur passé. et assurer à notre jeunesse, dans une France démocratique, l’avenir radieux qu’elle espère dans la liberté et dans la paix.
Sources d’information
Courrier et Souvenirs de M. Michel, délégué de la Croix-Rouge helvétique
auprès du Camp de Royallieu. Témoignages et Lettres d’Anciens Déportés,
Internés et Résistants français et étrangers. Archives Municipales et de la
Croix-Rouge de Compiègne, du Front National et de divers Réseaux de Résistance,
des Bibliothèques Nationale et Municipale. Le Patriote Résistant,
journal de la F.N.D.I.R.P. Revues et Bulletins des Amicales de Déportés
et de Résistants. Notes et Documents de l’auteur.
Un Témoignage. Le Diktat de Rethondes et l’Armistice Franco-Italien, sans nom d’Auteur. Flammarion, 1957. Courrier Picard. Collection du 17 au 26 février 1962. Et les Murs tombèrent. Historia n° 66, page 421. L’Opération Jericho. Remy. Histoire vraie de la Déclaration de Guerre. Pierre Durand. Supplément au n° 4689 du 30 septembre 1959 de «l’Humanité», Mein Kampf, Hitler. Monsieur Jean. Die Geheimmîssion eines Deutschen. Erich Borchers. Adolf Sponholz. Hannover, 1951. C’était ainsi. Fernand Grenier. Editions Sociales. Le Camp de la Mort lente, J.-J. Bernard, Albin Michel. Mémorial. Consistoire des lsraëlites de France et d’Algérie, J. Jacob, éditeur, Paris. Frontstalag 122. Hoen. Bourg-Bourger. Luxemgourg. L’Evasion, Georges Cogniot. E.F.R. Nous nous sommes évadés de Compiègne, Ch. Désirat. S.P.F. Le Convoi du 24 janvier, Charlotte Delbo, Edition de Minuit. Camp de Buchenwald, Docteur Roos. Médicis 1945. Rue de la Liberté. Edmond Michelet, Editions du Seuil, 1955. Le Bataillon d’Eysses, Jean Guy Modin, Amicale d’Eysses. Paris. J. London. Récits d’un Revenant. Maurice Delfieu. Publications de l’indicateur des P.T.T., 1947. Liste des Camps de Concentration publiée en 1950 par le Ministère des A.C.V.G., Journaux Officiels. Le Grand Voyage, Jorge Semprun, Gallimard. Convoi de la Mort, Marcel Guérin, Marches de France. On m’appelait Rémy, Colonel Rémy, Plon. Revue France-U.R.S.S. Paris. Le IIIe Reich, William Shirer, Stock. Paris brûle-t-il ? Dominique Lapierre et Larry Collins. R. Laffont. De la Chute à la Libération de Paris, D’Astier de la Vigerie, Gallimard. Journaux Français et Etrangers.

Origine des documents photographiques publiés
Mlle Liliane Mermet et Jean Mermet, journalistes à Compiègne.
Hoffmann, photographe à Munich.
Editions de l’Armistice, Compiègne.
Hutin, photographe à Compiègne.
Albert Bourdon.
Pierre Lambert.
Jean Léveillé.
Services allemands.
Documents de l’Auteur.
Anonymes.
À Mme Denise Bernard-Folliot qui. aimablement et spontanément, a bien voulu apporter les nombreuses corrections dans mon manuscrit et me prodiguer les judicieux conseils de son expérience, j’exprime toute ma gratitude.
Merci également aux personnalités, à M. Michel, délégué de la Croix- Rouge helvétique auprès du Camp de Royallieu, aux Services du ministère de la Justice, municipaux et des Bibliothèques, à Mme Jean Mermet, à l’Association Nationale des Familles de Fusillés et Massacrés, aux Amicales d’Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Neuengamme. Ravensbrück, aux Anciens Déportés, internés et Résistants des divers Réseaux, aux Editeurs et à tous ceux et à toutes celles qui ont bien voulu me confier leurs témoignages ou leurs documents photographiques et m’autoriser à les publier.
Tous ont facilité la parution de cet ouvrage et m’ont permis, malgré le grand soin que j’ai pu apporter, de limiter les erreurs et omissions toujours inévitables.
A. P.